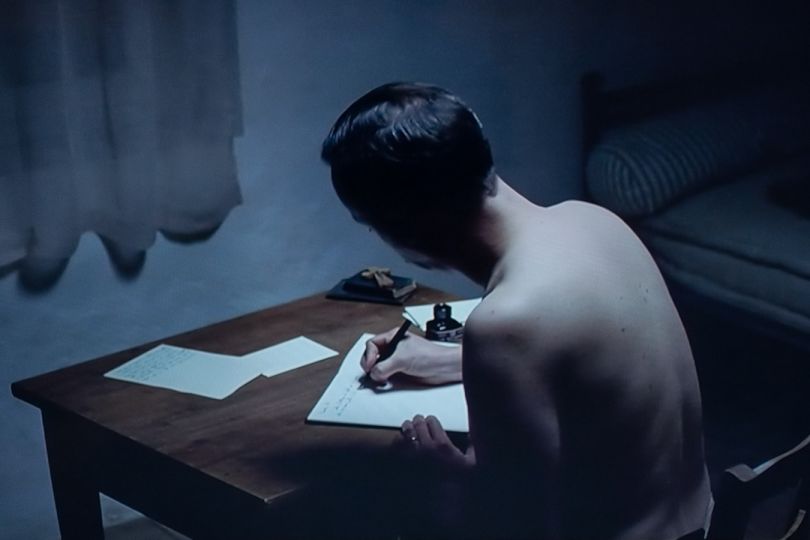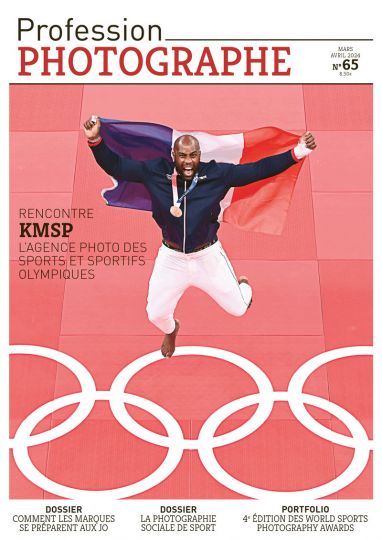Helen Levitt est dans une classe à part et la singularité de sa photographie est probablement indissociable du contour distinctif de sa vie et de son caractère. Elle n’a photographié que la ville de New York, où elle est née en 1913 et a vécu jusqu’à sa mort en 2009, et comme Samuel Beckett a fermement résisté aux tentatives de lui faire expliquer son travail.
À première vue, ses images de la fin des années 30 et des années 40 semblent faciles à lire: photographie de rue de la classe ouvrière, en particulier des enfants, encadrée par des trottoirs et des immeubles dans des quartiers pauvres et immigrés. Des adjectifs tels que «chaleureux» et «lyrique» ont été utilisés et un romantisme sexué souligne leur qualité picturale et diminue leur complexité. Ce qui peut être oublié, c’est que l’art de Levitt a été forgé dans un chaudron de politique de gauche, de modernisme et de surréalisme. Dans une interview en 2002, elle revient sur une époque où la prise de décision était décidée pour elle: «Je devais prendre des photos de la classe ouvrière et contribuer aux mouvements… Socialisme, communisme, quoi qu’il se passe».
Levitt a fréquenté les membres de l’organisation de gauche Film & Photo League, a rencontré Buñuel et Henri Cartier-Bresson et a travaillé pendant un certain temps avec Walker Evans sur son projet de métro (s’asseoir avec une femme le rendait moins visible). Les braises chaleureuses de son engagement, cependant, n’ont pas nourri un documentaire pictural par souci des conditions sociales ou de la prise de conscience. Il n’y a rien de manifestement politique, et encore moins de polémique, dans les photos qu’elle a prises. La complexité de son travail s’inscrit dans une esthétique radicale mais se cache derrière une apparente simplicité de vision.
Une manière d’entrer dans les spécificités de son art est enracinée dans les circonstances sociales et économiques de l’époque et du lieu où elle a pris son appareil photo. Elle parcourait les trottoirs de Spanish Harlem et du Lower East Side, une aire de jeux pour les enfants – les familles pauvres n’avaient pas les moyens d’acheter des voitures (ou une surabondance de jouets achetables) et la circulation automobile n’était pas la menace d’aujourd’hui – et la rue un refuge pour les adultes défavorisés pour échapper à la chaleur estivale en l’absence d’appartements climatisés (et pas de télévisions). L’œil de Levitt, comme l’a dit David Levi Strauss, est attiré vers «la société de l’inspectacle – une vision de la vertu ordinaire». La référence à Guy Debord fait ressortir sa description de la culture de consommation: «le déclin de l’être en ayant et l’ ayant devenant simplement apparence.» Compte tenu d’un manque relatif de biens de consommation sur le territoire de Levitt, il y a peu de fétichisme des marchandises et les enfants ont utilisé des restes et débris de la rue pour des expériences ludiques.
L’appréhension visuelle de Levitt est de nature somatique; ce qu’elle voit, ce sont des corps dans l’espace, au travail ou au repos. Ils sont typiquement en mouvement mais parfois passivement ou contemplativement stationnaires; ils sont toujours expressifs, engagés, gestuels. Si nous avons besoin d’un récit pour «expliquer» une mise en scène particulière, il peut être inféré, mais ce qui prime est l’agencement spatial des corps et, souvent, il n’existe pas de «sens» à extraire.
Un bon exemple est sa photo de deux garçons manipulant des fragments de verre d’un miroir brisé. Ce qui transcende le hasard fantaisiste d’un gamin sur un vélo qui regarde de l’intérieur du cadre du miroir brisé, c’est la plus grande image sémiotique de l’activité manuelle (le mot vient du latin pour «main») se déroulant autour de lui. En plus des propres mains du garçon tenant son vélo – et une main sur un deuxième vélo empiète sur un bord de l’image – il y a des mains tenant le cadre du miroir, la main d’un enfant dans sa poche et, au centre de tout cela, la manipulation du verre brisé par les deux garçons, leur vulnérabilité résultant de leur tâche imitée avec empathie par les deux mains du garçon de gauche les regardant. L’arrière-plan fournit d’autres couches à la composition: lettrage sur la fenêtre de la blanchisserie et des autres enseignes: une femme tiens un landau; les gestes de trois filles et de l’homme au chapeau de paille. La main de l’adulte vue regardant les enfants avec contingence n’est pas activement déployée, il se trouve qu’elle passe juste devant, mais est en harmonie avec les autres en possession de l’espace de la rue; c’est leur polis, contractée sur l’espace d’un trottoir.
La chorégraphie de la scène est naturelle, confirmant l’une des rares remarques de Levitt sur sa propre pratique: «tout ce que je peux dire sur le travail que j’essaie de faire, c’est que l’esthétique est en réalité elle-même».
À partir de la fin des années 40, elle a passé une décennie à faire du cinéma et, en retournant à la photographie, elle a commencé à utiliser la couleur avec prescience. Mais la vie dans la rue avait changé et l’aliénation des adultes occupait l’espace autrefois approprié et appartenant à ses habitants urbains. Le livre, Helen Levitt, contient plus de 200 pages de ses photographies en noir et blanc et trente-quatre de ses photographies en couleur. Chacune d’elles a une page et cela, avec cinq essais perspicaces commentant les aspects de la réussite de Levitt, en fera l’un des meilleurs livres photo à paraître en 2020.
Sean Sheehan
Helen Levitt
Sous la direction de Walter Moser, Albertina
Textes de Duncan Forbes, Astrid Mahler, Walter Moser,
Christina Natlacen, Bert Rebhandl
Conçu par Manuel Radde
Relié
22 x 27 cm
232 pages
203 n / b et 34 couleurs ill.
ISBN 978-3-86828-897-1
Euro 39,90 / GBP 35,00 / US $ 50,00