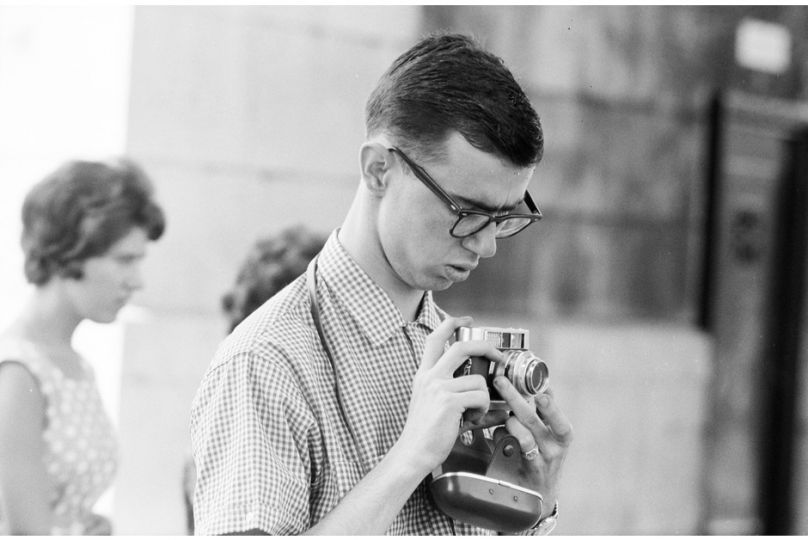La grande majorité des images que vous voyez dans vos journaux sur le conflit syrien n’ont pas été réalisées par des envoyés spéciaux de rédactions ou d’agences de presse. Ceux qui s’y risquent limitent leur déplacement sur des zones clairement identifiées, pour des missions courtes. La violence du conflit et la cible que représentent les journalistes pour Daesh obligent les organes de presse à s’appuyer sur des contributeurs locaux. Ce sont eux qui documentent pour nous, au jour le jour, leur pays à feu et à sang.
Au moment où la Syrie entame sa cinquième année de conflit, L’Instant souhaite rendre hommage à ces témoins en première ligne. Patrick Baz, directeur photo à l’Agence France Presse (AFP) pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, travaille au quotidien avec eux depuis Nicosie.
L’Instant : Comment est né ce système de travail ?
Patrick Baz : Dans le courant de l’année 2013, en conséquence de la multiplication des enlèvements, l’AFP a décidé de ne plus envoyer de photographes staff en Syrie. Nous nous appuyons dorénavant sur un réseau de contributeurs nationaux dont j’ai tissé le réseau à partir de 2012.
Aujourd’hui, ce réseau est stable. Il compte une douzaine de photographes qui travaillent sur l’ensemble des zones rebelles. Mais cette équipe n’est majoritairement plus la même que celle établie fin 2012.
Pourquoi ces changements ?
C’est compliqué de tisser un lien sur le long terme. C’est la première fois que je dois gérer une équipe de manière totalement virtuelle ! Tout se fait par les réseaux sociaux, Facebook, Skype… Cela installe une relation très prenante. Je reçois des messages à n’importe quel moment du jour ou de la nuit, et ils s’attendent à ce que tu répondes dans la minute. Parfois tu joues au psy. La moyenne d’âge est de 25 ans, donc cela nécessite beaucoup de soutien.
Mais ce système a un avantage considérable : ma page Facebook est ouverte, ils savent où me contacter et à travers cela, l’agence est incarnée. Pour eux, ce n’est pas juste un e-mail envoyé à une adresse virtuelle AFP.com.
Une fois que le contact est établi, quelle logistique est mise en place ?
Ils travaillent avec leurs propres équipements. C’est très difficile de faire un support technique. J’ai réussi une fois à faire passer un peu de matériel, notamment des gilets pare-balles, mais tous n’ont pas de passeport, et ca se complique souvent à la frontière. Pour ce qui est de la rémunération, il n’y a évidemment aucun système bancaire sur place donc nous passons par des comptes ouverts à leur nom en Turquie ou au Liban. Puis nous faisons des transferts d’argent par les agences spécialisées type Western Union. Mais je ne veux pas rentrer plus dans les détails par mesure de sécurité.
Qu’en est-il justement de leur sécurité ?
Le problème c’est que tu ne sais jamais précisément où ils se trouvent, et lorsqu’ils s’arrêtent de travailler tu ne sais jamais vraiment pourquoi. De la première équipe, deux ont fui le pays et les exactions de Daesh, grâce à notre soutien et celui de Reporter Sans Frontière. L’un d’eux notamment fut retenu prisonnier par le groupe islamiste. À sa libération, il voulait continuer de travailler malgré nos recommandations ; il nous disait qu’il voulait gérer ainsi son traumatisme. Il ne nous transmet plus d’images aujourd’hui, je ne sais pas ce qu’il est devenu.
Et puis Abu Shuja « le courageux » a été tué dans un bombardement à Deir Ezzor le 28 septembre 2013.
Comment faire la part des choses entre leur implication dans le conflit et la notion de journalisme ?
On ne va pas se cacher derrière son petit doigt, ce sont tous des militants. Je ne crois pas en l’objectivité, nous sommes dans une région où il est impossible d’en avoir. D’une manière ou d’une autre, il faut accepter que notre métier soit subjectif. L’essentiel est de savoir rester neutre dans les images que nous diffusons et nous nous limitons au factuel. Comment peux-tu demander à ces gamins d’être objectifs, quand ils se prennent des barils d’explosif dans la tronche.
Pourtant ils sont bien dans une démarche de témoignage et de photojournalisme ?
Oui. D’ailleurs avant cela, le photojournalisme en Syrie n’existait pas. C’est l’une des premières fois qu’un conflit est couvert à 100% par des nationaux. C’est marquant pour l’histoire de la photographie dans la région. Historiquement, la photographie au Moyen-Orient n’arrive que très tard. Elle n’a jamais fait partie de la culture sunnite, contrairement aux cultures chrétiennes. Par la force des choses, cela a toujours représenté une forme de colonialisme. Le daguerréotype est arrivé par Napoléon III et Horace Vernet pour des documentations archéologiques. Félix Bonfils a incarné ses images par la suite, puis l’américain Lowell Thomas, qui suivait alors Lawrence d’Arabie, a fait les premières images de conflit et de la révolte Ottomane en 1918. Ce n’est pas un photographe jordanien qui a fait les seules images de l’émir Fayçal, c’est Thomas. Dans l’approche des premiers photographes musulmans arabes, il n’y a pas d’élément humain, il n’y a que des paysages. Par la suite les conflits on continué d’être couverts par des photojournalistes occidentaux. Pour moi le point de départ se situe lors de la guerre du Liban de 1985, au moment des premiers enlèvements de journalistes occidentaux, puis par la Palestine en 1989, qui fut notre premier réseau de photographes locaux.
Et ce système s’est établi par la suite…
Effectivement. De conflits en conflits chaque pays du Moyen-Orient voit depuis naître une génération de photojournalistes de guerre. La Palestine, l’Irak, la Libye, même s’ils y sont peut nombreux, la Syrie, et aujourd’hui le Yémen. C’est l’école des agences télégraphiques, et surtout de l’AFP. C’est la seule à avoir vu la régionalisation, et elle agit en conséquence en ouvrant un bureau régional où on parle notamment la même langue, ce qui est quand même pour moi un minimum. À l’avenir nous aimerions former ces photographes pour qu’ils puissent raconter des histoires et dépasser le factuel. C’est une perspective enthousiasmante quand on voit la qualité de certains photojournalistes égyptiens nés de la génération Tharir.
Penses-tu que cela changera les choses ?
Ce n’est ni toi, ni moi, ni eux qui allons changer les choses à court terme. Ce sont les politiques, ou peut-être 2 millions de personne dans les rues. Ce n’est pas prêt d’arriver. Mais grâce à eux, le monde n’aura pas le droit de dire: « Nous ne savions pas. »
Interview réalisée par Jérôme Huffer.
(Avertissement : le diaporama lié à cet article contient des images violentes pouvant heurter.)
INFORMATIONS
URL : http://l-instant.parismatch.com
FB : https://www.facebook.com/instant.parismatch
TW : https://twitter.com/instantmatch
Instagram : http://instagram.com/l_instant_parismatch
L’Œil de la Photographie est partenaire de L’Instant Paris Match.