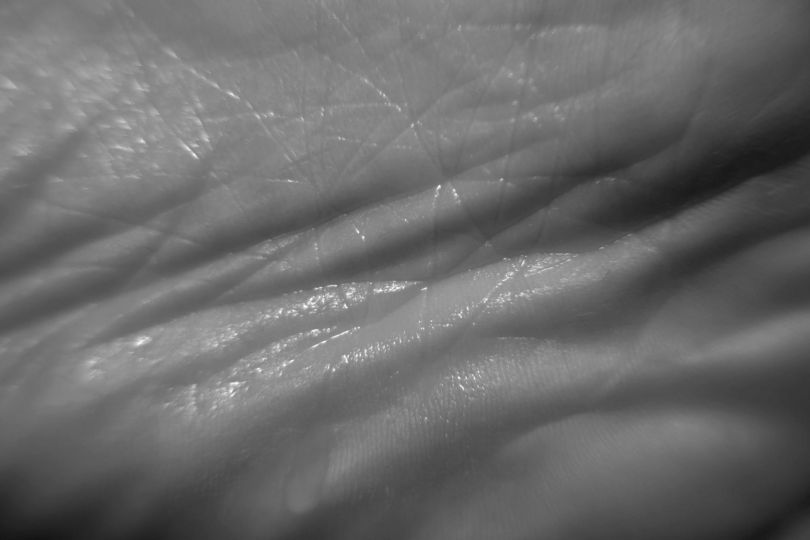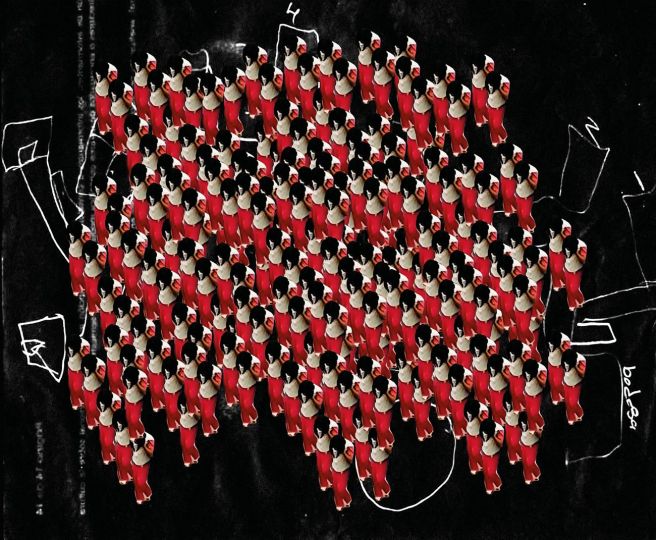Harry Benson est né à Glasgow, dans le fracas des bombes de la Seconde Guerre mondiale. Le destin frappe en 1964, lorsqu’on lui demande de suivre les Beatles en France et lors de leur premier voyage aux États-Unis. Cette expérience marque un tournant décisif dans sa carrière et donnera lieu à certains des clichés les plus célèbres du groupe.
Peu de temps après, pendant la guerre civile en République dominicaine, il capture les deux camps au cours de la même journée. Plus tard, il saisit l’horreur sur le visage d’Ethel Kennedy à l’Ambassador Hotel, juste après l’assassinat de son époux, le sénateur Robert Kennedy.
Harry Benson a photographié un éventail stupéfiant de sujets : onze présidents américains et leurs familles, d’Eisenhower à Obama. Parmi les icônes de la seconde moitié du XXe siècle, Sir Winston Churchill, la reine Elizabeth II, le roi Juan Carlos Ier, la princesse Diana, les princesses Grace et Caroline de Monaco, Andy Warhol, Mohammed Ali et Martin Luther King. Et enfin, dans le monde du show-business, les Rolling Stones, les Who, Greta Garbo, Frank Sinatra, Elizabeth Taylor, Jack Nicholson, Amy Winehouse ou encore Brad Pitt. En outre, il a couvert les guerres du Golfe, en Bosnie, en Afghanistan… La liste est sans fin.
Sara Tasini : Depuis toutes ces années, votre fascination pour la photographie ne vous a jamais quitté. Qu’est-ce qui vous a poussé en premier vers la photo ?
Harry Benson : Peut-être mon père. Peut-être aussi le fait de grandir pendant la guerre, avec toute la frénésie de cette époque-là et le besoin d’y participer. En écoutant les discours de Sir Winston Churchill à la radio, en voyant les photos dans les journaux, j’avais soif d’aller au cœur de ce qui se passait dans le monde.
Il est facile de rester motivé, avec la photographie : l’appareil fait tout ce que vous lui demandez de faire. Il y a la simplicité, l’excitation – rien n’est forcément compliqué. On décide tout seul de ce qui est une bonne ou une mauvaise photo – ce qui compte, c’est ce qu’on aime ou non, et l’opinion des autres n’a aucune importance.
Vous avez un talent naturel pour la photographie. D’où vient-il ?
Je n’ai jamais suivi de formation, mais ce n’est pas forcément une mauvaise chose. J’ai beaucoup appris en travaillant à Fleet Street, à Londres. Il y avait au moins dix quotidiens, et chaque journal tentait de battre le scoop des autres pour l’édition du matin. Cet esprit de compétition ne m’a jamais quitté.
On considère souvent que ce sont vos travaux avec les Beatles qui ont lancé votre carrière internationale. Est-ce que vous estimez que c’est le cas ?
Non, je ne suis pas d’accord. Je ne suis resté avec les Beatles que trois semaines, puis ponctuellement, sur deux ans. Après, je suis allé directement vers l’info pure : les émeutes raciales, Martin Luther King, le Vietnam, l’IRA, et tout un tas de personnages d’horizons très divers. Cela dit, je suis content d’avoir photographié les Beatles : je peux dire que j’ai travaillé sur les plus grands compositeurs du siècle dernier.
Vous avez couvert des événements tragiques, comme par exemple l’assassinat de Robert Kennedy en 1968, et malgré le chaos et le traumatisme, vous restez concentré sur l’image. Faut-il être doué d’un certain détachement pour parvenir à ce résultat ? Quel est votre secret ?
Je me répétais « tu travailles pour l’histoire, ne vasouille pas aujourd’hui, tu vasouilleras demain ». J’ai toujours pu me détacher. Mon métier, c’est de prendre des photos, et de le faire bien. Sans me perdre dans l’affectif. Je connaissais Bobby Kennedy, et je l’appréciais énormément. Mais mon boulot, c’était de consigner ce qui se passait, pour l’histoire. Et je sais qu’il l’aurait compris.
Passons à un registre plus léger : votre travail en couleur numérique est particulièrement intéressant. Est-ce que la photo couleur vous offre des possibilités que le noir et blanc ne vous permet pas ? Et vice-versa ?
Je ne travaille maintenant qu’en couleur numérique, qu’on peut convertir en noir et blanc. Mais je suis heureux que le début de ma carrière ait pu se faire en argentique et surtout en noir et blanc. Quand je parle avec les gens, que ce soit dans les galeries ou dans la rue, je m’aperçois qu’ils préfèrent systématiquement le noir et blanc. C’est le moyen d’expression des photographes, alors que la couleur est celui des peintres. Cela dit, j’ai toujours travaillé en couleur quand les magazines me le demandaient pour leurs couvertures, pour des célébrités, etc.
De nos jours, avec l’avènement d’Internet et des réseaux sociaux, les images sont capturées et diffusées presque instantanément. Comment le métier du photojournaliste a-t-il changé ?
N’importe qui peut se prétendre photographe, pourvu qu’il ait un portable. C’est étonnant, mais ça n’a rien arrangé pour la photographie. Avec l’accélération, les choses se sont gâtées. Une centaine d’images à la minute – quel que soit le chiffre exact – , ça n’implique pas forcément que la photo soit bonne. Pour moi, les photos couleur numériques d’aujourd’hui ont moins d’impact que les photos de guerre argentique. C’est passionnant. Vous pouvez retourner aux images du Vietnam et de la Seconde Guerre mondiale, à tout ce qui a été pris avant le numérique, et pour moi, ces photos sont mieux, c’est tout. Ce n’est que mon opinion, et certains ne la partageront probablement pas.
Cet entretien fait partie d’une série d’interviews menées par la Holden Luntz Gallery, Palm Beach, Floride.
Interview par Sara Tasini
Holden Luntz Gallery
332 Worth Ave
Palm Beach, FL 33480
USA