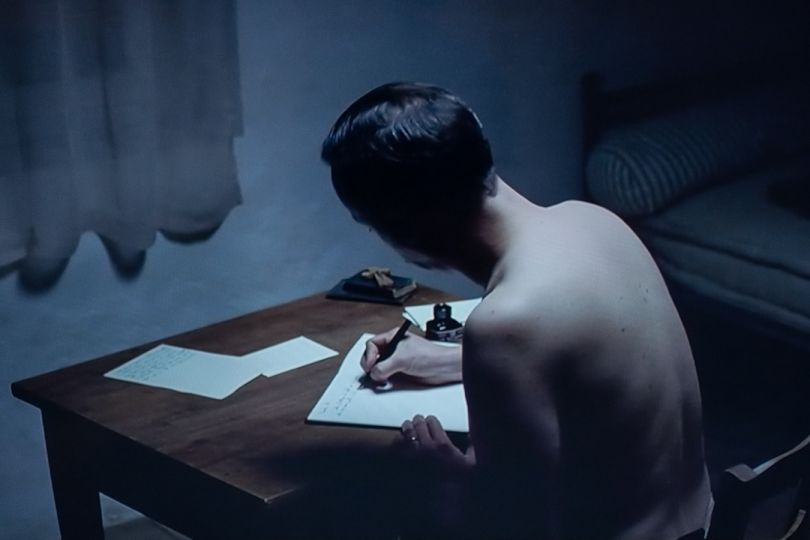Après Clément Cogitore, LE BAL présente la première exposition monographique consacrée à Yasmina Benabderrahmane (1983), lauréate du Prix LE BAL de la jeune création avec l’Adagp et jeune artiste diplômée de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris et du Studio national des arts contemporains Le Fresnoy.
Revenue au Maroc après 14 ans d’absence, Yasmina Benabderrahmane livre avec la Bête un conte filmique, entre métaphore et fragments bruts, marqué par deux personnages de son histoire familiale: l’Oncle géologue, responsable de « la Bête », chantier pharaonique du nouveau Grand Théâtre de la vallée du Bouregreg, et la Grand-mère, un peu plus loin, dans un village ancestral de l’Atlas.
Dans les soubresauts saccadés de la pellicule, son œuvre nous invite à une déambulation sensible, minérale et instinctive où se joue le destin contrarié du Maroc contemporain.
Entretien avec Adrien Genoudet, co-commissaire de l’exposition
A.G. : Tu es revenue au Maroc pour la première fois en 2012, après quatorze ans d’absence. Ce travail est le fruit de plusieurs voyages, et tes images dessinent, en un sens, une cartographie à la fois réelle et intime. D’un côté, elles présentent des personnages, qui sont des membres de ta famille, et de l’autre, des lieux précis, avec lesquels tu as un lien particulier. Peux-tu revenir sur ton arrivée au Maroc et la découverte de « la Bête » ?
Y.B. : Dans les premiers temps, nous nous baladions, avec mon oncle et sa femme, dans la région de Rabat. Un jour, ils m’ont montré le site d’un immense projet, le Grand Théâtre, qui devait être édifié dans la vallée du Bouregreg. C’est une vallée connue sous le nom de Vallée des potiers, réputée inconstructible, car les marais rendent la terre meuble, instable, peu propice à l’édification de bâtiments. On sentait encore la trace de l’homme qui venait prendre l’argile de la vallée pour fabriquer les poteries, les plats à tagine et autres ornements. C’était beau, touchant, et il me paraissait improbable que quelque chose puisse être construit à cet endroit. Le laboratoire de recherche de mon oncle, qui est géologue et travaille pour l’État, a été chargé d’évaluer le terrain et de conceptualiser la solidification des sols tout en respectant le territoire. On ne peut pas s’implanter comme ça, car la terre vit.
Alors ils ont fait venir une roche du Moyen-Orient pour durcir cette matière meuble et créer un nouveau terrain dans lequel l’eau pouvait encore passer et s’infiltrer. Je trouvais cette histoire assez incroyable. Je n’ai compris que plus tard que ce projet du Grand Théâtre avait été décidé par le Roi lui-même. Il avait demandé à Zaha Hadid d’en concevoir l’architecture et elle avait accepté. Le chantier a démarré en 2014 et, malheureusement, elle est morte durant la construction, en 2016.
A.G. : Il y a donc, dans un premier temps, grâce à ton oncle, la découverte de cette vallée marquée par un chantier pharaonique, puis les retrouvailles avec ta famille, dans un village isolé de l’Atlas, lieu où est née et où a vécu ta grand-mère. Elle est devenue, d’ailleurs, un des personnages centraux de ton travail.
Y.B. : Nous ne nous étions pas retrouvées ensemble au Maroc depuis mes 5 ans. Nous sommes allées à Chichaoua, près de son village d’origine, chez sa grande sœur qui a 96 ans. Nous sommes arrivées au moment de l’Aïd.
A.G. : La question de la « matérialité » des lieux que tu filmes est essentielle dans ton travail, dominé par ce rapport avant tout sensible aux éléments. Étais-tu frappée par les lieux en tant que tels ou plutôt par ce qui était en train de s’y jouer ?
Y.B. : C’était une rencontre. La vallée du Bouregreg, je l’ai vue peu à peu s’altérer, être éventrée, être jonchée ; le paysage être plus violenté de jour en jour. Et les habitants qui restent là, qui résistent, qui sont en lutte. Ils manifestent, ils disent : « Mais pour quoi faire ? Pourquoi un tel chantier ? Il y a déjà un théâtre à Rabat. » Après, tu comprends que le projet se fera envers et contre tout, car c’est la volonté du Roi.
Je me souviens aussi, dans les premiers temps, du silence. Quand je visitais le chantier, au début, tout était calme. J’y allais pendant les temps de pause ou durant le ramadan, les gens ne travaillaient pas, ils étaient en train de manger ou de prier. Autour du chantier, on pouvait voir de vastes terrains plats et nus, des routes récentes, des étendues très vides, immenses, rocailleuses. Un désert qui émergeait peu à peu de nulle part, puisque ce n’était pas un désert, avant. Des montagnes apparaissaient, de plus en plus grandes, pyramidales, énormes. Tout était très sec, poudreux, sans eau. L’ensemble manquait de vie car les animaux étaient partis vivre ailleurs. Tout semblait un peu étrange et mes premiers films tentaient de rendre compte de cette étrangeté, de ces nonzones, des choses qui volaient, de la poussière, du silence.
A.G. : Donc, très vite, tu t’es mise à prendre des images ?
Y.B. : Oui, très vite. En 2012, j’ai redécouvert un pays que j’avais complètement oublié, qui avait complètement changé. Même les membres de ma famille, je ne les ai pas reconnus. Tu ne vois grandir personne, c’est ça le plus terrible. Alors je me suis mise à tout filmer, à vouloir tout cristalliser. Cela m’aide aussi à voir à travers un filtre, un écran, un édifice de verre. Ces images font corps avec mon histoire, celle de ma famille. En les regardant, on voit que ma grand-mère a vécu simplement, en lien avec la tradition.
Ayant été élevée par ma grand-mère, ce lien a beaucoup compté pour moi, même si nous habitions en France et non dans le pays où elle est née et a grandi.
A.G. : Le personnage de ta grand-mère, tel que tu le filmes, est aussi un personnage métaphorique. Elle incarne, à travers ses gestes, sa parole, le corps-témoin de la tradition. Comment s’est-elle imposée comme « figure » centrale dans ton travail ?
Y.B. : Ma grand-mère m’a dit un jour : « Tu ne peux forcer personne à être filmé ou à poser pour toi. Mais, moi, filme-moi, je n’ai rien à perdre. Je suis vieille. » Ma grand-mère est une personne très pieuse qui a un rapport au corps très pudique. Les seules parties de son corps que l’on peut voir sont ses pieds et ses mains. J’ai commencé à la filmer dans son quotidien.
A.G. : S’ils sont en un sens opposés dans leurs liens avec le Maroc contemporain, ton oncle et ta grand-mère ne sont pas des figures antithétiques, contraires ou inverses – ils se rencontrent d’ailleurs dans les images que tu as prises lors de la fête de l’Aïd.
Sont-ils pour toi deux figures, deux métaphores des différentes temporalités du Maroc ?
Y.B. : Cela reste, avant tout, la relation entre une mère et son enfant. Je pense ces deux personnages plutôt comme une paire, l’un n’allant pas sans l’autre.
Lorsque j’évoque ce grand chantier, je parle souvent de deus ex machina, parce que tous ces bouleversements du paysage nous projettent dans un futur improbable, fantasmé. Ce qui m’intéresse d’autant plus dans la construction d’un théâtre, c’est d’y voir, avec toutes ses entrées et sorties, côté jardin et côté cour, un peu comme une grande scène continue où se joueraient la vie et l’infra-vie. J’imagine des milliers de fourmis qui édifient, sur un immense terril, un ouvrage démesuré, hors d’échelle, imaginé par le Roi. Le travail du corps, sur un chantier comme celui-ci, reste, non pas inhumain, mais à la limite du surhumain. Même si la machine est là, le gros du travail est réalisé par les ouvriers, leurs corps et leurs gestes minuscules mis bout à bout. Et il en est de même, selon moi, pour les rites ancestraux. Pendant la fête traditionnelle de l’Aïd, j’ai filmé ma grand-mère et mon oncle « sacrifier » une bête – une bête sacrée. Tous deux, ils refont chaque année les mêmes gestes, précis et ancestraux, du Prophète. Ce rituel du sacrifice est ancré dans la vie des membres de ma famille. C’est un moment de partage. Et cette bête est nourricière, le moindre morceau est utilisé.
A.G. : Ton travail est traversé, de bout en bout, par la double présence de la « bête » : à la fois la Bête en tant que chantier mécanique, moderne et dévoreur, et la bête traditionnelle, le mouton, que l’on sacrifie de génération en génération pour perpétuer le rite…
Y.B. : Tout le projet est marqué, depuis le début, par cette matière visqueuse, par cette présence de la chair et, petit à petit, des liens visuels vont s’établir avec les textures du chantier, la coulée du béton, le bitume fondu, la carapace du bâti… Un moment a vu la jonction réelle de ces éléments. En 2016, le chantier a été paralysé suite au décès soudain de l’architecte. Pour « conjurer le sort », les autorités ont fait sacrifier 100 moutons et veaux blancs sur le site des travaux. On fait couler le sang pour purifier, contrairement à l’eau, qui est là pour féconder. Cette symbolique des fluides m’a beaucoup inspirée. Ce lien au sacré me plaît, j’ai grandi dans une famille très pieuse où il prenait naturellement place dans la gestuelle du quotidien, la mémoire des corps. J’ai choisi de le montrer par fragments pour lui donner une portée générale, presque universelle.
A.G. : Quand tu vois la situation du Maroc contemporain, tu n’as pas envie de prendre ta caméra, de filmer, de documenter cette réalité-là ?
Y.B. : Non, cela me paraît trop dur, trop difficile. Je suis comme choquée, tétanisée, voire même agressée. Et il y a la barrière de la langue. Je ne comprends pas l’arabe littéraire. Alors, je suis là, je reçois, j’assimile. Je suis dans le sensible, je cherche ce qui, dans le réel, se sédimente en moi avec le temps. Je ne suis pas dans le cinéma direct. Sinon, j’aurais été journaliste ou anthropologue. Affronter le monde par métaphores est ma façon à moi de résister. Je pars de mon cercle familial ou intime, car me confronter d’emblée à une dimension plus large ne me convient pas. Tout, pour moi, se passe à cette échelle. J’opère une forme de transposition, de la cellule au tout.
A.G. : Comment expliques-tu ton choix d’utiliser parfois de la couleur ou du noir et blanc ? Ont-ils pour toi une dimension symbolique ?
Y.B. : Tourner en noir et blanc me permet de créer un lien avec le dessin par le grain tout en ayant un rendu sculptural. On est dans une valeur temporelle « neutre », qui confère une dimension d’archive aux images. Pour certaines, je n’ai pas envie qu’elles marquent clairement hier, aujourd’hui ou demain. J’aime ce qui crée le trouble. Dans Opération Béton de Godard, tourné en 1953, il y a des plans quasi similaires à ceux que j’ai tournés sur le chantier. On retrouve les mêmes machines, les mêmes types de tapis roulants, de processus mécaniques… J’aime bien le fait que le spectateur s’interroge, qu’il se demande si ces images du Grand Théâtre appartiennent vraiment au régime contemporain de représentation d’une utopie architecturale. L’image, pour moi, comme la réalité, doit demeurer une énigme. Une énigme non anodine.
La Bête, un conte moderne par Yasmina Benabderrahmane
Exposition jusqu’au 12 avril
LE BAL
6, Impasse de la Défense
75018 Paris