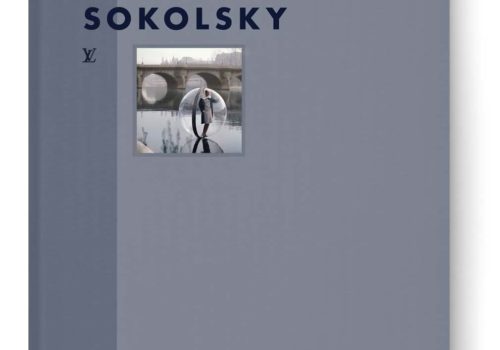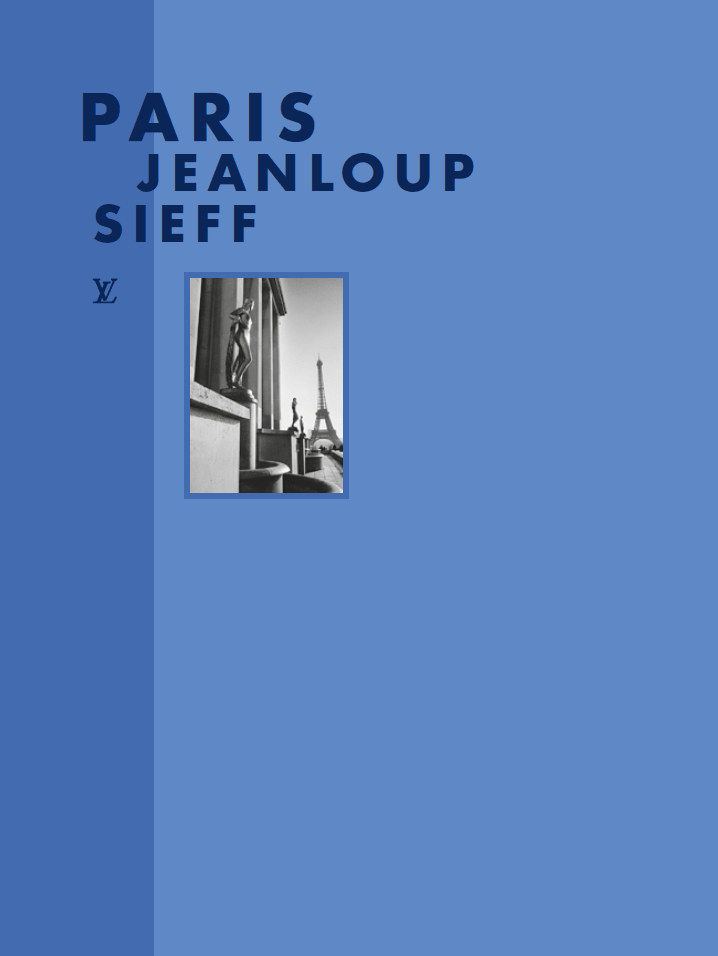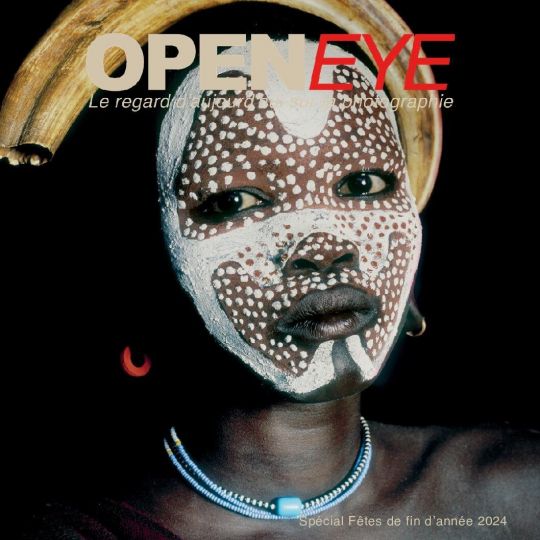Synonyme d’art de voyager depuis 1854, Louis Vuitton continue d’ajouter des titres à sa collection « Fashion Eye ». Chaque livre évoque une ville, une région ou un pays, vu à travers les yeux d’un photographe. La collection revient, avec ce troisième opus consacré à Paris, sur deux séries iconiques réalisées par Melvin Sokolsky.
Après le Paris de Jean-Loup Sieff publié parmi les premiers ouvrages de « Fashion Eye » et le plus récent et drolatique regard de Feng Li, la collection dirigée par Julien Guerrier rouvre le dossier « Melvin Sokolsky ». Peut-on encore regarder ces œuvres, tirées des séries mythiques que sont devenues « Bubble » (1962) et « Fly » (1965), avec un regard neuf ? L’émerveillement est-il encore présent ? La grâce opère-t-elle toujours ?
À l’audience qui attendrait un combat de prétoire, un véritable procès à charge, une litanie de mauvaise foi et de coup bas, il n’en sera rien. C’est un non-lieu ou plutôt, un livre qui existe, qui se tient. L’édition est de bonne foi et le jury convaincu. La magie, soixante ans après leurs parutions dans Harper’s Bazaar, opère toujours.
Il faut rendre grâce notamment au texte d’Alain-Paul Maillard. Le critique recontextualise avec brio l’atmosphère de l’époque et le caractère aventureux de Melvin Sokolsky. En 1962, le jeune photographe américain est encore une tête brulée, un autodidacte aux idées radicales et clivantes.
Il rejoint la cohorte de photographes du Harper’s Bazaar. Il a rejoint en 1959 le journal à l’invitation du nouveau directeur artistique Henry Wolf et officie au côté des indéboulonnables Richard Avedon et Lillian Bassman, ou du tout aussi fraîchement convié Saul Leiter.
Comme Leiter, son regard apporte de la fraîcheur, des idées neuves. Mais Sokolsky rencontre également des oppositions à ses projets jugés irréalisables, couteux. Il doit combattre et défendre ses choix, notamment les mannequins de ses séries. On juge ses photographies étranges, on lui refuse certains travaux par snobisme, comme une série photographiée dans le métro (« Parce que la direction ne voyait pas ses abonnées prendre le métro »).
Pour autant, Sokolsky a la confiance absolue de son directeur artistique : « Il ne s’intéressait qu’à ma vision personnelle et artistique. L’essentiel était que les gens regardent mon travail et disent — c’est un Sokolsky », se souvient-il. La série « Bubble » en est l’exemple.
Celle-ci repose entièrement sur la légèreté d’une bulle, les poses aériennes et subtiles du modèle enfermé dedans et une imagerie tout aussi élégante de Paris. La réussite du tournage repose autant sur la performance naturelle de Simone d’Aillencourt que sur les aspects techniques et matériels de celui-ci.
Dans un entretien publié dans nos pages, Sokolky se rappelle sa légèreté. « Simone était plus à l’aise dans la bulle que si elle était la pilote d’un vaisseau spatial ». Elle s’oppose en cela à des modèles surprises par la bulle soulevée de terre, empruntée, apeurée ou simplement mauvaise actrice.
Le tournage à Paris s’avère plus compliqué à gérer. Déplacer et faire voler la bulle et son mannequin s’avèrent long et fastidieux. Chaque nouvelle prise dans Paris demande à la grue une bonne heure de déplacement. Les badauds s’attroupent, admirent, rameutent… Et l’équipe au côté de Sokolsky se limite à celle de son studio, cinq à sept personnes tout au plus. « Si vous tentiez de réaliser la bulle de Paris 1963, cela coûterait des centaines de milliers de dollars aujourd’hui ; sans parler du coût exorbitant de l’assurance. »
La réussite de « Bubble » tient également au cadre parisien. Si Paris est au début des années 1960 déjà largement mis en lumière par la photographie ou le cinéma, la photographie de mode américaine cantonne sa représentation à ses grands monuments. Sokolsky tient à en montrer une version intime comme élégante et puise dans la lumière hivernale parisienne qui, quoi qu’en disent les humeurs plus grises que le ciel supposément qualifié, demeure magnifique quand il est crevé de rayons timides.
« J’oserais dire que le succès d’une image est basé sur l’harmonie entre l’idée et l’éclairage. Il y a une bonne lumière pour tout », déclara l’artiste à la galerie Izzy. Et celle sans fard et sans projecteur de Paris lui suffit. Le ciel ajoute à l’atmosphère surréaliste, inspirée de discussions avec Dali, dans la lignée de ses recherches et fascinations personnelles.
Deux ans plus tard, en 1965, la mannequin Dorothy McGowan crève la bulle et se retrouve suspendue à un corset spécial, soutenu d’anneaux et tressé de câbles d’acier, dans l’air. C’est la série, tout aussi mythique, « Fly ». « Il n’y a rien d’impossible pour Melvin quand il a une idée », déclara McGowan.
Il demeure cette question, et si l’on peut dire, la question : pourquoi juge-t-on ces deux séries iconiques ? Que trouve le regardeur dans ces images ? La réponse vient peut-être de leur allégresse, de cette immense joie qui puise dans la légèreté, la danse, la grâce… Comme un leitmotiv dans le travail de Sokolsky, jugé peut-être avec dédain aujourd’hui, à l’heure où il faut oser, choquer et faire rupture…
« Quand je pense à ma vie de photographe, le désir le plus important que j’ai est de créer des images qui donnent au spectateur un sentiment d’espoir et de joie. Je veux que le spectateur regarde mes photos et se sente bien. Pensez à vous réveiller et à regarder une de mes photos, et ça vous lance pour une belle journée », dira l’artiste à Mario Lopez Pisani.
Melvin Sokolsky — Paris
Éditions Louis Vuitton, 2021
Collection « Fashion Eye », dirigé par Julien Guerrier
Édité par Michel Mallard
Graphisme de Lords of Design
Bilingue français-anglais, 96 pages.
Disponible en librairie ou en ligne