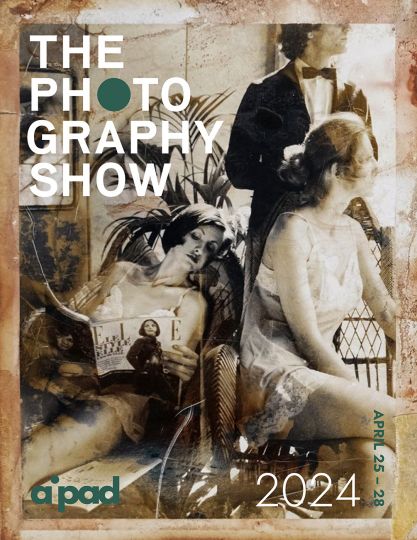Vincent Delbrouck (belge, né en 1975) s’est rendu à plusieurs reprises dans la région himalayenne, entre 2009 et 2014. En 2010, il a vécu un an à Katmandou avec sa famille. Il s’est laissé guider par l’énergie des lieux et d’une nature omniprésente dans son travail, pour imprégner son langage visuel. Son travail est une succession poétique des petites choses de la vie, dont il embrasse toute la diversité avec magie.
Comment est née l’idée de ce travail de réflexion sur l’Himalaya ?
Je pense que c’est venu naturellement. Nous sommes allés rendre visite à mon beau-frère, qui habite à Katmandou où il donne des cours de tibétain classique dans un monastère bouddhiste. On a aimé l’énergie des lieux et, avec ma compagne et mon gamin, on a décidé de retourner y vivre une année. Mon travail naît plutôt dans l’expérience totale d’un lieu que dans une idée. Cette expérience de vie s’accompagne de désirs et d’un imaginaire qui me hantent alors pendant une longue période et m’amènent là où je veux aller dans mon travail photographique, en créant spontanément un espace de création. C’est quelque chose qui se vit dans différentes régions de mon corps, et peut prendre des formes multiples et contradictoires, entre image et écriture, vécu corporel assez méditatif et un tas de pensées. Un truc un peu bizarre qui se rapproche de la vie qui bouillonne plus que d’une idée conceptuelle ou documentaire figée. Quelque chose de super poétique aussi.
Quel est ton rapport avec la réalité ? Est-ce que pour toi tu montres dans ton travail la réalité telle qu’elle est, comme dans la pratique Dzogchen ?
J’aime bien cette question. Elle touche à l’ambiguïté du travail artistique. Quelle est la nature de la réalité, sa charge en illusions positives ou négatives ? Comment s’échappe-t-on vers les bords pour revenir au centre du moment présent ? Tout cela est assez complexe et simple en même temps. On le vit, mais en mots, c’est difficile à décrire. La vie m’intéresse dans toute sa sensualité, ses fluides, ses mouvements passionnés, ses silences, et c’est de cela que j’aime me rapprocher en photographiant. Sans créer de hiérarchie entre les objets, personnes, animaux ou plantes. Ce qui est au centre de la pratique Dzogchen, c’est peut-être cette prise de conscience que tout est déjà parfait comme c’est, d’une certaine façon. Chaque être possède cette nature parfaite de Bouddha, comme on dit, et elle est simplement cachée par le flot des pensées qui forment la vie ordinaire de chacun. Il n’y a pas à rêver d’un ailleurs sans souffrance, pas de réelle transformation à accomplir pour enfin atteindre un éveil paradisiaque mais juste un chemin cahoteux qu’est la vie et dont il est bon de contempler la nature profonde telle qu’elle est, ici et maintenant. J’aime cette sensation d’habiter entièrement ce flux dans la prise de vues, et de voir la beauté en toute chose. Pas pour la changer ou lui plaquer une symbolique ou un message. Bien sûr, une forme apparaît, mais il me semble qu’elle naît d’elle-même dans ce moment assez méditatif. Comme les grilles d’images au mur d’expo peuvent apparaître aussi assez spontanément lors d’une mise en place intuitive. Quand l’énergie est bonne, tout cela se met en place et l’ego disparaît, les soucis aussi, il y a une concentration ou une contemplation de ce qui est. Une action (qui peut être collective) que je trouve admirable et dont j’éprouve un élan et une passion immense à partager avec d’autres. On dirait que le vécu et l’imaginaire se combinent pour laisser apparaître l’essence même de la nature, au-delà du paysage, de la photographie pour elle-même. Les petites choses et objets de la vie usuelle me fascinent lorsqu’ils émergent dans la lumière chaude des tropiques ou de l’Himalaya. Ils se chargent d’un mystère immanent. La réalité devient moins brutale, plus souple et source de curiosité.
Selon toi, une photo est-elle objective ?
Certainement pas. Mais qu’est-ce que l’objectivité ? Y a-t-il une seule façon de regarder ou d’envisager la réalité ? Je crois que chacun a sa propre expérience du réel et l’image n’est que la trace un peu magique d’une confrontation parmi d’autres qui peut se relier à des souvenirs ou des images qui appartiennent à d’autres, ceux-là qui se font spectateurs et acteurs de leur propre vécu dans la contemplation de cette photographie. Je n’aime pas les étiquettes qu’on plaque sur les choses ou les gens. La vérité inculquée par la force ou par le marketing est une forme d’attitude imbécile et pauvre de sens. Le doute subsiste parmi toutes les choses auxquelles on croit et cette foi en la vie constamment remuée est une forme d’ouverture à ce qui vient et à ses propres émotions, aux couleurs du spectacle incessant de la réalité qui ne peut qu’être vécue puis mourir. Une forme de roman ouvert aux subjectivités apparaît alors, où chacun se connecte comme il veut à partir d’une source qui s’écoule lentement.
Qu’essaies-tu de transmettre ?
Une énergie, je crois. Un truc de fou qui tourbillonne en moi et que j’ai besoin de partager sans trop avoir d’emprise au final sur la réception des images et des mots que j’écris. Une curiosité pour tout, aussi. Et une invitation à regarder peut-être autrement des lieux que je traverse et que je vis intensément (seul ou avec d’autres) et qui, au final, peuvent vraiment s’incarner en chacun de nous sous forme de sensations et de souvenirs, aussi illusoires soient-ils. Quelque chose qui peut amener à se reconnecter à ses propres sensations, ses propres rêves, douleurs, etc. Une forme d’empathie subtile et complètement explosée avec la nature poétique des éléments (feu, eau, vent, terre). Un amour de la nature qui me fait du bien. Une (anti)poésie qui soigne du doute sur la teneur en ondes positives qu’on rencontre dans la vie. La passion du féminin, aussi. Mes parts d’ombre explorées peur à peu, etc. etc.
Chaque présentation de ton travail est différente. C’est pour être en accord avec le principe bouddhiste d’impermanence ?
Non, c’est parce que ça m’ennuie de refaire tout le temps la même chose. Je pense néanmoins que ce principe s’incarne dans toute chose donc naturellement il se vérifie dans mon travail et dans mes installations et je ne cherche pas à empêcher cela. Je contrôle déjà assez de choses pour devoir encore y accorder aussi une importance forcée. L’impermanence est un beau mot, je trouve, sinon. Celui qui me parle le plus sans doute dans le bouddhisme. J’aime aussi cette idée de revisiter encore et encore ce que j’ai pu faire et je ressens sans cesse un grand besoin de créativité (qui est synonyme d’envie d’être surpris, d’être curieux, de recherche incessante d’une beauté qui ne se répète pas et que je retravaille différemment sur des supports divers accumulés peu à peu au fil du temps : photos, papiers, pages de carnets, photocopies, etc.).
Quel genre de matériel utilises-tu ?
Deux boîtiers Fuji point and shoot (35 mm et 4,5/6) et des films, du marker rouge, du tape, de l’écoline, des cahiers d’écoliers, des dizaines de bics pour écrire, etc.
Comment définirais-tu ton travail – ce rapport contemplatif à la nature ?
Une espèce de méditation mêlée à des soubresauts de la pensée poétique d’un oiseau…
Quelles sont tes influences, qu’est ce qui te nourrit : littérature, philosophie, photographie ?
La littérature me nourrit énormément, principalement la littérature américaine : Raymond Carver, Jim Harrison, Charles Bukowski, Ken Kesey… C’est complètement dingue comme tremplin pour l’imaginaire, la littérature. Un monde s’ouvre devant moi qui me paraît coller parfaitement à mes rêves les plus grandioses d’amours ordinaires, de sexe et de silences forestiers. J’arpente ces terres parfois arides et je m’y sens plus que bien, ça me donne l’énergie pour revenir à la vie et à la photographie. J’y suis bien, concentré, libre !
Tu pratiques aussi le massage Shiatsu. Y a-t-il un lien avec la photo pour toi ?
Oui. Un lien étrange sans doute. Une exigence, une forme de concentration, de position dans l’espace et d’empathie totale à ce qui vient. Ça m’aide aussi à guérir (de moi-même avant les autres, peut-être), à me libérer des contraintes de la vie pour faire silence et juste être là, connecté. En équilibre, parfois improbable et surprenant. J’aime ces connexions.
Tu as également créé le mouvement Wilderness, associations de photographes belges. Quelle est la démarche là-derrière ?
Nous avons créé cet espace collectif avec Olivier Cornil pour la foire de photographie Nofound pendant Paris-Photo. D’autres projets collectifs ont suivi. C’était plus une plate-forme ouverte aux vents, qui est d’ailleurs en état d’hibernation pour l’instant. Je ne sais pas si elle va se réveiller un jour de l’hiver. Parallèlement, j’ai créé le label d’auto-édition Wilderness avec Daniel Piaggio Standlund, un ami photographe dont j’adore le travail. Plusieurs livres ont été publiés et, parmi eux, les deux premiers volets de ma trilogie himalayenne : As Dust Alights et Some Windy Trees. Je travaille actuellement sur le dernier opus qui sortira cet été : Dzogchen. Il y aura beaucoup de textes (short stories, poèmes…) dedans. Et on va aussi sortir le premier livre de Laura Lafon. Un projet super excitant !
EXPOSITION
FoMu – FotoMuseum Provincie Antwerpen
Waalsekaai 47 – 2000 Antwerpen
Jusqu’au 1er février