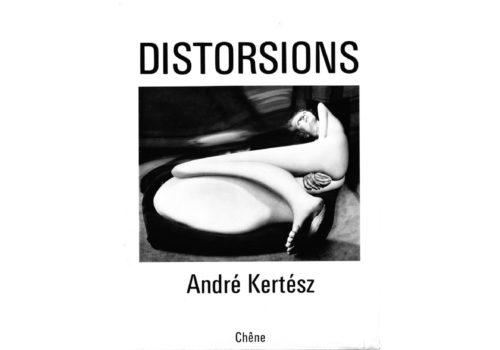De manière assez surprenante, en ces deux décennies où se développèrent Dada et le surréalisme, ces deux mouvements manifestèrent peu d’influence sur la photo de nus, du moins celles qui furent retenues pour être imprimées et éditées en albums. Bien sûr, Raoul Ubac et Georges Hugnet principalement, Wols, Erwin Blumenfeld et Dora Maar, citerai-je Man Ray ?, ont produit à cette époque des clichés en tout point fantastiques, surréalistes même pour certains (Cf. l’excellente mise au point de Christian Bouqueret, dans la collection Photo Poche, n° 116, 2008), mais cela dépasse le cadre de notre intérêt car aucun, sauf Jindrich Styrsky (Émilie vient à moi en rêve, Prague, 1933 ; introuvable) n’a été publié à l’époque en volume.
Le poids du surréalisme en revanche se manifestera plus massivement et nettement plus tardivement dans l’édition, comme nous le verrons dans notre prochaine chronique. Je ne pourrai donc mettre en avant maintenant, dans cette tranche chronologique, que le cas particulier, plus ou moins bien connu, mais en tout cas incontournable, des Distorsions de Kertesz (Paris, éd. du Chêne, 1976 ; introduction de H. Kramer).
Au début des années 30, la réputation d’Andor Kertesz, arrivé à Paris de sa Hongrie natale quelques années auparavant est déjà bien établie : outre qu’il assure en grande partie l’apprentissage de son compatriote Brassaï, alors encore peintre, il a récemment bénéficié d’une exposition individuelle dans une galerie parisienne de photographie, et en 1932 ce sera à la prestigieuse adresse du galeriste Julien Lévy à New York; il est encensé par Florent Fels, chroniqueur photo de L’Art Vivant, prend part au 1er salon indépendant de la photographie, représente la France à Film und Foto à Stuttgart . C’est alors que le magazine illustré Le sourire, un rival du Rire créé à la fin du siècle, et qui a évo- lué peu à peu de son origine satirique vers une tendance légère et grivoise affirmée, lui commande une série de photographies à publier. Sans aucune précision particulière. Que se passe-t-il alors qui l’incite à se livrer avec tant de détermination à une expérimentation totalement inédite, ‒ à laquelle son ami le brillant journaliste Carlo Rim lui avait cependant frayé la voie dans un article sur Luna Park publié dans VU quelques années auparavant ‒, expérimentation qui le mènera à diriger son objectif non sur ses modèles nus (ce qui lui était fort peu coutumier), mais sur leur image reflétée dans un miroir déformant (ce qui le lui est encore moins).
Un miroir alternativement concave et convexe dans sa hauteur, et même cabossé dans sa largeur, – comme on en trouvait couramment alors dans les parcs d’attraction (je me rappelle de ceux du Jardin d’acclimatation lors de mon enfance), les Luna Parks et fêtes foraines comme la Foire du Trône ; extrêmement déformant, quant à ceux (il y en eut deux dans les débuts, de même que les modèles) auquel Kertesz eut recours, monstrueusement déformant même. Nous étions en 1933, quand douze « déformations » (c’est le nom sous lequel elles furent désignées pendant de nombreuses années) furent publiées dans le numéro du début mars du Sourire, sous le titre qui ne devait assurément rien à André Kertesz de Fenêtre sur l’au delà. Une petite sélection de ses tirages (les négatifs étaient sur verre) fut exposée dans la galerie parisienne Braun, où ils rencontrèrent un accueil contrasté, ‒ d’engouement mitigé à répulsion nauséeuse.
En tout cas la réception de ces nouveautés, si surprenantes et qui avait de quoi défrayer la chronique, fut loin d’être apathique puisque plusieurs parutions emboîtèrent le pas à ce magazine : le n° 37 de AMG (1933), avec une double page comportant cinq photos, et la mythique publication Formes nues, rivale du Nus de D. Masclet (1932), qui en 1935 consacra deux de ses 96 planches, côte à côte avec Boucher, Brassaï, Caillaud, Verneuil, au milieu des solarisations de Man Ray et Moholy-Nagy, à reproduire deux des « déformations » du photographe hongrois. Quant au journal spécialisé londonien Photography, il lui dédia un article très réfléchi dans son numéro de juin 36, et si « distorted » y fut utilisé à plusieurs reprises, à aucun moment le mot » distorsion » ne fut prononcé alors pour qualifier l’invention de Kertesz.
Contrairement à ce que certains pourraient être tentés de penser, c’était bien de la photo. Il y a eu un objectif, une plaque sensible, un œil et un déclencheur ; il y a eu surtout un miroir pour venir com- pliquer des choses simples et livrer une galerie de chimères à la place d’un album de nus plus ou moins gracieux et bandants. Ce foutu miroir qui transforme un sein en ballon de baudruche, une jolie brune en démon boschien ou en super-Pinocchio. Ce n’est ni beau, ni touchant, ni sensuel; tout juste bizarre, baroque, grotesque comme le qualifie le rédacteur de Photography, plutôt tératologique que surréaliste. Ces clichés constituent le catalogue exhaustif des métamorphoses les plus angoissantes, bien dans la lignée de la nouvelle de Kafka publiée quelques années auparavant. En plus, ici, ces altérations ne sont ni régulières, ni constantes : les bras (ou les jambes) ressemblent à des queues, le pied droit fait 60 cm tandis que le gauche n’en dépasse pas cinq. C’est à proprement parler la fabrique des monstres, même si parfois subsiste un organe épargné, reconnaissable, rare- ment. Kertesz a dû se trouver interloqué quand, l’un après l’autre, il visualisa les clichés qu’il avait réalisés, mais il a pu aussi prendre peur en voyant ces truies et ces morses vautrés enfantés par les épousailles inédites de son objectif halluciné et de ce miroir envoûté.
Mais la roue tourne. Et bientôt Kertesz peut s’imaginer mieux réussir sa carrière outre-Atlantique et souhaiter également se mettre à l’abri du péril nazi qui va croissant ; et, appelé par Keystone, puis ultérieurement recruté par Condé Nast, il va s’envoler vers New York, accompagné de sa femme.
Mais même si ce voyage prévu pour une durée limitée va durer une vingtaine d’années, sa sensibilité pas plus que son imagination ne réussiront à mordre vraiment ni sur les professionnels, ni sur les amateurs américains. Tel un immigré au deuxième degré, la plupart de ses effets (mis à part ses ap- pareils) restèrent à Paris. Les déformations y furent laissées, abandonnées, oubliées… jusqu’à ce que, une petite trentaine d’années plus tard, il les retrouve, exhume, fasse nettoyer de leurs oxydations. Rendons-lui justice quand même, c’est grâce au public américain que finalement elles trouvèrent leur nom de distortions (avec un t en anglais) et que, quarante-trois ans après être sortis d’un miroir de foire et d’un œil magique, les Distorsions furent divulguées à la connaissance du public international grâce à l’éditeur new-yorkais Knopf et au Chêne parisien, alors déjà spécialisé en photographie ; et grâce aussi en grande partie au photographe maintenant vieillissant et guère plus actif, mais incontestablement très affairé à cette parution pour laquelle il avait dû patienter tant d’années. Autrefois Kertesz avait actionné deux cents fois son déclencheur à l’hôtel Esmeralda où il œuvrait ; les plaques avaient été alors numérotées de #1 à #200 pour leur conférer une identité ; ce pourquoi depuis la parution du livre, elles sont désignées de ce numéro comme d’un titre inamovible (D’autres s’appellent « Impression. Soleil levant » ou « La mort de Sardanapale »… C’est affaire de goût). Avant-guerre ou revenu en France, les plaques (qui pour la plupart étaient à considérer comme brutes de fonderie), Kertesz s’employa à recadrer lui-même ses prises de vue, aussi bien pour en retailler un grand nombre que pour en éliminer scories et détails superflus). C’est ainsi que trois variantes du même cliché sont même parfois connues.
Pour illustrer cette aventure peu commune, avec justesse et délicatesse, il y a deux écueils à craindre : ne retenir que ce qui est peu déformé, les clichés où on discerne encore des jambes et des bras, un tronc, une tête que sais-je ?… et des seins aussi (ce sont des femmes ! après tout). Et on pourrait à la limite imaginer qu’il s’agit d’une obèse pathologique ; mais une obèse quand même, pas un ectoplasme (#93, 164, 157…). La seconde difficulté, inverse, est de sélectionner des photos représentant des corps totalement difformes où parfois à peine un membre ne reste identifiable, comme par exemple « l’hippocampe » #82, le 92, le 117, la carcasse de veau #138 qui n’aura d’autre consolation que d’avoir un admirable sein ; ou quand c’est devenu l’absolu règne de l’indiscernable quand il ne reste plus au bout du bout qu’un ultime indéfrisable à reconnaître (#50) ou une gélatine informe où surnageraient quelques bouts de membres non identifiés.
Alain-René Hardy
L’ivre de nus
[email protected]
PS : Depuis la parution des éditions américaines et françaises des Distortions / Distorsions il y a un demi-siècle, ces extravagances photographiques ont fait couler beaucoup de salive et d’encre. Une requête « Kertész Distorsions » sur Google ramène plus de 40 mille résultats ! parfois des contributions critiques analytiques importantes.
Pour qui voudrait approfondir, je recommande la lecture du chapitre correspondant du catalogue de l’exposition Kertész au Jeu de Paume (sept. 2010-janv. 2011 ; Hazan edr) dû à Michel Frizot, à qui je dois beaucoup de mes connaissances.
A-R. H.