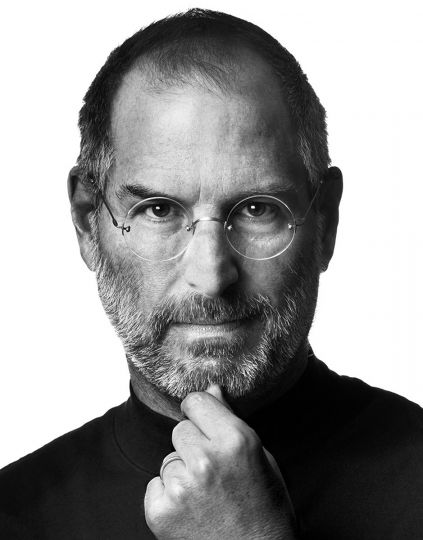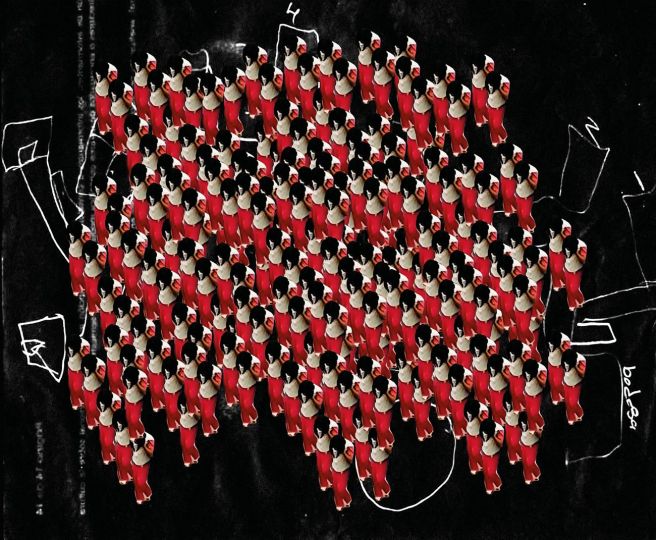Entrer dans l’univers de Wolfgang Tillmans, c’est se retrouver au milieu d’une conversation ; c’est poser des questions, et être interrogé à son tour. Ce qui frappe d’emblée le visiteur de l’exposition présentée à la Tate Modern (jusqu’au 11 juin) est qu’elle se démarque des autres. Contrairement à la plupart des expositions monographiques, celle-ci n’est pas organisée par thème ou sujet, ne vise pas à l’exhaustivité, et ne met pas en avant le « développement de l’artiste ». Son but n’est pas de dégager une quelconque progression en termes de techniques ou de matériaux, ni de proposer une étude critique d’un travail. À proprement parler, il ne s’agit pas d’une exposition. C’est une installation conçue par l’artiste pour s’intégrer dans l’espace de la galerie ; et elle semble, en tant que telle, renverser le concept d’exposition : plutôt que se concentrer sur l’artiste, la sélection des œuvres, conçue comme un montage complexe, polysémique, s’oriente vers l’extérieur pour questionner sa propre place au sein du musée et dans le monde post-Brexit, confronté à la crise des réfugiés, aux guerres mondiales, à la terreur, à la résurgence des nationalismes et des gouvernements de droite.
Chaque salle offre un arrangement spatial d’images, parfois produites à des années d’intervalle, et utilisant différents media et formats : impression à jet d’encre sur aluminium, photocopies laser montrant la dégradation progressive de l’image, épreuves chromogènes. Les images, encadrées ou non, maintenues par des pinces-notes ou des bandes de ruban adhésif, sont de taille variable : photographies 4×6, photocopies A4, tirages surdimensionnés. La différence des formats accuse la rupture avec les modes de présentation traditionnels, non pour interroger ces modes en une sorte de geste méta-curatorial et auto-réfléxif, mais plutôt pour questionner les interprétations usuelles et initier un dialogue constructif. Des images abstraites et figuratives (catégories sans cesse problématisées par Tillmans) côtoient des tables du Truth Study Center où se combinent des travaux de l’artiste (parfois identiques à ceux qui se trouvent, à une échelle différente sur les murs), des coupures de journaux, des articles extraits de revues scientifiques, des images trouvées ici ou là, des artefacts, etc. Ces archives sous verre manipulent imperceptiblement le corps du spectateur, mis en présence d’un plan horizontal en même temps que de l’accrochage mural. L’absence de hiérarchie dans l’organisation des matériaux, le chevauchement, parfois, des feuilles de papier et des images et le manque d’unité empêchent une lecture linéaire, obligeant le spectateur à dialoguer activement avec les mots et les images, à passer d’un côté des tables à l’autre afin de donner un sens aux textes et illustrations autant qu’aux lacunes et espaces entre eux.
Julie Ault a intitulé l’un de ses essais sur Tillmans The Subject is Exhibition.[1] La pratique de Tillmans, comme elle le souligne, remet en question la division moderne des tâches, celle du curateur étant incorporée au travail de l’artiste : consciemment, Tillmans rompt avec l’accrochage auratique, à hauteur des yeux, ainsi qu’avec la disposition régulière des travaux visant à leur donner le statut de chefs-d’œuvre. Telle que la conçoit Tillmans, une exposition est un laboratoire, un espace d’expérimentation plutôt qu’un sanctuaire abritant des œuvres immuables ou une exposition qui serait son propre but. Dans l’installation, l’œuvre est mise à l’œuvre. Comme Tillmans l’explique dans un message aux critiques d’art : « Eviter ce que j’appelle un langage imposant a été un choix clé que j’ai pris en 1992, dans l’idée d’utiliser l’espace de la galerie comme un laboratoire où installer mes photos, voir comment elles agissaient les unes sur les autres, en public, tout en n’étant que des feuilles de papier nues ».[2]
La Salle 14, l’une des plus remplies et la dernière de l’exposition, peut être considérée comme faisant partie d’une chaîne de laboratoires, interconnectés par le réseau d’analogies qui s’est constitué dans la mémoire du visiteur. Le centre de la salle est occupé par deux tables du Truth Study Center, qui contiennent plusieurs images sans titre, des imprimés et un ensemble d’enveloppes timbrées marquant différentes périodes de l’histoire allemande. L’un des imprimés pose directement la question : « Quel âge as-tu ? » Notre âge, mettons, un jour de juin 2017, devient le pivot d’un calendrier inhabituel. Sur d’autre imprimés, l’on peut lire : « Oscar Niemeyer est mort en 2012, âgé de 104 ans/104 ans avant sa naissance, c’était l’année 1803. » « A présent, 1980 est aussi loin derrière nous que la Seconde Guerre mondiale l’était en 1980. » « L’année prochaine, 1991 sera aussi loin derrière nous que le Civil Rights Act l’était en 1991. » Ces parallèles historiques sont comme les images à l’encre du test de Rorschach, se déployant, à partir d’un point donné du temps, sur plusieurs décennies, afin de constituer l’image d’une période dans l’esprit du spectateur. Chacun a une interprétation différente de ces pivots, et une vision différente du temps qui les précède. Selon que l’on associe, par exemple, l’année 1980 à la naissance du mouvement Solidarité en Pologne, la mort de John Lennon, l’élection de Ronald Reagan et le début de la période reaganienne (ainsi que du thatchérisme, 1980 étant la première année intégrale où Margaret Thatcher a été premier ministre), les Jeux olympiques de Moscou ou le lancement de la CNN, la vision que l’on se forme de l’avant et de l’après prend une signification différente. La question : « Quel âge avez-vous ? » invite le spectateur à construire son propre calendrier autour de l’année de sa naissance ; Pour Tillmans, demander : « Quel âge avez-vous ? » est l’équivalent de demander : « Quelle est votre place dans l’histoire ? Qu’avez-vous connu ? De quelle manière les événements historiques ont-ils affecté votre vie ? Et vice versa, dans quelle mesure avez-vous participé à ces événements ? »
A ces chronologies suggestives sont associées des images qui, de même, n’imposent pas une interprétation : les mots « Il y a 8 ans, nous étions en 2009. Dans 8 ans, nous serons en 2025. » sont imprimés sur une feuille A4, au-dessus d’une photographie sur papier brillant du studio de l’artiste. Dans cette image, l’on peut voir un bureau jonché de papiers et de documents de travail, une plante en pot se développant dans toutes les directions sur le rebord de la fenêtre, et, sur l’écran de l’ordinateur, la cérémonie d’assermentation de Barak Obama. Bien que l’image semble ancrer la chronologie de Tillmans dans le contexte de la politique américaine, impliquant qu’à présent, en 2017, c’est Trump qui est président, mais que, dans huit ans, quelqu’un d’autre occupera ce poste, même si Trump était réélu, rien ne permet vraiment de dater l’image. De même, le fait de savoir que l’artiste vit entre le Royaume-Uni et l’Allemagne peut influencer notre lecture en nous faisant considérer les implications mondiales de la présidence américaine. En définitive, l’image est là pour nous inciter à nous demander : « Où étiez-vous en 2009? Où êtes-vous maintenant ? » Et, qui plus est, cette image nous engage à penser l’avenir non pas comme un fait accompli qui échapperait à notre contrôle, mais comme quelque chose auquel nous devons chercher à participer activement. En ce sens, l’environnement de travail de l’artiste donne l’image d’une présence au monde, d’une interaction avec lui, et d’une contribution au changement, fût-ce à petite échelle.
Au coin de la salle 14, nous sommes en présence d’une autre forme d’engagement artistique / militant. Les pages de l’une des publications de petit format de Tillmans, Wako Book 5 (2016), consacrées à « Border Installation », sont organisées en constellation sur les murs adjacents. Certaines œuvres reprennent, à petite échelle, d’autres images plus grandes que l’on a pu voir auparavant, telles que celle d’une vitrine à Heathrow, sur le thème « Qu’est-ce qu’un liquide ? » – question à laquelle répond aussitôt une liste de substances « liquides » : « Gel, crème ou pâte ». Dans ce travail qui, à maints égards, est complémentaire de la critique, menée par Harun Farocki, de la représentation ainsi que de l’utilisation de l’image à des fins de contrôle et de surveillance, Tillmans se concentre sur la signalisation dans l’aéroport pour souligner l’étendue du contrôle physique et comportemental, et la réglementation à laquelle sont soumis les voyageurs internationaux. Dans un aéroport australien, un panneau informe les passagers que « LA SECURITÉ EN AVION EST UN SUJET SERIEUX ». « Faire des blagues à propos des bombes dans les bagages », par exemple, peut être interprété comme « une menace d’acte d’interférence illégale avec l’aviation ». En rendant pareils avis moins familiers, Tillmans met en évidence l’absurdité des ordres et interdictions divers. En même temps, cependant, il semble suggérer une façon de faire face à cet excès de contrôle : le rire.
Chaque fois que nous passons une frontière, nos corps, comme nos bagages, sont soumis à des contrôles permanents. Dans ce coin de la salle, l’on peut voir plusieurs images où des gens se soumettent aux contrôles des passeports et de sécurité, enlevant leurs chaussures, déposant leurs affaires dans des plateaux, ou scannés de la tête aux pieds. Et pourtant, l’idée de « frontière » est extrêmement arbitraire, ce qui saute aux yeux dans un aéroport. L’on peut voir, dans l’une des photographies de Tillmans, une rangée de lecteurs de passeports automatisés, inactifs derrière une barrière : ils semblent aussi inutiles qu’une porte dans le désert, et il apparaît comme absurde qu’ils puissent marquer le passage d’un pays à l’autre.
La question et la signification des « frontières » est au cœur de la pensée de Tillmans, qu’il s’agisse des frontières nationales, des bords des photographies, ou encore des limites conceptuelles érigées, par exemple, entre les sphères publiques et privées, ou entre les sexes. Souvent non encadrées, disposées en constellations plutôt qu’en rangs bien définis, parfois placées au sol, d’autres fois si haut que l’image se dérobe à la vue, les photographies de Tillmans communiquent invariablement à travers des frontières. Et le déplacement des visiteurs dans l’exposition est constamment interrompu par le fait de se baisser, reculer, se pencher, lever les yeux – gestes contraires au contrôle institutionnalisé : ils sont une libération, un changement de rythme, une subversion des attentes et une invitation à penser avec le corps tout entier.
Deux paysages marins de grand format, L’État dans lequel nous sommes, A (2015) et La Palma (2014), dominent la salle 14. La Palma montre l’écume marine sur une plage rocheuse, ses épaisses langues blanches venant lécher le rivage. Cela pourrait être n’importe où. Le titre de l’œuvre provient de l’une des îles des Canaries, et les bandes blanches de l’écume rappellent la « mer de nuages » pour lequel l’archipel est célèbre. L’État dans lequel nous sommes, A présente un océan d’un gris profond, s’étendant aussi loin que l’œil peut le voir. L’une des tables du Truth Center empêche que l’on prenne suffisamment de recul pour embrasser du regard toute l’image. En guise de cela, l’on s’y engloutit. L’océan s’enfle, menaçant de se répandre dans la salle, tandis que la bande étroite de ciel au-dessus de l’horizon n’offre aucun point d’ancrage, ni aucune direction. « L’état » dans lequel nous sommes est peut-être la métaphore d’un monde sans gouvernail, ou encore de la montée du niveau de la mer : on peut ainsi considérer cette œuvre comme apocalyptique, l’image d’un monde sans nul rivage pour que les vagues viennent s’y briser, l’écume marine le lécher. Placée dans le contexte des autres images de la salle, ce paysage marin est également un commentaire sur les frontières. Lorsque nous traversons une mer, dans quel pays sommes-nous en tel ou tel point ? Jusqu’où les eaux territoriales d’un état s’étendent-elles ?
Si l’on est un réfugié tentant de traverser la Méditerranée, de telles questions peuvent faire toute la différence entre la vie et la mort : si une barque surchargée tombe en panne, ou même chavire et coule, qui viendra à la rescousse ? Est-ce que quiconque viendra ? Se retrouver devant une image de l’océan, de plusieurs mètres de large et plus de deux mètres de haut, c’est faire l’expérience, non du pouvoir sublime de la nature (une expérience que l’on ne fait que lorsqu’on est en sécurité), mais d’une panique qu’éprouvent les égarés en mer et les naufragés.
La mer déborde les frontières avec indifférence, et pour cela même, elle est porteuse d’une promesse de liberté. Entre La Palma et Wako Book 5, le visiteur trouvera trois images d’une taille un peu plus petite qu’une feuille de quotidien. Sur l’une d’entre elles, nous voyons un horizon oblique qui sépare la sombre étendue de la mer et les nuages lourds. Un puissant projecteur émet un faisceau de lumière dans le coin droit de l’image, éclairant la surface de l’eau. Cette photographie s’intitule Italian Coastal Guard Flying Rescue Mission off Lampedusa (2008). L’image suivante, reproduite dans le Wako Book 5, a pour titre, tout simplement, Lampedusa (2008). L’on y voit un cimetière de bateaux de réfugiés. Prises en 2008, les deux photographies prédisent les désastres de 2013 ayant coûté 394 vies, bien qu’en 2008, l’île ait déjà compté un nombre indéterminé d’« accostages tragiques »,[3] et que ses centres d’abri aient souffert de surpeuplement. Vues en 2017, cependant, ces photographies sont également devenues inséparables de l’histoire tragique qui a suivi.
Dans son essai « Au-delà des droits de l’homme », Giorgio Agamben, en prolongement des réflexions d’Hannah Arendt sur la condition des réfugiés, constate que, en tant que « concept limite … [le réfugié] met radicalement en crise les fondements de l’État-nation » – et les revendications territoriales et les contrôles aux frontières que celui-ci implique – mais « en même temps, ouvre le champ à de nouvelles catégories conceptuelles. »[4] Tandis que l’idée de nation repose sur la subordination de l’humain (de « la vie nue ») au statut politico-juridique d’un sujet de l’État (c’est-à-dire le citoyen), le réfugié « représente un élément inquiétant » qui « brise [leur] identité ». Les États ne peuvent concevoir les réfugiés que de façon temporaire : tôt ou tard, ils doivent être résorbés dans le corps de l’État, qu’ils soient assimilés ou rapatriés. La crise des réfugiés que nous vivons aujourd’hui est aussi une crise de l’État-nation, comme l’avait déjà identifié Hannah Arendt en 1943.
Tout en anticipant qu’une « Europe des nations » est vouée à une catastrophe à court terme, Agamben a imaginé la possibilité de l’Europe comme d’un « espace a-territorial ou extraterritorial dans lequel tous les résidents des États européens (citoyens et non-citoyens) seraient en position d’exode et de refuge » : « le statut européen signifiant alors l’être en exode … du citoyen ». Une pareille aspiration se fait ressentir dans les images de Tillmans.
Les épaves empilées sur les côtes de Lampedusa, des bateaux qui autrefois semblaient « solides » mis en morceaux, nous rappellent la fragilité des choses et des êtres. Comme Mark Godfrey le souligne dans son essai dans le catalogue d’exposition, la vulnérabilité, pour Tillmans, est « une condition pour vivre et aimer »[5] ; c’est une qualité essentiellement humaine. Lorsqu’il participait à la campagne contre le Brexit, Tillmans a mis en relief l’importance de l’Union Européenne en tant qu’entité supranationale capable de protéger ceux qui se trouvent marginalisés, voire rejetés, par l’ordre juridique de l’État-nation : les réfugiés, les homosexuels, les personnes transgenre, etc., c’est-à-dire tous ceux dont l’existence-même déstabilise les dichotomies établies par l’État et dont l’État, comme l’avaient montré Agamben et Arendt, dépend pour sa survie.
Les deux derniers ensembles d’images dans la Salle 14 poursuivent l’exploration des notions de fragilité et de vulnérabilité. Installée dans le coin qui se trouve près de la sortie, nous trouvons une série de photographies d’un pommier que l’artiste cultive sur le balcon de sa résidence (apple tree (h), (e), (f), 2004 et apple tree, 2007). En dehors de son habitat naturel, d’une hauteur de plusieurs étages, le pommier est une sorte de réfugié, survivant et florissant dans un nouvel environnement, ses branches fragiles s’épaississant peu à peu au fil des ans. Lighter 99 (2011), une épreuve chromogène imprimée sur papier photosensible froissé sans utiliser l’appareil photographique, fait face au pommier, de l’autre côté de la salle. Contrairement aux autres images, celle-ci est sertie dans un cadre profond en Plexiglas. Les plis et les rides à la surface de l’épreuve, ainsi que la répartition inégale du pigment – rouge-orange comme la peau des pommes mûrissant sur les tiges fragiles – signalent la fragilité du médium photographique : et c’est cette fragilité, plutôt que l’œuvre d’art en tant qu’objet autonome, qu’il s’agit de protéger. De même, on peut penser à l’ouverture et à la liberté de l’installation de Tillmans, au refus d’imposer des interprétations fixes, que ce soit de l’œuvre ou du monde, comme d’un parti pris d’une mise à nu d’un corpus et d’un pari sur la possibilité d’une rencontre avec l’autre, avec le visiteur et sur sa volonté de se risquer dans une interaction à l’issue incertaine.
Ela Kotkowska
Ela Kotkowska est écrivain, éditrice et traductrice indépendante. Elle vit et travaille en New England, aux Etats-Unis.
Wolfgang Tillmans
Du 15 février au 11 juin 2017
Tate Modern
Bankside
London SE1 9TG
Royaume Uni
[1] Wolfgang Tillmans. Catalogue d’exposition, Museum of Contemporary Art, Chicago / Hammer Museum, Los Angeles / Hirschorn Museum, Washington, DC, 2006–2007. Yale University Press, 2006. p. 119 et suivantes.
[2] Ibid., p. 126.
[3] Christian Sindbaldi, “Lampedusa’s Migrants.” The Guardian, July 16, 2008.
[4] Giorgio Agamben, “Au-delà des droits de l’homme” [1993]. In Moyens sans fin. Payot, 1994.
[5] Mark Godfrey, “Worldview.” In Chris Dercon and Helen Sainsbury, avec Wolfgang Tillmans, dir., Wolfgang Tillmans 2017. Tate Publishing, 2017. P. 20.