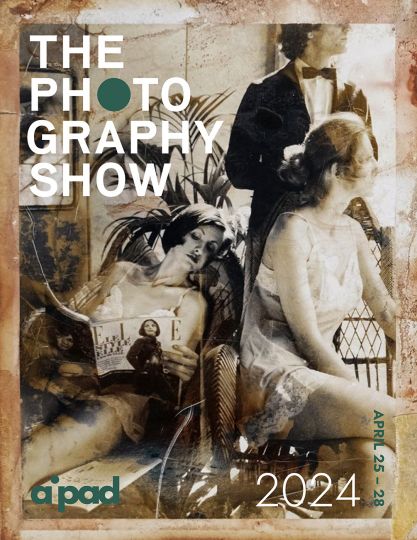C’est l’un des meilleurs entretiens de Jean-François Leroy. Il a été réalisé par Lucas Menget et Olivier Laurent en 2013.
Est-ce que, à 25 ans, Visa pour l’Image va enfin devenir un peu adulte ?
J-F Leroy : Je ne sais pas ce que vous entendez par « adulte », mais ce qui m’intéresse au bout de 25 ans, c’est d’avoir gardé la fraîcheur et l’enthousiasme de nos débuts, un mélange de spontanéité et de professionnalisme.
Vous dites que vous n’avez jamais voulu être une institution, mais vous avez aussi tout fait pour en devenir une. Et heureusement, Visa pour l’Image est devenu une institution du monde de la photographie de presse.
J-F. L : Je ne crois pas.
C’est une institution dans le sens où c’est un carrefour, un rendez-vous, et quoi que vous fassiez, c’est plus que jamais, aujourd’hui à 25 ans, une institution de la photographie. Sinon les gens ne viendraient pas.
J-F. L : En 1989, on se disait qu’on n’arriverait jamais à en faire cinq. Au cinquième, on s’est dit qu’on arrêterait au septième ; au septième, qu’on arrêterait au dixième… Les choses ont pris et tant mieux. C’est devenu un rendez-vous difficilement contournable pour le monde de la presse. En 1989, on se disait pour rire : « On va devenir le Cannes du photojournalisme parce qu’il y a un marché du photojournalisme. »
C’est vrai que ce point-là est un peu en déliquescence de par la révolution numérique, le tsunami qui a eu lieu dans le monde de la photo en général, et de la photo de presse en particulier. Aujourd’hui on ne peut plus se voiler la face : les seuls qui peuvent faire du hot news au quotidien, c’est AP, AFP, Reuters.
Je suis d’accord, mais Visa pour l’Image est un festival sur l’actualité. Ma question est volontairement provocatrice, mais est-ce qu’il y a un avenir en dehors des agences filaires, sachant la compétition et le challenge qu’elles mettent par rapport à des photographes indépendants en termes de moyens, en termes de diffusion, en termes de rapidité ? Je vois aussi un certain nombre de jeunes photographes aujourd’hui qui par exemple sur le Mali ne partent pas en se disant : « C’est pas la peine. De toute façon il y a l’AP et l’AFP, donc on ne fera rien. »
J-F. L : Mais ils ont raison de ne pas partir. Seulement quand AP, AFP et Reuters seront rentrées parce que ça ne sera plus de l’actualité immédiate, c’est là qu’ils devront trouver des angles pour raconter autre chose. Dans le livre de Jon Jones, Bosnia, qui retrace les événements de Sarajevo en ex-Yougoslavie, ce qui est intéressant c’est qu’avec le filtre des 20 ans qui sont passés, il n’y a même pas dix photos de combat. Ce qui reste, ce sont les gens derrière, la vie quotidienne. Et ça, ça n’a jamais été fait par Goran Tomasevic ; en revanche, sur le front, c’est le meilleur. Quand Don McCullin décide de partir en Syrie, il dit : « On ne montre pas les gens qui souffrent, on ne nous montre que les lignes de front. Moi j’ai envie de montrer autre chose. » Son papier dans le Guardian est vraiment intéressant. Pour conclure, vous avez parfaitement raison en disant qu’un jeune qui veut faire de la photo aujourd’hui, il faut qu’il se fasse engager par AFP, AP ou Reuters…
Vous avez accompagné le développement de la presse écrite – et vous êtes le reflet de ce qu’est la presse écrite aujourd’hui : une presse très magazine, beaucoup moins news. Est-ce que vous avez suivi cette évolution ? Est-ce qu’aujourd’hui vous faites plus de sujets magazine, est-ce qu’il y avait plus d’expositions news dans les années 1990 qu’aujourd’hui ?
J-F. L : Je ne crois pas. En 1990 par exemple, on avait une exposition sur les rites japonais de Masatoshi Naito, un sujet sur les mariages à New York par Kathy Shorr, le sexe des fleurs d’Heinz Teufel, les chasseurs de miel d’Eric Valli, donc des sujets magazine. Et on avait également la rétrospective de Patrick Chauvel, la Roumanie de Luc Delahaye, ou encore la violence domestique de Donna Ferrato. Il y avait déjà une balance. On nous a collé une étiquette « photos violentes », ce que j’ai toujours nié.
Pour le Rwanda, vous avez montré des photos qui n’avaient jamais été publiées dans la presse.
J-F. L : C’est vrai aussi. Mais on ne peut pas dire qu’on n’ait rien vu sur le Rwanda. La photo d’Albert Facelly de la gamine qui hurle à côté de sa mère décapitée, Paris Match en avait fait une double page. Ce n’était pas une révolution de notre part de montrer ça. D’ailleurs, il y a des photos de violence qu’on a refusé de montrer, plus souvent qu’on ne le croit.
25 ans après le début de Visa pour l’Image, quel est le positionnement éditorial ? Sachant que, aujourd’hui, la quasi-totalité des gens à qui vous vous adressez ont un accès à l’information démultiplié par Internet d’une manière générale, mais aussi beaucoup par les réseaux sociaux. Il suffit de passer une demi-journée à regarder Facebook : on a à peu près en direct quasiment toutes les photos de tous les photographes qui sont au Mali en ce moment. Sauf quelques photographes un peu planqués qui vont ensuite apporter leur boulot aux magazines. Mais quel est le positionnement éditorial dans un monde où tout le monde a accès à ces photos-là ?
J-F. L : Non, tout le monde n’a pas accès à tout !
En partie. Qu’est-ce que vous offrez au regard d’un jeune photographe, de quelqu’un passionné par la photographie ?
J-F. L : L’année dernière, même en restant trois semaines sur Internet, vous n’auriez jamais vu le travail de Stephanie Sinclair comme on l’a montré. Il n’était pas sur Internet et n’y est toujours pas. Le travail de Pascal Maitre sur les artistes à Kinshasa, on ne le trouve pas sur Internet. Donc, oui, nous allons montrer Goran Tomasevic dont on voit régulièrement les photos sur les unes du monde entier. Maintenant, quand on tire le fil de sa rétrospective de ses lignes de front depuis 1992, c’est une autre manière de montrer. La photo qui vous a accroché l’œil hier, la mort du sniper qui a été répercutée sur Facebook non stop et partagée par 352 000 personnes, c’est une photo qui marque. Mais si on l’inscrit dans le déroulé de l’histoire de Goran, on comprend la continuité et comment il travaille.
La ligne éditoriale de Visa pour l’Image a-t-elle évolué ? Et c’était quoi la ligne éditoriale ?
J-F. L : Je ne dirais pas qu’elle a évolué. La ligne éditoriale a toujours été basée sur mon « mauvais goût » ! Ça a été des coups de cœur, et il y en a eu beaucoup. La ligne éditoriale, c’était montrer des photographes qu’on ne voyait pas ailleurs. Les festivals qui faisaient du photojournalisme, c’était Magnum, Magnum, Magnum, Rapho un peu, et Black Star de temps en temps. C’est tout. Donc on s’est dit qu’il y avait aussi des photographes chez AP, AFP, Vu, Getty, Polaris, Sygma, Sipa, Gamma, Cosmos, etc., qui étaient vraiment intéressants. Après c’étaient des coups de cœur, des histoires, et ça n’a pas changé.
Mais ça ce sont les raisons, ce n’est pas la ligne éditoriale. La ligne éditoriale, c’est comment est-ce que vous allez d’un point A à un point Z en construisant le festival.
J-F. L : Honnêtement je n’en sais rien. Ce sont des rencontres, des coups de cœur…
Quand je dis « ligne éditoriale », le mot n’est peut-être pas bien choisi, mais ça ressemble à un choix. C’est une vision du monde. Vous présentez, pendant trois semaines au mois de septembre, une certaine vision du monde. Laquelle ?
J-F. L : On essaie d’être réalistes. À l’époque je disais qu’il y avait trois axes : découvrir des jeunes talents, confirmer des talents qui existent, et redécouvrir des talents oubliés.
C’est toujours ce que vous faites 25 ans plus tard ?
J-F. L : Je crois.
Je vais poser la question autrement. Vous êtes passionné de presse, vous lisez tout, vous voyez tout, et pourtant, comme tous les professionnels, vous râlez beaucoup sur tout ce qui existe, tout ce qui est mal fait, ce qui n’est pas suffisamment couvert. Ce qui veut dire que ce que vous proposez aussi tous les ans au mois de septembre, ça vient de quelque part en vous, des tripes, du cerveau. Si ce n’est pas éditorial, c’est politique. Ça s’inscrit dans quoi ?
J-F. L : Le sujet de Robin Hammond sur les malades mentaux dans les pays africains en conflit, je trouve tellement injuste qu’il n’ait pas été publié à l’époque, vu la qualité de ce travail. Mais il est sorti quelques semaines après Visa pour l’Image dans le Sunday Times Magazine. Je trouve effarant qu’un boulot aussi percutant que celui-là ne soit pas publié.
Visa pour l’Image, c’est aussi votre réponse à une colère. Une colère contre quoi, contre qui ?
J-F. L : Quand on voit ce que des journaux peuvent investir comme argent dans des histoires médiocres, alors qu’il y a tellement d’histoires formidables qui sont traitées… Robin Hammond a fait son boulot tout seul en pensant que ça allait intéresser tout le monde, et ça n’a intéressé personne. On l’a montré à Visa pour l’Image et tout à coup les gens disent : « Tiens, il a du talent. » Donc, oui, c’est une colère.
On ne peut pas dire que vous êtes quelqu’un de particulièrement calme.
J-F. L : Oui, je suis révolté.
Donc cette ligne éditoriale, c’est en partie une révolte.
J-F. L : Une révolte, une colère. Quand on a la chance comme moi de voir plus de 90 % de la production internationale, et qu’on voit le peu qui est utilisé…
À qui vous adressez-vous ?
J-F. L : À un public le plus large possible ! Il y a des professionnels qui découvrent des choses qu’ils n’avaient pas vues avant. Pour revenir sur la rapidité de transmission dont on parlait au début : on est tellement abrutis d’images. Je suis quasiment certain qu’il n’y a pas un picture editor au monde qui reçoive autant de sujets que j’en reçois. En tout cas, moi je les regarde, c’est peut-être ça la différence. Je regarde tout, et je vois beaucoup de choses mauvaises.
Ce qui veut dire que vous faites un choix, vous éditorialisez la construction du festival, pour au final vous adresser à qui ? De la même manière qu’un patron de journal sait à peu près à qui il s’adresse, sinon il ne peut pas le faire.
J-F. L : Je pense que l’on s’adresse aux professionnels et au grand public.
Comment faites-vous cette jonction entre les professionnels et le grand public ?
J-F. L : On organise chaque jour des rencontres avec les photographes et le public, soit sous forme de conférences, soit par des visites dans leurs expositions.
Quelles sont les proportions ?
J-F. L : Sur la 24e édition, c’est 3 000 accréditations, dont 1 300 photographes. Après ce sont des picture editors, des journalistes, des agences, des iconos. 3 000 professionnels.
Mais comment fait-on, pendant 25 ans, pour s’adresser à la fois à des professionnels qui connaissent les contraintes du métier, qui connaissent parfois une partie du travail des gens que vous exposez, et à la fois à ces dizaines de milliers de personnes qui viennent voir les expositions. C’est là que je m’interroge sur la ligne éditoriale. Il y a de plus en plus de festivals de photojournalisme dans le monde qui s’adressent essentiellement à des professionnels dans un secteur donné : festival de la photo de mode, de la photo animalière… Des festivals qui s’adressent à des niches. En 25 ans, vous avez réussi à vous installer comme une institution qui n’est pas une institution de niche, c’est-à-dire qui s’adresse à la fois à des professionnels et au grand public.
J-F. L : Je pense que le public qui vient à Perpignan, ça le passionne de voir des histoires traitées dans leur longueur et qu’il n’a pas forcément vues ailleurs. 220 000 personnes ont vu les expositions et 10 000 les soirées de projection.
Vous avez à la fois accompagné la presse écrite et complètement divergé de la presse écrite. La presse écrite aujourd’hui ne peut plus s’adresser à un public large. Aujourd’hui, quand on fait des longues histoires qui racontent des choses un peu différentes, c’est-à-dire faire le pas de côté nécessaire par rapport à l’actualité, ces journaux-là s’adressent à des niches de 20 000, 40 000 personnes, voire 50 000. Vous, vous avez réussi à conserver l’intérêt du grand public. Au bout de 25 ans, il faut quand même révéler un peu les secrets de fabrication. C’est ça que j’aimerais comprendre : comment vous réussissez à faire ce grand écart. Comment vous faites pour qu’un Noël Quidu, un Duncan viennent toujours à Visa pour l’Image, et que le grand public vienne aussi.
J-F. L : Le travail de Sylvie Grumbach, et de 2e BUREAU, a été essentiel en termes de communication. Ensuite, j’ai dit il y a quelques années et je le répète : on est l’anti-Facebook. Tu ne cliques pas sur « j’aime ». Tu vois les gens, tu les touches, tu les embrasses, tu bois des coups avec. Ce n’est pas « j’aime », « j’aime pas » ; c’est la vraie vie. Le côté humain. Quand je lis, il y a encore un mois, la lettre des élèves du collège de Bon Secours de Perpignan qui planchent depuis trois mois sur les petites filles qu’on marie de Stephanie Sinclair et qui en font une page dans L’Indépendant, ça me fait un plaisir fou. Les profs sont contents d’avoir réussi à les intéresser à un problème qu’ils ne connaissaient pas. Ce rôle didactique vis-à-vis du grand public, et humain… La semaine des scolaires, il se passe vraiment des choses. Olivier Laban-Mattei me disait la semaine dernière qu’il est encore en contact avec des élèves qu’il a vus il y a trois ans. Il y a aussi la transmission qui existe à Visa pour l’Image.
La transmission était déjà présente il y a 25 ans ? Ou c’est quelque chose qui a germé petit à petit ?
J-F. L : Elle n’y était pas de façon aussi affirmée qu’elle ne l’est aujourd’hui. Mais on faisait déjà rencontrer Horst Faas, David Douglas Duncan, ou Alfred Eisenstaedt à tout le monde… Je me souviendrai toute ma vie que Dennis Stock me disait : « Ce que vous avez réussi de mieux, c’est de faire se confronter et se parler tant de générations avec une seule passion commune : la photo et l’information. » Ce n’est pas à moi de le dire, mais je trouve que Visa pour l’Image, c’est d’une extrême générosité. Symboliquement, la gratuité est vraiment importante. Mais tous les gens qui font Visa pour l’Image, tous les gens qui viennent à Visa pour l’Image, ceux qui viennent pour apprendre, ceux qui viennent pour dire, ceux qui viennent pour se confronter, même ceux qui viennent pour critiquer, ils sont tous d’une extrême générosité. De tous les festivals que je connais, le seul où ça se passe aussi fort, c’est à Perpignan.
Si la crise économique qui sévit partout et particulièrement en France avait raison de Visa pour l’Image – ce que personne ne souhaite –, qu’est-ce que vous aimeriez qu’il en reste ? Comment aimeriez-vous qu’on se souvienne de Visa pour l’Image ?
J-F. L : Si ça s’arrêtait, je pense qu’il y a beaucoup de gens qui seraient très tristes de ne plus avoir ce rendez-vous annuel.
Mais au-delà des regrets ?
J-F. L : Je crois qu’il y a beaucoup de souvenirs très forts, des rencontres. Je me souviens quand on avait fait venir Zohra Bensemra, qui était arrivée cachée dans un coffre de voiture parce qu’on n’avait pas eu son visa français. Le Campo Santo s’était levé pour acclamer les photographes algériens qui prenaient tant de risques depuis tant d’années. Les larmes d’Igor Kostine, le photographe de Tchernobyl, et le Campo Santo debout. Ce sont des choses que je n’oublierai jamais. Eisenstaedt et Khaldei, Baltermans…
En fait il restera plus ça que la photographie elle-même.
J-F. L : Non, je pense que les gens n’oublieront jamais les photographies de Stephanie Sinclair, le train de Robert Kennedy de Paul Fusco, la photo de Scott Thode de Venus Williams devant la bouche à incendie, le portrait de Massoud de dos par Pascal Maitre et tant d’autres… Ce sont des photos qui ont marqué les gens.
Je sais que c’est un choix très difficile, mais s’il devait rester une photo en 25 ans ?
J-F. L : Celle que quelqu’un va prendre demain ! Je m’en sors pas mal… En 24 ans, nous avons montré 727 expositions. Plus les projections ! On est en train, parmi ces 727 expositions, de recenser le nombre de premières expositions de photographes qui sont devenus des gens extrêmement importants. Lise Sarfati, Laurent Van der Stockt, Luc Delahaye, Paolo Pellegrin, Pascal Maitre, Guillaume Herbaut, Samuel Bollendorff, Julien Goldstein, Stephanie Sinclair… ils sont tous nés professionnellement à Perpignan. Je pense que c’est quelque chose d’incroyable qui restera : le côté révélateur de talents de Perpignan. Robin Hammond, Sebastian Liste… Visa pour l’Image leur a donné leur première chance. C’est magnifique.
Est-ce que vous avez des regrets ?
J-F. L : Je disais ça déjà pour les 10 ans : à part deux exceptions, je n’ai jamais réussi à amener vraiment des photographes africains. J’ai essayé pourtant. Quand on avait fait l’affiche avec Akintunde Akinleye, il m’avait dit : « Maintenant que je connais Visa pour l’Image, je vais faire des propositions tous les ans. » Je n’ai plus jamais entendu parler de lui. Alexander Joe pareil. Alors il y a Issouf Sanogo qui travaille pour l’AFP, et qui a fait le buzz avec la photo de ce soldat avec son masque tête de mort. Mais voilà, j’ai beaucoup de regrets sur le côté Afrique.
Et sans les citer, est-ce qu’il y a des expositions que vous regrettez d’avoir produites ?
J-F. L : Oui, deux. Deux photographes ont manqué totalement d’honnêteté vis-à-vis de leur boulot, vis-à-vis du festival et vis-à-vis des spectateurs.
Un des reproches que l’on vous fait depuis 25 ans, c’est d’être un ayatollah de la profession. Est-ce que vous voulez bien vous expliquer là-dessus ?
J-F. L : Ce surnom d’ayatollah m’a été donné par un rédacteur photo qui m’appelait « l’ayatollah de l’image à sens ». Pardon, mais j’ai toujours trouvé que c’était un compliment. Oui, j’ai des coups de gueule, oui j’ai dit des choses que je regrette, beaucoup…
Lesquelles par exemple ?
J-F. L : Un jour où je me suis énervé et que j’ai dit : « Cette presse de merde. » Je regrette vraiment d’avoir fait une généralisation.
Et sans la presse le festival n’existerait pas non plus.
J-F. L : Oui, et je le regrette. Je m’en suis expliqué.
Je peux vous donner un exemple précis où on vous reproche d’être un ayatollah. L’année dernière, pour les 24 ans, vous avez dit que vous ne feriez pas d’expositions de photographes qui allaient en Syrie. Est-ce que vous regrettez ce choix-là aujourd’hui ?
J-F. L : Ce n’est pas tout à fait exact… J’ai dit que je n’exposerais plus de photographes partis en Syrie sans garantie d’un journal. Non seulement je ne le regrette pas, mais je l’assume. (Quelques semaines avant cet entretien, le Sunday Times prenait la même décision.)
Mais cette année, vous allez en présenter. Dans l’exposition de Goran Tomasevic, il y aura des photos de Syrie.
J-F. L : Attention, je n’ai pas dit : « Pas de photos de Syrie. » J’ai dit : « Pas de photos de Syrie de photographes qui partent sans garantie et sans assurance. » Malheureusement, en 24 ans, on a perdu beaucoup de copains. Beaucoup trop. Donc c’est aussi une histoire personnelle qui vous a fait porter ce coup de gueule. Oui, je ne m’en cache pas. Ils sont trop nombreux à partir sans couverture. Pour quoi faire ?
Vous dites « pour quoi faire ? », mais il y a 20 ans vous n’auriez pas dit la même chose. Quand Stanley Greene ou Yuri Kozyrev étaient en Tchétchénie, vous ne vous posiez pas la question de leur assurance.
J-F. L : Je pense que c’était radicalement moins dangereux. Il faut se souvenir, en tout cas jusqu’au Vietnam, que les photographes étaient accueillis. Des gens comme Catherine Leroy, David Burnett et d’autres, allaient au Vietnam, où ils voulaient : « Je voudrais aller voir la 317e section », et on leur mettait un hélicoptère à disposition. Aujourd’hui les gens de la presse sont des ennemis.
Mais est-ce qu’il n’y a pas aussi une forme de sagesse chez vous au bout de 25 ans ? Et qui change aussi du coup votre vision du travail de photographe.
J-F. L : Oui, de maturité je dirais.
La question est : est-ce que tout ça vaut des vies humaines ? La vie de gens qui sont payés même pas au smic toute leur vie. Est-ce que ça vaut le coup ?
J-F. L : Horst Faas a toujours dit qu’aucune photo ne valait la vie d’un homme. Il disait déjà ça quand j’étais tout jeune. Peut-être qu’il a fallu attendre 2012 pour que je comprenne qu’il avait raison. La mort de Rémi Ochlik a été pour moi une telle révolte.
C’était la mort de trop. Parce que des copains morts ou blessés, vous en avez plein votre carnet d’adresses.
J-F. L : Oui et je le regrette. Cette année on fait une rétrospective de Joao Silva : il me bluffe par son courage. Il a perdu ses deux jambes en Afghanistan. Il s’était juré qu’il remonterait sur une moto : il l’a fait. Il s’est fait réopérer le 21 février, il a 6 mois de convalescence et il me dit : « Comme ça j’aurai du temps pour aller dans mes archives et faire un choix. » Je trouve que c’est admirable. L’année dernière, pendant les 3 jours de Transmission pour l’Image, on a fait une séance par Skype. C’était Patrick Chauvel qui faisait l’interview de Joao, qui était avec sa perfusion et son déambulateur parce qu’il sortait d’une opération. À la fin, il les a regardés par Skype : « Moi, je sais ce que c’est de perdre des jambes sur le terrain. Est-ce que vous avez vraiment envie de faire ça ? » Jérôme Delay a terminé en disant : « On peut être vos initiateurs, mais on peut aussi être vos briseurs de rêves. » C’est un beau résumé.
Est-ce que Visa pour l’Image n’a pas été aussi un briseur de rêves ? Il a créé des talents, des carrières, des compétences, a appris des tas de choses à des tas de gens, mais est-ce qu’il n’a pas aussi brisé beaucoup de rêves ?
J-F. L : Si, je pense que vous avez raison. Je me souviens avoir eu une conversation en 1994 avec Roger Thérond. Commençant à entrevoir la puissance de Visa pour l’Image, il me disait : « N’oublie jamais que tu seras adoré par ceux que tu vas exposer, et détesté par ceux que tu vas refuser d’exposer. Je suis confronté à ça depuis 50 ans. Dans Paris Match, je fais une double, je suis le bon Dieu ; je refuse un sujet, je suis un con. » Donc oui, je pense que Visa pour l’Image a brisé plein de rêves. Mais c’est vrai que quand on a présenté 727 expositions en 24 ans et près de 3 000 sujets en projection, il faut quand même être fort pour nous étonner. Sur les enfants des rues en Inde, depuis Dario Mitidieri en 1993, je n’ai rien vu de mieux. Le photographe qui va s’attaquer aux petites filles qu’on marie après Stephanie Sinclair, il va falloir qu’il se lève tôt. Le train de Paul Fusco qu’on avait fait en exposition et en projection pour les 20 ans : il n’y a pas une année où on ne me fasse pas le coup du train. Traversée de la Sibérie en train, etc. C’est nul.
C’est aussi normal que de jeunes photographes s’en inspirent. C’est toute la démarche de Visa pour l’Image et de cette transmission.
J-F. L : Qu’ils s’inspirent, mais qu’ils ne copient pas en bâclant.
Au fond, Visa pour l’Image, ça a aussi été une histoire d’admiration ?
J-F. L : Oui, je ne peux pas le cacher.
De fascination pour des photographes ?
J-F. L : Non, pas fascination, admiration. Et puis la grande chance d’avoir pu développer des relations avec des gens que j’ai aimés et qui sont devenus des amis. Le seul qui m’a vraiment fasciné en 25 ans, ça a été Roger Thérond. À chaque fois qu’il m’a dit des choses, je me suis pris des leçons, des baffes, et j’ai appris beaucoup. Il avait une espèce de sagesse. J’admire beaucoup David Douglas Duncan, j’admire Don McCullin. Mais être ami avec Eugene Richards, Stanley Greene, Pascal Maitre, Paolo Pellegrin… je trouve que c’est un grand privilège, un grand bonheur. Et je ne vais pas faire une liste exhaustive.
Vous admirez encore des jeunes photographes ?
J-F. L : Robin Hammond, je suis admiratif, il m’étonne et il va m’étonner encore. Je sais qu’il ira loin. Le premier jour où j’ai vu son travail, j’ai eu de l’empathie pour lui. La même chose m’est arrivée avec Sebastian Liste, Alvaro Ybarra Zavala ou cette année avec Abir Abdullah… La liste est longue…
Il y a des plaques dont on se souviendra longtemps.
Pour parler un peu de l’avenir et pas que du passé, on peut sans trop se mouiller estimer que, dans les 5 à 10 ans qui viennent, la plupart des titres de presse écrite imprimés auront disparu. Quelle est la prochaine étape pour Visa pour l’Image pour continuer à accompagner les mutations de la presse ?
J-F. L : Je pense que personne au monde n’est capable de dire ni de prédire à quoi ressemblera le paysage médiatique à l’avenir. Quand on voit à quelle vitesse s’est développé le numérique, à quelle vitesse le marché de la photo de presse s’est presque écroulé. Je ne sais absolument pas s’il y aura un sursaut. Je l’espère évidemment, et si je continue à faire Visa pour l’Image c’est parce que je suis optimiste. Il faut essayer d’accompagner cette mutation, mais se faire devin en la matière, je ne pense pas que cela soit possible. C’est pour ça que je parle de cette ouverture aux documentaires, à la vidéo. Mais je ne m’extasierai jamais autant devant une photo sur un écran de tablette que devant un tirage photographique magnifiquement réalisé. La richesse, la puissance, la finesse d’un tirage photographique sur papier… Et je pense que je ne suis pas le seul. Pourquoi y a-t-il tellement de galeries photo ? Il y a un marché de la photo qui se développe.
Ça c’est sur la partie technique. Mais le métier de photographe va évoluer forcément.
J-F. L : Oui, la mutation est largement entamée. Mais il n’empêche que ce métier aura toujours besoin d’une place où se rencontrer, où discuter, où échanger. Je pense qu’avec la virtualisation de la presse dont vous parlez, où le New York Times, le Washington Post n’existeront plus en version papier mais uniquement sur le Net, il y aura quand même une envie de se retrouver, de parler, et ailleurs que sur les réseaux sociaux. C’est mon pari.
Le débat sur les réseaux sociaux comme Twitter, Instagram et Facebook s’est intensifié ces derniers mois, surtout depuis qu’Instagram a été racheté par Facebook. Beaucoup utilisent ces réseaux pour atteindre une nouvelle audience – souvent en publiant des images qui, au bout du compte, ont été créées pour Instagram et ne seront publiées nulle part ailleurs. Quel est votre point de vue sur ce sujet ? Les risques associés à Instagram ne valent-ils pas le coup si cela permet aux photographes d’atteindre une audience nouvelle ? Surtout si cela peut déboucher sur une participation financière de la part de ces « followers ».
J-F. L : Je constate le phénomène Instagram qui s’amplifie de jour en jour. C’est très bien de développer une nouvelle audience, mais je ne suis pas encore convaincu que les « followers » soient capables de donner de l’argent pour regarder des photos. On n’a pas encore trouvé le Steve Jobs dans le domaine de la photo, qui a réussi à créer iTunes et qui fait qu’aujourd’hui tout le monde accepte de payer sa musique sans sourciller.
Justement, est-ce que vous pensez que le futur du photojournalisme se fera à travers ces communautés de « followers » ? Tout comme les chaînes du câble que nous pouvons sélectionner selon nos goûts, pensez-vous que nous nous approchons d’un modèle où les lecteurs choisissent les photographes qu’ils souhaitent suivre ? Quelles peuvent être les conséquences de ce genre de modèle ?
J-F. L : J’espère que vous avez tort. Je l’espère de toutes mes forces, parce que si on se met à suivre certains photographes, ça veut dire qu’on en rate plein d’autres. Et dans ce métier, ce qui est passionnant, c’est la découverte de nouveaux talents. J’adore Stanley Greene, j’adore Eugene Richards, mais je ne regarde pas que leur travail. Et heureusement, parce que sinon on irait où ? Il faut garder un œil pour pouvoir découvrir un Robin Hammond, un Sebastian Liste, un Rafael Fabrés ou un Muhammed Muheisen… Il y a trois ans, quand on a montré le travail de Mohammad Golchin sur les écoles rurales en Iran, on a vu le succès que ça a eu auprès des rédactions. Mais si on n’avait pas eu la curiosité de regarder les CD qu’on avait reçus, on n’aurait jamais vu ce sujet. Il y a cinq ans, quelqu’un comme Mohammad Golchin n’aurait jamais eu un « follower ».
En dehors des lieux d’expositions et de projections, est-ce que Visa pour l’Image doit être justement aussi ce lieu de réflexion sur les mutations de la presse, sur l’avenir de la presse, et particulièrement de la photographie ? Contrairement à d’autres festivals, vous êtes restés concentrés uniquement sur la photographie, à de très rares exceptions près.
J-F. L : Vous avez raison mais je pense que ça a été notre force. On a maintenu un cap.
Oui, mais le maintenir après ?
J-F. L : Ce n’est pas une diffusion aussi développée que Facebook ou Internet d’une manière générale, mais il y a toujours des gens qui vont prendre plaisir à venir regarder des histoires bien racontées et bien présentées. J’en suis convaincu. Il faut évoluer bien sûr. D’ailleurs je dis qu’on n’a pas changé, mais ce n’est pas vrai. Entre 1989 et 2012, on voit la différence, et de professionnalisme et d’audience. On a évolué par petites touches, mais on a évolué. Et on va continuer à évoluer.
Comment ?
J-F. L : Il y a la troisième génération d’appareils photo qui est sortie. Aujourd’hui c’est encore inabordable, mais il existe des appareils photo qui font du 4K. C’est une nouvelle norme de vidéo qui fait du 4 000 pixels ; aujourd’hui, au mieux, on est à 1 280 pixels. On multiplie quasiment la qualité par 4. Quand ce matériel sera à la portée de tout le monde dans moins de trois ans, la grande tentation va être que les photographes se mettent à faire de la vidéo parce que c’est plus facile à vendre qu’un reportage photo, et prennent une image pour sortir une photo. Ça va forcément influer sur la manière de travailler. Aujourd’hui le EOS I-DC vaut 10 000 euros ; dans deux ans il sera beaucoup plus accessible.
Mais comment allez-vous accompagner ce mouvement ? J’imagine que ce sont des choses qui se réfléchissent dès maintenant.
J-F. L : Honnêtement, je n’ai pas encore la réponse. Ne serait-ce que dans les soirées de Visa pour l’Image, on n’a pas de projecteur 4 K. Dans deux ans on en aura certainement.
Vous êtes en train d’expliquer que le fameux « instant décisif » de Cartier-Bresson n’existera plus. Ou qu’il sera choisi à l’intérieur d’une vidéo.
J-F. L : Il pourra l’être, mais il y aura toujours des photographes. Paradoxalement, il y en a de plus en plus qui reviennent à l’argentique. Quand je dis que c’est un balancier : il y a des photographes comme Eric Bouvet qui jettent leurs appareils numériques et se remettent à faire de la chambre Graphiflex avec des optiques de la Seconde Guerre mondiale. On voit des Philip Blenkinsop ou des Stanley Greene qui refusent certaines commandes parce qu’ils veulent pouvoir continuer à travailler en film à leur rythme. Il y a des gens qui ne veulent pas de cette instantanéité de l’info. Ceux-là seront toujours les bienvenus chez nous. Et on accueillera aussi les autres. C’est vrai que l’instant décisif de Cartier-Bresson va bientôt être une curiosité pour amateurs d’antiquités. Je le regrette.
Comment vous situez-vous dans ce monde en pleine évolution vis-à-vis de tous les jeunes photographes qui ne rêvent plus que de vendre en galerie et qui ne croient plus à la presse ?
J-F. L : Ça me fait sourire. Combien en vendent ? Combien en vivent ?
Pierre Terdjman a plus vendu son sujet sur Israël en galerie que dans la presse.
J-F. L : C’est un très mauvais exemple. Pour la pauvreté en Israël, il a eu une commande de Paris Match pour faire le sujet ; plus une bourse de Saint-Brieuc pour le continuer. Donc je ne pense pas que Pierre Terdjman ait gagné plus d’argent avec les tirages vendus en galerie, qu’il en a gagné avec ses bourses et commandes.
Certains photographes, aujourd’hui, pensent déjà à la possibilité de financer leurs travaux grâce à des ONG ou même via des entreprises privées et institutions culturelles privées. Qu’en pensez-vous ? Est-ce un développement positif ?
J-F. L : Pour moi, dans la notion « festival de photojournalisme », il y a quand même le mot « journalisme », donc a priori c’est un travail pour l’information. Après, effectivement, puisque la presse ne répond plus à ces besoins, à ces nécessités, on se tourne vers les ONG, vers des bourses, vers des prix, vers des projets associatifs. C’est très bien, mais je ne sais pas si ce substitut à la presse est aussi positif qu’on veut bien le dire aujourd’hui. Les prix, c’est une des évolutions de Visa pour l’Image : au début on était contre, et aujourd’hui c’est ce qui fait vivre les photographes. On en crée un tous les ans. Donc c’est une nécessité.
Certains photojournalistes fonctionnent de plus en plus comme de petites entreprises, contrôlant chaque aspect du financement, de la production et distribution de leurs travaux photographiques, avec, par exemple, des plateformes comme Emphas.is. Est-ce la solution ? Ou est-ce que ce n’est qu’une solution provisoire à un problème qui nécessite une intervention plus concertée de toute la communauté photographique ?
J-F. L : C’est toujours pareil : j’ai soutenu Emphas.is à fond dès sa création et je me félicite de tous les projets qu’ils ont permis de réaliser. Maintenant, est-ce que c’est un modèle qui va se développer ? Je l’espère mais je n’en suis pas certain.
Comment imaginez-vous Visa pour l’Image dans 5 ans ? Ça ressemblera à quoi ? Est-ce que ce sera toujours la même chose ? Je ne parle pas des photographes, de l’engagement qui est le vôtre. Mais physiquement ?
J-F. L : Techniquement même. On a mis des années à arrêter la projection de diapositives pour la remplacer par de la projection numérique. Pourquoi ? À l’époque, avant d’avoir trouvé la solution que l’on a adoptée, la projection numérique ne nous satisfaisait pas ni les uns ni les autres. On a été les derniers à se mettre à la projection numérique parce qu’on voulait, le jour venu, être meilleurs que tout le monde. Et pardon de le dire, nous avons réussi. La qualité des projections à Perpignan, je n’ai rien vu de mieux dans le monde. Mais c’est beaucoup d’argent. Donc il va falloir s’adapter à ces nouvelles techniques.
Pensez-vous que tous vos partenaires vont continuer à vous accompagner ? Quel est l’intérêt pour eux ?
J-F. L : Oui, parce que je pense que c’est devenu un rendez-vous incontournable et que les évolutions techniques ne changeront pas l’attrait de ce rendez-vous.
Ce qui veut dire aussi que les évolutions techniques n’auront jamais raison de la photographie ?
J-F. L : Oui, je crois. Regardez l’engouement pour Paris Photo qui s’exporte à Miami, à Los Angeles.
Est-ce que vous craignez la concurrence ?
J-F. L : Non, parce que je pense qu’aujourd’hui, et j’ai peut-être tort, on n’a pas de concurrence dans le secteur du photojournalisme. Pourtant j’ai vu d’autres tentatives.
C’est votre ancienneté ?
J-F. L : Et la fidélité. J’aimerais aussi parler de la fidélité des équipes. À part Michel Decron avec qui nous avons monté ce festival et qui est parti en 1994, tous les gens qui étaient là la première année sont encore là. C’est quand même exceptionnel. Et que dire de la fidélité de nos partenaires présents depuis la première édition ? Paris Match</em<, Canon, et bien sûr la Ville de Perpignan. Je n’oublie pas non plus les laboratoires photographiques qui nous accompagnent depuis le début : Central Dupon et e-Center. Vous me parlez de concurrence, mais je suis allé dans beaucoup de festivals de photo à travers le monde : quand vous vous asseyez au Café de la Poste après les projections à Perpignan, avoir Stern, le Sunday Times, Paris Match, le Figaro Magazine, le New York Times, le Washington Post, le National Geographic, le Guardian et tous les autres, je n’ai jamais vu ça ailleurs. Le jour où le New York Times va passer en tout-numérique, vous pensez qu’ils vont se poser la question de savoir s’il faut supprimer leur service photo ? Bien évidemment non.
Que vous inspire la mort de la version papier de Newsweek ? Est-ce la fin d’une période de transition et le début d’un changement radical du paysage médiatique ? Déjà les rumeurs abondent sur la survie de The Guardian au Royaume-Uni, et ce n’est pas un secret que le New York Times pense sérieusement à passer au tout-numérique dans les prochaines années. Quelles peuvent être les conséquences pour le photojournalisme ?
J-F. L : La disparition de Newsweek version papier ne peut m’inspirer que de la tristesse. En même temps, c’est vrai qu’à l’heure d’Internet et de la communication instantanée, un hebdomadaire a de moins en moins de raison d’exister. Newsweek sort le jeudi : ce qu’il raconte de ce qui s’est passé le vendredi de la semaine précédente a été disséqué sur tous les réseaux sociaux, analysé sur toutes les chaînes d’information continue. C’est donc à mon avis un processus inéluctable.
Mais il y aura toujours des photographes qui raconteront des histoires différemment. En janvier, au séminaire du National Geographic, entre les rendez-vous que j’ai eus avec les éditeurs, les photographes et les « works in progress », j’ai vu 30 sujets et j’en rapporte 8 pour Perpignan. Avant que le National Geographic arrête de faire travailler des photographes, j’ai encore quelques années devant moi. <em<National Geographic, on leur colle toujours une étiquette de « belles photos », ce qui est vrai. Mais en même temps, les tunnels de Gaza de Paolo Pellegrin, l’Irak d’Alexandra Boulat, ce n’étaient pas des sujets faciles. Ce sont quand même des gens qui ne s’intéressent pas qu’aux éléphants et aux petits lionceaux. C’est bien trop facile de les réduire à ça !
Justement, National Geographic est l’un des rares magazines qui ne commissionnent des photographes qu’après une longue série d’interviews. Ces photographes doivent aussi passer devant un panel de directeurs et rédacteurs pour présenter leur travail à chaque stade de leur conception. Pour beaucoup de magazines, ces méthodes ont disparu. D’après vous, pourquoi n’existent-elles plus ? Et quelles en sont les conséquences pour ces magazines, et surtout pour les photographes ?
J-F. L : C’est vrai que National Geographic est le dernier à faire ça. Ça veut dire qu’il manque tout un ensemble de chaînons. On le voit aujourd’hui dans le fait qu’il y a beaucoup de photographes qui ne savent absolument plus construire une histoire parce qu’ils n’ont plus d’interlocuteur et sont livrés à eux-mêmes. Alors que le photographe qui travaille pour National Geographic doit rendre des comptes, il travaille avec quelqu’un, il a un éditeur, il a un rédacteur. Cette triplette aboutit à des histoires formidablement construites. Si les autres ont abandonné cette méthode, c’est pour des raisons de coûts. Mais avec la paupérisation des agences dans leur ensemble, on a perdu la notion d’« éditeur photographique » et ça manque beaucoup.
N’est-ce pas le symptôme de tout un système qui s’écroule, où personne ne semble vouloir partager ses expériences ? Aujourd’hui, il semble impossible de réunir dans la même pièce les directeurs des grandes agences comme Magnum, NOOR, VII, AP, Reuters, Getty Images, etc. Pourquoi ? Je parlais avec un photographe d’une de ces agences après qu’il a reçu une aide financière de la part d’une autre agence, et pendant de longues minutes, il a insisté sur le fait qu’il n’avait aucun lien avec cette deuxième agence. Pour lui, il n’était pas imaginable qu’il soit associé à cette agence.
J-F. L : Ça s’est déjà passé. Je me souviens très bien, il y a quelques années, avoir récupéré la fameuse photo d’Henri Bureau sur la guerre Iran-Irak, avec le chauffeur de taxi de dos qui tient un fusil entre deux colonnes de fumée. Cette photo était créditée par une agence mexicaine. Avec les accords de distribution, ça arrivera de plus en plus.
N’est-ce pas là le fond du problème ? Comment peut-on espérer trouver une solution commune si nous ne sommes pas capables de nous associer ?
J-F. L : C’est une très bonne remarque et malheureusement nous sommes dans un métier où le collectif n’existe pas, chacun joue un peu trop pour soi. C’est pour cela que pendant des années à Perpignan nous avons soutenu Freelens. Pour la première réunion de Freelens, il y avait 400 participants ; dix ans plus tard ils étaient 18. Cette année, nous allons redonner la parole à PAJ (Photographes, Auteurs, Journalistes), qui ont l’air de vouloir remuer un peu les choses. Mais c’est vrai que si on n’agit pas collectivement… À l’observatoire de la presse, il n’y a pas un seul représentant des photographes : c’est complètement insensé.
Mais Visa pour l’Image n’a-t-il pas un rôle à jouer sur ce point ? Peut-il être le rendez-vous où – au lieu de parler des problèmes qui agitent notre métier – nous commençons à parler des solutions collectivement ?
J-F. L : C’est ce que nous essayons de faire depuis 25 ans, mais c’est compliqué. En effet, certains problèmes sont exclusifs à la France et ne concernent pas l’international. Il est donc parfois difficile de mobiliser toute une profession lorsque celle-ci n’est pas concernée dans sa globalité. Nous restons bien évidemment ouverts à toute initiative. Dès 1989, nous affirmions que Visa pour l’Image serait un outil pour les professionnels. S’ils veulent l’utiliser, ils sont les bienvenus !