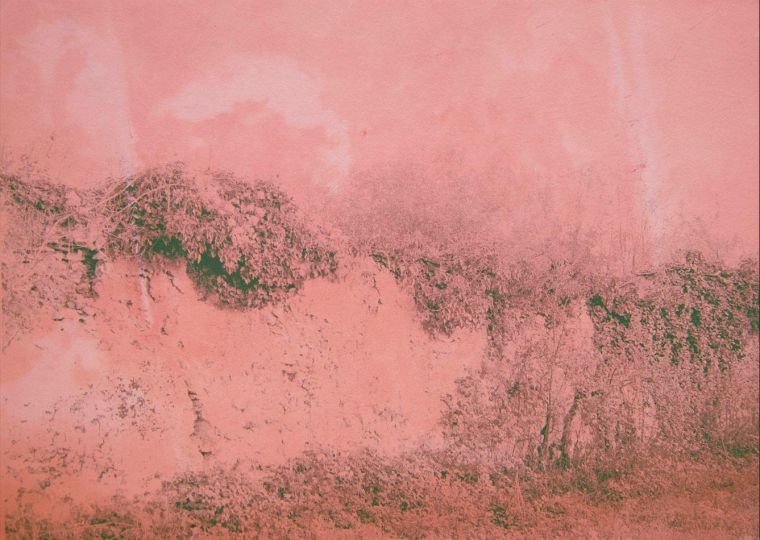Depuis plus de quarante ans, c’est du don de soi que vivent les Cubains — les sentiments à fleur de peau, l’émotion du cœur toujours à fleur de lèvres. Il suffit d’observer l’agencement psycho-architectural de leurs maisons, le plus souvent la porte principale est grande ouverte, et, au fond, une seconde porte ou quelque fenêtre offre une échappée invisible. Ainsi, les esprits se promènent et s’enfuient à leur guise, diront les aïeuls, libres d’aller et venir sous forme de brise murmurante. A l’unisson de leurs voix, la fraîcheur mélodieuse rend les idées claires, car la chaleur éblouit, empoisonne, la chaleur tue. Des lustres avant la vogue du Feng Shui, les Cubains l’avaient déjà inventé, sans le savoir bien entendu. L’énergie des intérieurs doit circuler du fond de la pièce vers son seuil, et l’humidité des murs ou la proximité de la mer tempère l’intensité des bouffées de vapeur. Comment capturer la tiédeur de l’air ? Qui oserait ravir une ombre havanaise, née et perdue dans cette ville, la poursuivre, saisir son évanescente même dans le tain séducteur, tandis qu’elle trône dans une salle de séjour de Floride, à la main l’éventail jaune d’Oshun, déesse de la sensualité, notre Astarté? Seul Robert Van der Hilst peut s’y risquer sans que le reflet nous grille les paupières.
Après l’Américain Walker Evans (1903 – 1975), auteur des célèbres photos de la Havane républicaine, voici Van der Hilst. Au moment où nous vans conçu ensemble le livre Les Cubains, le photographe s’enflammait pour un nouveau projet, qu’il intitulait déjà Intéreurs cubains, et dont il avait réalisé les premières images à Baraco, à l’extrêmité orientale de l’île. Tout ce qui l’attirait, la baroque des décors, la gestuelle exubérante, les vestiges d’une élégance révolue, la misère digne, les regards naturellement dociles, les reflets irisés d’une plante ou un coup de peinture sur un mur, était précisément ce que je ne pouvais pas supporter, pour l’avoir trop vécu dans ma chair. La beauté de la pauvreté que l’on contemple sur les portraits artistiques a le don de me mettre en colère. C’est triste à dire, mais la pauvreté cubaine se vend bien, et parmi ceux qui la consomment, bien peu sont capables de réfléchir sur l’origine de cette effroyable manipulation, issue avant tout de la dictature castriste.
Dès sa sortie, notre livre Les Cubains fut censuré par le régime, et le photographe se vit refuser un visa pour retourner à Cuba. Ce n’était pas la première fois. Dans les années 80, il avait déjà été accusé d’être un agent de la CIA, selon l’étiquette que les communistes collent volontiers aux artistes. On aurait pu croire Van der Hilst échaudé, et je fus d’autant plus surprise de son soudain désarroi devant le verbiage de l’attachée culturelle de l’ambassade, le jour où il alla retirer son visa. Elle l’accusa d’un ton hargneux de trahison pour avoir travaillé avec moi. En contraste avec la tenue décontractée et la courtoisie des entrevues antérieures, elle portait alors, selon Robert, tailleur et talons aiguilles, un look très officiel mais frôlant la vulgarité, malgré son chic emprunté. Robert Van der Hilst n’en avait pas cru ses oreilles. Je me rendis compte alors que le grand photographe qu’il est possédait certes une immense sensibilité pour dresser le portrait de l’âme cubaine, mais que, comme la plupart des artistes européens, voire américains, il n’avait pas la moindre idée de la subtilité monstrueuse du castrisme. Détail drôle et inhabituel, elle avait pris la peine de se mettre sur son trente-et-un pour annoncer une mauvaise nouvelle. Et de cette mauvaise nouvelle — comme cela arrive toujours avec la censure — devait surgir un projet meilleur encore, plus complet, plus attachant.
Lors d’un dîner chez Robert, je lui suggérai l’idée qu’il aille photographier les Cubains de Miami, puisqu’on ne le laissait pas aller à Cuba. L’un des convives lâcha ironiquement qu’à Miami il n’y avait pas de Cubains pauvres. Tant mieux, pensai-je. Il est vrai que, jusqu’à un certain point, par le mensonge équivoque qui l’entoure, l’île est plongée dans une misère à nulle autre pareille tant elle est survalorisée et portée aux nues par les touristes inconscients et les collaborateurs du régime. Jamais on ne chanta tant les louanges de la misère, jamais dictature ne fut à ce point adulée. Que d’indulgence envers un criminel tel que Castro.
Le photographe fit le voyage à Miami et il fut ravi, comme le montre son récent travail. A l’heure où J’écris ces mots dans le New Jersey, il séjourne pour la deuxième fois dans la ville du soleil. Il m’est arrivé de dire que Robert van der Hilst a déchiffré les hiéroglyphes de l’âme cubaine, ses désirs imaginaires. Cette âme danse tandis qu’elle pleure, et rêve au rythme de l’éternité. Une âme qui s’étend aujourd’hui à la diaspora, à la fuite.
Depuis que je suis allée à Miami, que j’ai découvert cette ville, retrouvé toute sorte de compatriotes, j’ai compris une chose. Ce n’est pas tant Miami qui n’existerait pas sans les quatre décennies et des poussières de castrisme, c’est Cuba qui sans Miami, ne serait plus ce qu’elle est aujourd’hui, à savoir une survivante. Sans qu’il m’ait été besoin d’en parler avec Robert, l’atmosphère de déséquilibre tentateur, ce frémissement de corde raide, est omniprésente dans les photographies de Miami que j’ai pu voir (en août 2002, l’auteur n’avait pas encore mis le point final à son travail).
Le déséquilibre et l’ambiguité sont comme des empreintes de doigts à la surface du verre fumé. Les miroirs, effleurés des lèvres, se regardent et se reconnaissent, vases communiquants du fleuve héraclitien de la pensée et de la vie. L’union est sincère dans ce baiser dont le prélude fut tout de politique et de passion. Le déchirement familial de la séparation nous a rendus paranoïaques et prompts à nous agglutiner, où que nous allions échouer. Les régimes communistes transforment tout ce qu’ils touchent en dangerosité, corruption idéologique, interdiction, délit, en un mot en crime. Ni l’exil ni le rêve de la liberté ne parviennent ensuite à guérir ces plaies. Cuba se fait la belle et c’est pour se réfugier dans sa religion, qui tient plus du phénomène culturel que de la stricte religion, comme si sa vie se cramponnait encore au dernier bois du radeau qui le porta sur l’océan jusqu’à Miami, hors des griffes du Mal. Logique implacable de la géographie, Cuba restera toujours à la même place sur la carte. Mais la véritable culture cubaine, la culture culinaire, la culture géographique et plastique la plus authentique, son écriture et même les hauts faits de son histoire récente déambulent de par le monde en ordre dispersé, et, force est de le reconnaître, principalement à Miami. L’exil a su y reconstruire une Cuba intemporelle, réelle, palpable.
La renaissance d’un pays en exil, voilà ce que Van der Hilst a photographié à Miami. Ce pays mourant dont il fit ailleurs le portrait. ll n’y a rien d’étrange à voir, sur l’une de ses photos, une iyaloche ou prêtresse de la santeria cubaine flanquée d’un Bouddha chinois ventru, d’un autre Bouddha indien aux traits fins et d’un troisième Bouddha tibétain. Même du marxisme, le Cubain a fait une rhétorique religieuse. On y voit aussi la poupée noire symbole d’Obbatala, Vierge de la Merci, un grand chapeau mexicain pendu au mur du fond, le derrière d’un éléphant de porcelaine vietnamien tourné vers l’entrée (cela porte bonheur), un arc-en-ciel de bibelots lourds de mémoire striant le plafond et, dans un cadre doré, la photo d’une autre iyaloche, à moins que ce ne soit elle-même à quelque moment de son passé. Plantée au milieu, elle est une figurine de plus, un Bouddha féminin, dont les bras tendres esquissent les contours de fantôme.
Sur une autre photographie, les murs sont recouverts de portraits collés. Des portraits de toutes parts, et à nouveau la poupée noire aux tresses de jais, et la femme, surprise sous le linteau de sa porte, a mis un corsage à carreaux, elle attend sagement le déclic de l’obturateur, puis elle avancera de quelques pas pour offrir une tasse de café.
Dans un séjour, où l’on s’attend à un espace saturé du mobilier le plus luxueux, la véritable essence de la maîtresse des lieux transcende les apparences: l’extravagance. Elle tient des deux mains la parure dorée d’Oshun, Vierge de la Charité du Cuivre, le regard perdu sous sa couronne. Sa tête n’est pas la seule à émerger de son cou, il en sort aussi la tête de la dame du tapis du fond et le hasard des coïncidences, cher à Lezama Lima, la transforme en cerf femelle bicéphale. D’un œil perplexe, un Babbalu Ayé grandeur nature, notre saint Lazare, semble contempler la sublimation du kitsch. Et il faut voir comme il essaye mine de rien d’allumer en douce la télévision.
Dans ce jeu de miroirs des intérieurs de Cuba et de Miami, j’avoue que Miami a le privilège de l’inattendu. Dans la séquence consacrée aux prêtresses, la présence physique des miroirs révèle la recherche du double, comme dans le théâtre d’Artaud ou le poème de Rimbaud. Ce « Je est un Autre », l’ombre cubaine, furtive, lointaine. Univers captif et captivant des deux côtés. Les jambes ouvertes ou les cuisses cachées derrière la tête d’un lion factice, chaque sujet photographié fait don de sa personne. Le silence vibre entre les tambours et les sourires lucides se répondent d’une image à l’autre. Le geste de l’éventail jaune couvrant des seins adolescents rivalise avec l’éloquence somptueuse du travesti tiré à quatre épingles, l’enfant qui se gratte la jambe ou le gamin vêtu de bleu, indifférent à tout ce qui n’est pas l’appel radieux du trottoir. Vient ensuite l’irrévérence de la blonde platine caressant un chien, une profusion d’ornement, et des photos, toujours et encore. Nous autres Cubains vénérant les icônes blagueurs. Et les reines du rococo le plus échevelé, deux métisses élégantes — comme dirait ma grand-mère —, toutes parées d’oripeaux clinquants et de souvenirs. A Miami, les gens te regardent en face et mettent tes rêves à nu.
Lumière aveuglante de Miami, opacité de la lumière cubaine. La lumière bleue de cinq heures de l’après-midi idéale pour les photographes. La crasse se mêle à la verdeur d’un plant de malanga grimpante, au feu désirant des pupilles ou à un rideau tiré. Des objets abîmés, à la pelle : fleurs de plastique, calendriers périmés, héros, saints, dictateurs, traîtres,peu importe, chez Castro tout ce qui rentre fait ventre. Une fois de plus, je me retrouve dans cette enfant à la mélancolie immobile qui coupe un gâteau de papier-mâché verni, pure meringue. La désolation frappe les murs et les estomacs. Sur un lit, une petite souris dans un nuage de tulle rose et d’espoir. Dieu et son sacré cœur soutiennent les toits friables, menaçant mine. Les fenêtres sont des creux, des tokonomas japonais timorés, une femme rougissante se cache le visage derrière un linge blanc, tandis que par terre, sur un matelas, un nouveau-né fait sa sieste. Elles pourraient être les nièces des deux métisses très élégantes de Miami, ces deux jeunes mulâtresses cubaines restées là à se morfondre de désir, dans l’espoir de voir grandir ce petit frète qui a un pied dans le futur. Une femme en robe de chambre blanche allongée sur un grabat sourit, un réfrigérateur américain venu de la nuit des temps est à l’évidence son trésor. À Cuba, les gens se prennent les mains. Ou bien, ils les posent gracieusement comme cette vieille dame qui esquisse un sourire, tandis que le rideau rouge dévoile un visage paisible, presque divin, de l’expérience usée jusqu’à la corde. À Cuba, les gens te regardent, te mettent à nu et te font l’amour : et la flamme vive est celle du fourneau, dans une cuisine à l’abandon, délabrée et déserte. Seraient-ils tous partis à Miami en oubliant d’éteindre le feu?
Texte écrit par Zoé Valdès