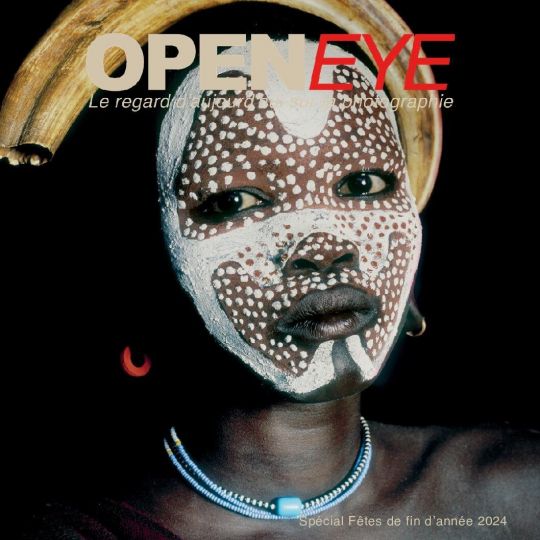Le livre commence comme une fiction, introduite par un titre à la grammaire enfantine et la photographie d’une femme sur un poste de télévision se palpant le visage des deux mains d’un air surpris, comme si elle l’avait effectivement perdue, sa tête. Il s’agit peut-être même d’une fiction datée, avec sa couverture rose pâle qui rappelle celui de la façade à peine visible au travers de laquelle on aperçoit l’écran de l’actrice désemparée. L’histoire se passe dans un lieu habité dont Peter Granser refuse dans le premier tiers du livre de nous montrer les résidents autrement qu’en photos accrochées sur les murs dénudés, dessins tagués sur ces mêmes murs usés et sculptures de visages déformés évoquant des pièces d’art brut. Les têtes ont bel et bien disparu. Est-ce un coup trop violent dans un mur qui les aurait dévissées des épaules de leur propriétaire, comme le suggère une image, ou ont-elles roulé sous un lit, comme le ballon de football d’une autre image ? Le mystère plane, puis un feuillet volant plié en trois et glissé entre deux pages blanches promet une réponse. Sur la partie visible, dans un pré fraichement tondu, un homme se gratte le sommet du crâne, confus, devant une femme semblant chercher quelque chose — une aiguille dans une botte de foin ? La tête perdue, au pied de l’arbre de la connaissance ? Le reste de l’image découvre un groupe, hétéroclite, dont les pages suivantes révèlent les visages par jeu de miroir ou par répétition, pour inviter à les scruter de près, à décrypter leurs traits, l’expression de leurs yeux, les rides de leur âge. D’autres visages distordus en terre cuite rythment cette série de portraits, puis le champ s’élargit pour laisser apparaître leurs corps, interprétant quelques chorégraphies de l’ordinaire devant un mur neutre. On pourrait aussi bien être en train de feuilleter les planches finales d’un casting datant de l’époque où le cinéma recrutait encore des “tronches”. Un autre feuillet dépliant interrompt la divagation. Dans le même pré, le même groupe s’anime dans une expression corporelle théâtrale qui évoque le travail de Denis Darzacq sur la mise en scène de personnes handicapées. Si c’est une fiction, elle est sociale. La dernière section du livre est une série de vues sur les néons grillagés de faux plafonds, évoquant des fenêtres ouvertes sur le ciel, l’imaginaire et la liberté. La fiction se dissipe. On repense à la nature morte de début d’ouvrage, celle d’un gobelet vide laissant deviner la ligne rouge et sirupeuse d’un médicament. Comme les murs décharnés et neutres, ces néons sont typiques des hôpitaux. Imprimé sur un feuillet rose aux lignes régulières des cahiers d’écoliers, le témoignage d’un des résidents le confirme. « J’ai perdu ma tête », c’est son expression, qu’il répète à maintes reprises, en essayant de retracer son histoire avec sa mémoire bégayante. Et ces murs, ces néons et ces prés, ce sont ceux de la clinique psychiatrique d’Evreux. « Peter Granser ouvre d’innombrables fenêtres sur un monde inconnu (la folie) — et par conséquent craint, mis de coté, intentionnellement ou non , mais peut-être dans le but spécifique d’oublier son existence — et il le fait en remplaçant les mots par la photographie », écrivait très justement Andrea Filippin à propos de cette série. Le travail éditorial de cette jeune maison d’édition relève de la même subtilité.
J’ai perdu ma tête, de Peter Granser
Co-édition: Edition Taube / Marraine Ginette Editions
104 pages, 32 euros
http://www.marraineginette.com