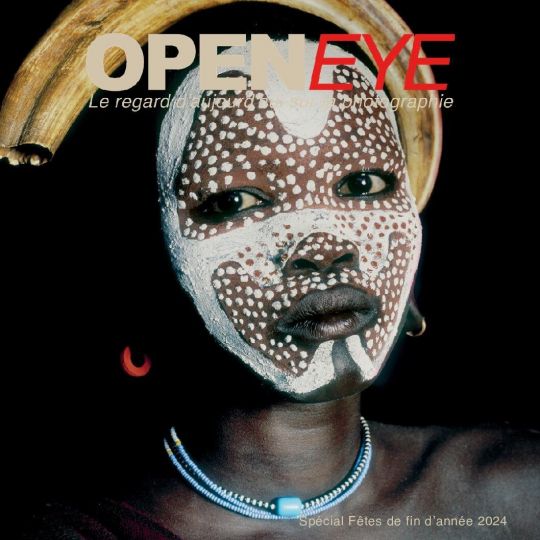Musée est un magazine numérique et un site internet consacré à la présentation de travaux de photographes internationaux émergents. Aujourd’hui, nous présentons l’interview d’Edward Burtynsky publiée dans le numéro 7 de Musée.
Edward Burtynsky
Water, Water everywhere and not a drop to drink (« L’eau, l’eau était partout, et nous n’avions pas une goutte à boire. », extrait de La Complainte du Vieux Marin de Coleridge, NdT)
Quelles sont d’après vous les différences majeures entre l’attitude du Canada et celle des États-Unis concernant la nature ?
E.B. Je crois avoir pu observer un début de prise de conscience en 2007, et ensuite j’ai vu cette tendance décroître au moment où l’économie a connu cette énorme crise, donc c’est assez lié aux préoccupations des gens. J’ai l’impression que c’est en train de revenir une nouvelle fois du fait de l’accumulation des preuves irréfutables du réchauffement climatique : avec les inondations, les tempêtes, les feux et les ouragans de plus en plus nombreux et importants, toutes ces choses dont les gens finissent par remarquer la fréquence. Nous venons juste d’avoir une tempête à Toronto, et ce n’était plus arrivé depuis l’ouragan Hazel en 1954. Nous avons aussi des feux sans précédents et d’autres départs d’incendie à cause du changement climatique et de l’assèchement d’un grand nombre de sites naturels parce qu’ils ne reçoivent pas la même quantité d’eau de pluie que par le passé.
Votre travail se concentre sur la transformation de la nature du fait de l’influence humaine – comment vous est venu cet intérêt particulier ?
E.B. Ça a commencé au tout début des années 80. J’avais beaucoup travaillé sur des paysages épurés et j’étais très intéressé par cela : le médium photographique et la manière dont il peut produire une réaction universelle à un endroit qui peut apparaître familier à tous. À un certain point, j’ai réalisé que le fait de simplement m’amuser avec le paysage était d’une certaine manière en décalage avec notre époque. Alors que je commençais à penser à ce que je pourrais en faire, un groupe de photographes fit l’exposition intitulée The New Topographic, en 1976. Robert Adams était son porte-parole et entre ce qu’ils faisaient et les paysages qui avaient été produits par le passé, la différence était qu’ils pointaient leurs appareils vers les banlieues des villes en pleine expansion. Les images n’étaient plus seulement une méditation sur la beauté et les attraits de la nature sauvage, mais aussi une réflexion sur l’impact de l’homme sur celle-ci. J’avais déjà un profond respect pour la nature et la vie sauvage, et il me semblait que commencer à photographier la manière dont nous transformons la terre pour veiller à nos besoins journaliers était plus dans la logique de mon époque que célébrer les paysages immaculés.
Pouvez-vous nous parler de votre processus de travail pour photographier ces paysages ?
E.B. J’essayais d’interpréter le paysage en couleur, parce qu’il avait traditionnellement été traité en noir et blanc jusque là. J’étais donc très sensible aux sortes de couleurs que je faisais entrer dans l’image et à la manière dont j’utilisais la couleur ainsi que mon appareil grand format. Avec ces deux éléments en tête, j’ai commencé à développer ce que j’appellerai un langage visuel qui permettait d’interpréter les paysages de manière à forcer les gens à s’asseoir et à réfléchir à ce qu’ils voyaient, et parfois à se scandaliser de ce que l’on peut faire subir à la beauté du monde. Je pense que le mot « beauté » ne décrit pas précisément ce dont on parle. La beauté est culturellement spécifique : ce qu’une culture comme la nôtre trouve beau n’est pas la même chose que ce que la culture africaine ou chinoise trouverait beau. Mais pour ce qui est du paysage, je pense que la beauté est plus universelle : nous comprenons tous instinctivement ce genre d’interprétation photographique de l’espace. J’aime l’idée que les images que je fais puissent forcer les frontières entre les cultures. Je ne me vois plus comme un photographe de paysage parce que je ne me rends pas dans ces endroits comme, disons, Ansel Adams est allé dans les Yosemite pour observer la beauté pure et la magnificence de ce paysage. Je vais dans des endroits où l’empreinte laissée par l’homme est visible à grande échelle, et cette échelle est toujours une forme de signature pour moi. Je cherche toujours l’illustration la plus vaste de quelque chose : que ce soit pour mettre en lumière le détournement des eaux pour l’irrigation agricole dans le cadre du projet Water ou les erreurs que nous avons commises comme l’assèchement du lac Owens. Je me rends dans ces endroits non pour la beauté du paysage mais pour y voir ce que nous, en tant qu’humains, y avons intentionnellement changé. Je me vois plus comme un photographe du système humain dans un paysage naturel que comme un photographe de paysage.
L’une des photographies dépeint le barrage de Xiaolangdi. Les barrages peuvent permettre de produire de l’énergie renouvelable, mais peuvent aussi avoir des effets destructeurs sur l’environnement, est-ce que cette dualité est quelque chose qui vous intéresse ? Comment peut-on conserver l’équilibre entre les deux ?
E.B. Eh bien, vous avez raison, un barrage a à la fois des conséquences positives et négatives. C’est une merveille technologique par bien des aspects. Le gouvernement chinois affirme qu’il cherche à prévenir les inondations, et à créer un réservoir permettant la navigation pour que des bateaux plus importants puissent transporter des produits le long de la rivière. Je dirais que la motivation première, c’est l’énergie hydroélectrique que le barrage peut produire. Cela signifie que vous n’avez plus à brûler de charbon ou de gaz naturel ou à créer des centrales nucléaires. Mais quand vous regardez le barrage, vous voyez un changement complet de tout l’écosystème : tous les gens qui vivaient sur les berges de la rivière doivent se reloger, ce qui ne va pas toujours sans heurts. Toutes les autres formes de vie du système ont été affectées elle aussi. Par exemple, des algues ont commencé à proliférer à cause des déchets humains et industriels, donc l’eau commence à poser de vrais problèmes. Il y a toujours un prix à payer pour tout ce que nous faisons, et la question est : quel est le moins terrible des maux qui nous guettent ?
L’eau a une grande valeur spirituelle dans de nombreuses cultures, est-ce quelque chose que vous avez pu constater et comment cela s’est-il manifesté ?
E.B. Dans le livre Water, je me suis consacré au plus grand pèlerinage ayant l’eau pour thème, le festival Kumbh Mela où trente millions de personnes se réunissent tous les trois ans. C’était impressionnant d’observer la valeur profonde que les croyants accordent à ce bain dans une zone sacrée du Gange et la manière dont se baigner dans cette eau et la boire lave les péchés de chacun. Durant cette période d’un mois, une centaine de millions d’Hindous indiens font le pèlerinage pour laver leurs âmes. Si vous regardez le film, vous verrez que nous sommes partis de là pour nous rendre à Huntington Beach pour y voir la compétition de surf qui y prend place ; celle-ci est une forme de célébration occidentale de ce que la mer représente et révèle une approche plus compétitive et pleine de défi avec l’idée de conquérir la vague. Ensuite, je suis allé voir la manière très inhabituelle dont le bord de mer est fabriqué en Floride. Le corps des ingénieurs de l’US Army a pris trois mangroves qu’il a draguées et ensuite des maisons ont été construites sur les rives de ces canaux pour permettre aux gens d’avoir des propriétés en bord de mer, même si ces canaux ne conduisaient nulle part – c’était juste des rivages artificiels. Pour moi, c’était intéressant. Nous désirons tellement vivre au bord de l’eau que la création de toute pièce d’un bord de mer vaut toujours mieux que pas de bord de mer du tout.
Beaucoup de vos images mettent en scène des foules immenses tandis que d’autres ne figurent que des machines. Quels sont les problèmes auxquels vous êtes confronté quand vous photographiez les unes et les autres pour capturer l’énergie de chacune d’entre elles ?
E.B. Je pense que cette question devient centrale pour moi en tant que photographe et artiste – comment est-ce que je résous ce problème ? Comment puis-je l’aborder, comment est-ce que je traite cette idée et comment je la traduis avec mon appareil ? Donc je recherche la lumière, le moment de la journée, la position et le point de vue idéales pour présenter le sujet, de façon à pouvoir l’apprécier et le comprendre. Une grande partie de ce processus procède d’une manière instinctive de me situer dans cet espace : cette analyse de la forme et du fond pour représenter un endroit est sans cesse répétée pour donner une place au deux et qu’ils soient affirmés sans que l’un ne domine l’autre ; ni la forme ni le fond n’écrase l’image, ils coexistent tous deux avec une force en quelque sorte égale.
Beaucoup de vos photographies sont des clichés aériens, pouvez-vous nous parler du processus de reconnaissance et de capture de ces larges étendues de terrains et du type d’équipement que vous utilisez dans ce cas de figure ?
E.B. Eh bien, pour la plupart des choses que j’ai photographié, j’ai utilisé les formats pellicule et numérique. Pour le format numérique, j’ai utilisé majoritairement un Hasselblad. J’ai eu trois systèmes différents sur les cinq années qu’a duré le projet : j’ai commencé avec un appareil 40 mégapixels et celui avec lequel je travaille maintenant en a 60. J’ai travaillé avec un appareil haute résolution en mode cliché unique, j’ai beaucoup utilisé le gyrostabilisateur pour pouvoir adopter des vitesses d’obturation moins élevées. Souvent, la meilleure lumière avec laquelle je pouvais travailler était celle du petit matin ou du soir quand le soleil n’était pas à son maximum. Donc vous devez utiliser des temps d’exposition plus longs, dans un hélicoptère avec une porte ouverte. Gérer tous ces facteurs pour que l’image soit précise même à un fort taux d’agrandissement a constitué un vrai défi. La clé ici a été que l’option numérique pour le travail aérien a constitué la meilleure solution que je pouvais espérer. Le format pellicule n’offrait tout simplement pas la résolution ou la vitesse nécessaire pour figer l’image depuis un hélicoptère, tandis que le numérique me permettait d’obtenir une vitesse d’obturation suffisamment élevée pour fixer ces images.
La majorité de vos images représente d’une manière ou d’une autre le monde naturel et pourtant dans certaines d’entre elles comme Manufacturing Number 15 “Bird Mobiles China”, la nature est totalement absente. Pourquoi cela ? Quel effet pensez-vous que cette absence produise à la fois sur le spectateur et concernant le traitement du sujet ?
E.B. Ce que j’essayais de montrer, c’était que tous nos produits, tout ce que nous utilisons, prend naissance dans la nature. Que ce soit du bois, du fer, du cuivre, du plastique (avec le pétrole), tout prend sa source dans la nature. Ces ressources sont transformées par le soleil et les éléments pendant des millions d’années. Mais quand je suis allé dans ces usines, l’idée numéro un était que la révolution industrielle avait clairement démarré en Chine et que ces usines sont les endroits où l’on convertit ces ressources naturelles en produits que nous utilisons tous les jours et qui sont tamponnés « Made in China ».
Pouvez-vous nous parler du sens que prennent les déchets et la consommation excessive dans votre travail ?
E.B. Eh bien, s’il y a bien une chose que nous, les humains, produisons, ce sont des déchets. Le flot de déchets est clairement la part la plus importante du processus, que ce soit lors de la création des objets ou lorsqu’ils parviennent en fin de vie. Le goudron, les pneus, les frigos, les micro-ondes et les ordinateurs ont tous une vie propre et l’entropie y tient une place importante. Si vous regardez le cycle de la vie, vous avez un endroit d’où viennent tous les matériaux nécessaires en premier lieu : les mines, les carrières, les raffineries de pétrole, tout cela constitue la source primaire. Ensuite, nous avons le cycle de la vie du produit, le moment où il est fabriqué et le moment où il est usé. Enfin, il y a une troisième étape, un troisième état lorsqu’il devient un déchet, lui-même recyclé ou jeté dans une décharge. Donc pour moi, c’est toujours un enjeu de savoir quelle mine, quelle décharge de pneus, quel cimetière de bateaux ou quel chantier naval va devenir l’endroit que je veux utiliser comme illustration d’une activité plus large, de l’activité humaine globale. J’ai choisi celui-ci parce qu’il a une résonance visuelle particulière pour moi, d’une certaine manière il permet d’illustrer cette histoire sur un mode graphiquement frappant. Cette composante est nécessaire.
Nombre de vos travaux mettent sur le devant de la scène des processus destructeurs que beaucoup de gens préféreraient ignorer. Pensez-vous que votre travail peut inspirer une prise de conscience de nos influences destructrices et comment peut-on atténuer cette destruction ?
E.B. Pour chaque acte de création, il y a un acte de destruction égal ou plus important. Nous avons tendance à vivre dans un espace que nous avons créé de toutes pièces, et les conséquences de cette fabrication sont souvent occultées. J’ai toujours espéré que mon travail nous permettrait de nous reconnecter à ces espaces. Quand je me suis rendu sur le barrage en Chine pour ce dernier projet, pour ce que j’en savais, j’étais le seul Occidental à avoir jamais vu cet édifice, qui est pourtant six fois plus grand que le barrage Hoover. Mon appareil m’a permis de capturer ce qu’il y a là-bas et d’en ramener des images. Je pense que la réalité des choses pénètre nos consciences à un certain niveau à travers le processus photographique. Je pense que c’est un outil plus puissant pour considérer les choses que, disons, si un peintre se rendait là-bas et peignait ces choses, nous verrions plus cela comme un travail interprétatif. Nous regardons la photographie et nous projetons toujours une certaine part de croyance en la réalité de l’existence de cet endroit.
Est-ce que le fait de réaliser tous ces projets qui sont, selon moi, très nobles et sonnent justes d’un point de vue social, a eu un effet quelconque sur vous, à titre personnel ?
E.B. Oui. Je crois que je ressens une forme de tristesse du fait de ma compréhension des conséquences de ce que nous faisons pour assurer notre existence et le niveau de croissance que nous connaissons. En sachant que l’Inde et la Chine essayent maintenant de parvenir à réaliser la même chose, alors qu’il est évident que la nature ne peut tout simplement pas fournir la matière nécessaire pour que nous ayons tous un mode de vie à l’occidentale, notre trajectoire est assez effrayante concernant le futur du climat, de l’humanité et de la vie sur terre. Nous représentons maintenant une force capable de déchaîner une machinerie très destructive pour notre environnement. Nous nous développons à un rythme sans précédent dans un système fini et ce système fini ne cesse de me rappeler que nous avons un problème à régler. J’ai deux enfants de 19 et 16 ans et je m’inquiète pour leur futur. Je pense que nous sommes sortis de la période d’abondance et de pleine croissance – j’ai connu la croissance pendant une grande partie de ma vie. Nous passons d’une période faste à une autre de pénurie.
Interview réalisée par Andrea Blanch
Musée
310 Greenwich Street, 22K
New York, New York, 10003
USA
+1 212 571 0588
[email protected]
http://museemagazine.com/contact/
http://museemagazine.com/magazine/issues/musee-magazine-no-7-vol-2-energy