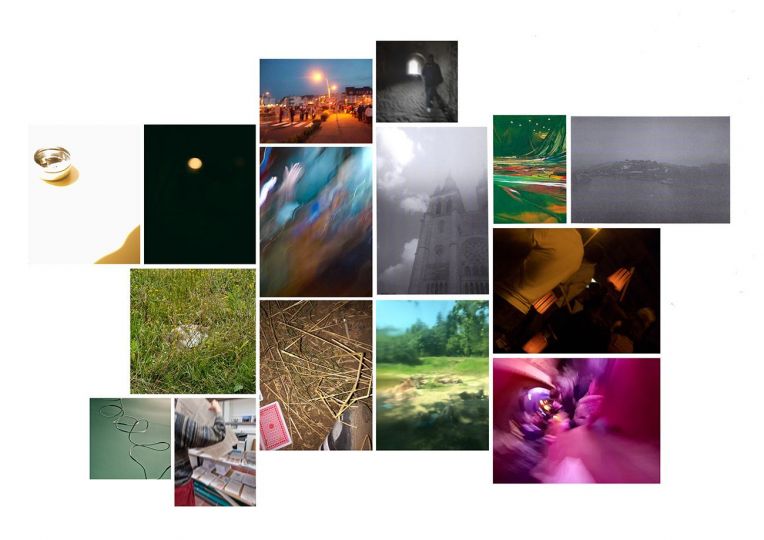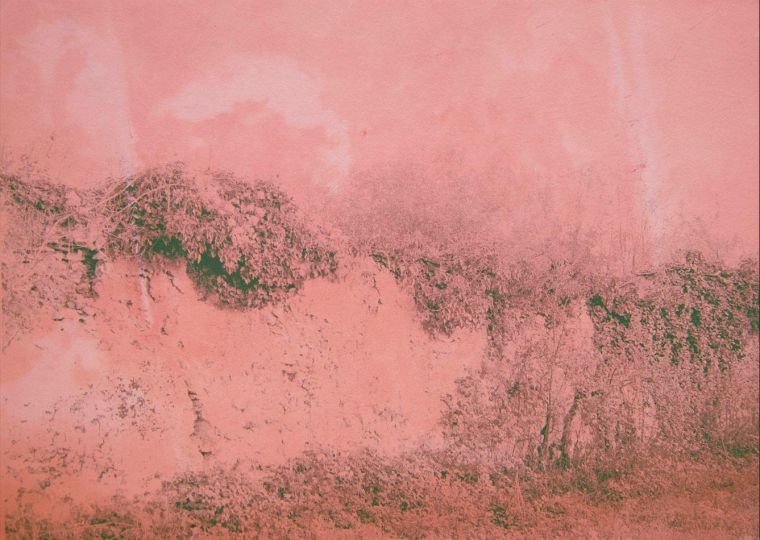MARGARET WATKINS ENFIN
Certains considèrent leur travail comme l’à-côté rémunérateur d’une existence légère et festive. (Moi, je veux qu’il soit tout). – Margaret Watkins
« Nous voyons encore le monde à travers vos yeux. Merci. » Ainsi se conclut Les Yeux d’Orson Welles (2018), véritable déclaration d’amour de Mark Cousins au plus grand réalisateur que le cinéma ait jamais connu. Ces mots, épigraphe finale aussi belle que pertinente, siéraient tout autant à la photographe canadienne Margaret Watkins (1884–1969). Car lorsqu’il lui fallut fournir un autoportrait promotionnel, cette artiste à la carrière florissante, dont l’œuvre moderniste a parcouru le monde entier et transformé le concept d’image publicitaire dans le New York des années 1920–30, choisit bien évidemment une photographie façonnée au gré du temps et de la lumière, filtrée par le prisme si particulier de son propre regard.
Comme le fera plus tard la peintre finlandaise Helene Schjerfbeck dans sa célèbre et ultime série de tableaux de la Seconde Guerre mondiale, Watkins s’expose sans fard – visage de femme réduit à sa plus simple expression, lèvres pincées, tête un peu inclinée vers l’arrière, en légère contre-plongée ; ni flatteur ni frivole, mais en aucun cas dénué de beauté. « Mlle Watkins a réalisé cet autoportrait aux moyens d’un ingénieux mécanisme », avait-elle tapé au bas des clichés destinés à la presse. Consternée par les retouches qu’un journal newyorkais avait apportées à son portrait, et qui lui donnaient l’image d’une jeune tentatrice, en illustration d’un article d’octobre 1923 intitulé « La photographe dont les symphonies domestiques révèlent la beauté d’objets jusqu’à présent considérés comme banals », elle avait ajouté au dos : « Note au graveur : ne pas recouper, ne pas insérer dans un médaillon. Prière de ne pas retoucher ou colorer au point de faire ressembler à une femme fatale ».
Elle se disait « tatillonne » (son esprit n’était jamais au repos), mais c’est précisément la rigueur de son travail – sa minutie, sa résolution, son intégrité, ainsi que sa façon si particulière de regarder le monde et d’en faire ce qu’elle en fait, qui donnent à son œuvre cette dimension intégrale, ce tout. Watkins est en prise avec cette époque. Une époque qui, comme l’affirme Lynn Dumenil dans The Modern Temper: American Culture and Society in the 1920s, ne voit pas l’avènement « d’une nouvelle femme, mais d’une multitude de nouvelles femmes ». Elle n’admet aucune concession à la sottise : « Je ne me sens ni la hardiesse suffisante pour conclure un contrat, comme le font tant d’autres, ni cette capacité qu’ont certaines à minauder pour séduire le bureaucrate en cravate. Or, vous seriez bien surpris d’apprendre à quel point ces deux extrêmes régissent le monde supposément froid et impersonnel des affaires. Cela étant, quelques critiques apprécient mon travail à la fois pour son art et son originalité et, entourée des bonnes personnes, je suis capable de produire d’excellentes choses ».
En 1901 déjà, Charles Henry Caffin, bon ami d’Alfred Stieglitz, écrivait que la photographie en tant qu’œuvre d’art « consignera[it] les faits, mais pas en tant que tels ». Les « Symphonies domestiques », dont il est question dans le titre ampoulé mentionné plus haut, font référence à une série de scènes domestiques – qui sont tout sauf cela – prises par Margaret Watkins en 1919 et que l’on pourrait considérer comme son chef-d’œuvre. À elle seule, cette série atteste de sa fabuleuse compréhension de la nature intrinsèque de la photographie, mais aussi de la grande modernité et de l’enthousiasme avec lesquelles elle aborde ce support. Watkins expliquait qu’il lui fallait « des heures et une patience infinie pour assembler diverses lignes et tonalités de manière à créer un véritable ensemble rythmique ». C’est cette voix mélodieuse que l’on perçoit comme le fil conducteur des compositions de l’artiste, capable de sublimer la normalité de ses activités quotidiennes (qui auraient pu être celles de n’importe quel foyer de Manhattan à la fin des années 1910) sous forme de photographie à l’état pur.
Lorsque les « Symphonies domestiques » et 1 200 autres photographies de l’artiste refont surface à Glasgow au début des années 1970, le nom de Watkins a depuis bien longtemps sombré dans l’oubli. Tandis qu’elle s’est peu à peu effacée durant les quarante dernières années de sa vie pour y parfaire l’art de vivre seule, son brillant esprit reclus dans une maison victorienne remplie de livres et de valises poussiéreuses prêtes à retourner sur-le-champ à New York (« chez [elle] »), le hasard veut, qu’un beau matin, son existence casanière soit interrompue par l’appel d’un voisin sympathique désireux de lui rendre visite avec sa famille. Ce sera le début d’une longue série de visites au 41 Westbourne Gardens, et de discussions stimulantes (le « Third Programme » de la BBC sert immanquablement de fond sonore) sans un seul brin d’ennui. Jamais cependant ils n’évoqueront son passé.
Celle qui consomme de la benzédrine pour atténuer les symptômes du mal du pays et contenir ce « désespoir glacé » qui l’affecte, note ses humeurs et ses réflexions sur les vicissitudes de la vie sur le moindre bout de papier : « Les artistes me manquent plus que tout. Pris ensemble, ils ont tous les défauts de la Terre, mais en dépit de leurs vices (ou à cause d’eux), ils ont comme une étrange lueur de vision, quelque chose qui donne envie qu’on s’y attarde, qui va un peu plus loin que leur petit bout de nez ». Elle poursuit : « J’aspire à rentrer chez moi, mais je n’ai pas de chez moi ! Je me sens comme un chat errant sur le toit du monde ! »
Après quelque temps, la vieille dame confie à son nouvel ami une malle à trésors scellée, à n’ouvrir qu’après sa mort. « Il y avait des tirages platine-palladium et des tirages argentiques sur plaque gélatine. Il y avait aussi une série tellement inhabituelle que chacune des images qui la composaient me subjuguaient. On y voyait l’évier de la cuisine et la baignoire de son appartement newyorkais de Jane Street, à Greenwich Village », explique Joseph Mulholland dans la préface de Seduced by Modernity: The Photography of Margaret Watkins de Mary O’Connor et Katherine Tweedie. « Je les observais pendant des heures et des heures – oscillant entre fascination et désarroi. Moi qui pensais avoir connu Mlle Watkins. »
Née dans l’Ontario, à Hamilton, une ville en périphérie de Toronto, « Mlle Watkins » grandit sur King Street East entourée de sa mère, Marie, originaire d’Écosse et de son père, Frederick, marchand de son état, dans une maison qui se trouve avoir vu naître – heureuse coïncidence – la première photojournaliste femme de l’histoire, Jessie Tarbox Beals. Watkins y passe une enfance heureuse, jusqu’au début de l’adolescence : l’unité familiale commence à se désintégrer après que son père soit victime d’un grave accident de bicyclette lors d’un voyage familial en Europe, en 1897. Dès lors, ses deux parents sombrent dans divers degrés de folie. Margaret est prise en charge par l’une de ses tantes venue de Glasgow, tandis que sa mère récupère à l’asile psychiatrique de Hamilton et que son père, sujet aux lavages de cerveau du pieux Dr John Harvey Kellogg, au Sanatorium de Battle Creek, voit s’envoler ce qui lui reste de raison. Huit mois après la réouverture en ville de son grand magasin d’alimentation et articles en tout genre, il fait faillite. Tout le reste de sa vie, Margaret Watkins balaiera toute tentative extérieure d’interférer avec sa capacité à « observer et tenir compte de [ses] propres impressions ».
En novembre 1908, lasse de Hamilton et du contexte familial, l’artiste de 24 ans fait ses valises. « Certaines personnes ont des pensées si belles et orthodoxes – tels des petits chiens en peluche tirés sur des roulettes par la ‘laisse’ des opinions héritées, mais incapables de se déplacer par eux-mêmes », écrira-t-elle. « Les gens sont des moutons. Laissez-moi être le mouton noir, ne serait-ce que pour rompre la monotonie. » Dans sa quête d’excellence, elle part s’installer dans une sorte d’utopie industrielle, dans le village d’East Aurora (non loin de Hamilton, sur la rive américaine du Lac Ontario). Pendant un an et demi, elle y sera femme de ménage et y étudiera la conception de maquettes de livres.
Tenante du mouvement Arts & Crafts, la communauté de Roycroft est décrite en ces mots par Marie Via et Marjorie Searl dans Head, Heart, and Hand: Elbert Hubbard and the Roycrofters : « Ce qui avait commencé en 1895 comme une modeste maison d’édition, se transforma bientôt en une communauté de cinq cents artistes, artisans et autres ouvriers, attirés tout autant par le charisme de Hubbard que par la sympathie des lieux et l’allégeance plus ou moins stricte aux idéaux sociaux et artistiques des réformateurs anglais John Ruskin et William Morris. Une fois solidement établie, la communauté Roycroft continua de s’épanouir pendant encore une douzaine d’années en s’appuyant sur la force et l’énergie de son leader, mais aussi sur sa fortune et sur sa capacité à faire participer des gens de talent à son projet ».
Watkins quitte Roycroft pour le « camp » utopique créé par le poète et musicien Sidney Lanier (à Eliot, dans le Maine), un sanctuaire pour gens de tout âge souhaitant apprendre « l’art de vivre ». Malgré une première impression négative (à son arrivée, elle les trouve « tous fous »), elle s’y occupera pendant trois ans des tâches administratives et y explorera les possibilités de la photographie. Plus tard, après avoir emménagé à Boston en 1913 pour se former durant quelques années au sein d’un studio photographique, elle y retournera en qualité de photographe et conceptrice officielle des représentations en extérieur de paraboles bibliques montées par la communauté. Quelle ironie de penser que l’une des représentantes les plus éclairées de la photographie moderniste à être sorties de l’oubli ait travaillé pour une communauté connue pour son antimodernisme, et y ait pris des clichés fortement influencés par le pictorialisme de l’époque.
Opposée au vérisme, l’approche pictorialiste s’écarte de la réalité de la vie et, pour rendre la photographie séduisante aux yeux de la classe aisée, à une époque où l’appareil photo est devenu un objet du quotidien, n’hésite pas à immortaliser les « filles de l’aurore » chantant les louanges du dieu Pan sur fond de forêts idylliques et autres tableaux d’un passé merveilleux.
Dans son ouvrage intitulé Clarence H White and His World: The Art and Craft of Photography, 1895–1925, Anne McCauley décrit la façon dont « la participation et la présence accrues des structures institutionnelles dans les expositions régionales et internationales, mais aussi le nombre de plus en plus important de revues destinées au marché amateur et de clubs, nés après la commercialisation de la plaque sèche gélatine (qui simplifiait la préparation des négatifs), ont marqué un tournant décisif avant même l’avènement de l’appareil Kodak, en 1888. Au tournant des années 1890, tout le monde semblait s’adonner à la photographie, mais, à l’image des communautés Snapchat d’aujourd’hui, il s’agissait d’un phénomène de groupe – on organisait des excursions, on comparait son travail lors d’expositions, on se rencontrait chaque mois pour assister à des cours sur le sujet et l’on se réunissait dans les chambres noires des clubs de photo pour y partager des conseils. »
En 1914, Margaret Watkins paie 150 dollars pour participer au premier d’une série de camps d’été organisés par la Clarence H White School of Photography, où elle deviendra elle-même une enseignante exigeante, néanmoins populaire et respectée. Ces cours d’été s’appuient sur la vision de leur fondateur, dont l’approche plus moderne du pictorialisme s’inspire de la géométrie compositionnelle. Réunis sous les arbres, les élèves partagent un esprit communautaire propre au mouvement Arts & Crafts, se caractérisant moins cependant par la nostalgie d’une pseudo-innocence préindustrielle, que par un enseignement d’excellence dispensé par certains des meilleurs professeurs du pays (parmi lesquels le peintre Max Weber, en 1914). C’est sous l’influence de White, qui deviendra son tuteur, ami, voire même amant, que Watkins découvre sa vocation de photographe.
Comme l’explique Gerry Badger dans The Genius of Photography, « la photographie moderniste évolue un peu différemment en Europe. Pour les modernistes américains, la pureté du support est primordiale. La netteté et la tonalité de l’image sont également importantes, au point, presque, de vouer un culte à l’obtention d’un cliché à la tonalité parfaite ayant l’éclat d’un joyau ». Watkins cultive déjà cette obsession pour la réalisation des meilleurs tirages possibles lorsqu’elle sue sang et eau dans la chambre noire du studio de portraits d’Arthur Jamieson, à Boston. À l’école de Clarence H White, elle devient experte en techniques et bains de développement de négatifs.
C’est aussi là qu’elle gagne ses galons de photographe moderniste. Comme l’écrivent O’Connor et Tweedie dans leur ouvrage, « d’une certaine façon, White a su insuffler l’idée selon laquelle la construction d’une image devait être structurellement bonne, quelle que soit la banalité du sujet ». Son premier chef-d’œuvre, Opus I (1914), est une symphonie triangulaire représentant trois bateaux de pêche. Bien qu’en haut de l’image, un des deux pêcheurs soit coupé en deux (il n’est pas utile à la composition) et que la photographe emploie un léger flou pictorialiste, son cliché n’en resplendit pas moins de tout l’éclat du modernisme. Il ne s’agit pas d’une image réaliste de bord de mer, mais d’un regard porté sur les réalités de la photographie.
Jusqu’au début des années 1920, ses portraits de femmes puisent dans l’art de la Renaissance, sans considération particulière pour l’imitation des portraits peints chère au pictorialisme. Défenseuse innée de la cause féminine, Watkins vénère la sororité de son époque. Elle célèbre également la peintre animalière française du XIXe siècle, Rosa Bonheur, qui n’hésitait pas à se déguiser en homme pour sillonner les marchés aux bestiaux, les abattoirs et autres lieux du même style, alors interdits aux femmes, afin de nourrir son art d’images prises sur le vif : « À une époque où toutes les jeunes femmes de bonne famille, éduquées dans un univers de préciosité et de délicatesse, s’évanouissaient à la vue d’une souris ou s’affairaient à broder des bêtes sauvages avec des perles et de la laine, Rosa Bonheur en tenue de paysan, cheveux coupés courts et raie au milieu, allait observer en personne les bestiaux et les chevaux des marchés de Paris. Ce n’était certes ni joli à voir ni digne d’une dame, mais c’est ce qui a fait d’elle l’un des plus grands peintres animaliers de l’histoire ».
Margaret s’installe à Manhattan à la mi-octobre 1915. Puis, ayant hérité d’une somme assez confortable en 1917, elle emménage dans son propre appartement au 46 Jane Street, à Greenwich Village. Seulement douze ans plus tard, du fond de son exil glasvégien, elle se remémorera avec délectation cette époque lointaine : « Mon ‘chez moi’ ne l’était même pas tout à fait, car durant mes dix premières années seule, j’ai vécu chez d’autres gens, dans des petites chambres louées, aménagées dans les recoins ou les bouts de couloirs. Ce fut donc une joie immense d’avoir pour moi seule une chambre, une salle de bain et un salon (avec son petit ‘coin cuisine’) et même d’une pièce supplémentaire où accueillir des locataires ou des amis ; de farfouiller dans les boutiques de bric-à-brac et les magasins d’antiquités, des caves aux greniers, pour y dénicher toutes sortes de bricoles aussi décrépites que fascinantes ; et de mélanger tout cela à quelques affaires choisies de chez moi. Bref, je ne me suis jamais autant amusée. »
La joie ressentie par l’artiste est flagrante dans les photographies qu’elle prend au cours de cette période. Il est à noter que cette décennie passée sur Jane Street est la seule de sa vie où elle est libre d’évoluer à sa guise dans un lieu lui appartenant tout à fait. Dans The Kitchen Sink (L’Évier de la cuisine), prise en 1919, la vie moderne a quelque chose d’éblouissant (« Les ‘objets’ en tant que tel ne sont pas censés avoir un quelconque intérêt ; ils participent uniquement à la construction de la photo », explique-t-elle.) À l’évidence, il s’agit là de la rupture que Walker Evans désirait tant voir survenir dans la photographie d’art – « une définition de l’observation, complète et ressentie » – un accord visuel qui frappe l’esprit.
Les « Symphonies domestiques » trouvent un écho chez les poètes imagistes des années 1910. « Une image », explique Ezra Pound, « présente un complexe intellectuel et émotionnel à un instant précis ». Les préceptes imagistes se résument en six points (ici légèrement condensés) : 1. « Utiliser le langage courant, en employant toujours le mot exact, sans approximation ni fioriture ». 2. « Créer de nouveaux rythmes ». 3. « Permettre une liberté absolue dans le choix du sujet ». 4. « Présenter une image ». 5. « Produire une poésie aux contours nets et précis, jamais flous ou vagues ». 6. « Enfin, (la plupart d’entre nous s’accorde à penser que) la concentration est l’essence même de la poésie. »
Représentations visuelles de l’ingéniosité féminine, les « Symphonies domestiques » font également référence aux inlassables – voire obsessives – tâches effectuées en chambre noire (souvent jusque tard dans la nuit), à une époque où Watkins vient de passer quatre ans au studio de la célèbre portraitiste Alice Boughton, sur East 23rd Street. Dans son discours au Newark Camera Club intitulé « How Art Enriches My Life » (Comment l’art rend ma vie plus riche), Watkins évoquera cet aspect particulier du métier de photographe. Pour elle, il s’agit d’une tâche « ingrate, salissante et technique, qui requiert de la patience, de la persévérance et beaucoup de précision. Bien avant de réaliser un chef-d’œuvre, il faut se retrousser les manches, manipuler du poison – en évitant de renverser le cyanure dans le bain – et plonger les mains dans l’eau glacée jusqu’à ce qu’elles pendent, sans vie, de vos poignets ».
Bien qu’Alice Boughton soit désordonnée et ait une fâcheuse tendance à négliger les facettes techniques de la photographie, elle et Watkins unissent leurs efforts pour forger des alliances commerciales entre les femmes entrepreneures de la ville. Ainsi, Boughton présente son associée à une brochette de femmes hautes en couleurs (elle en photographiera certaines), parmi lesquelles Nina Broderick Price. Dans le cliché intitulé Portrait of Nina B Price (1925), pris dans la superbe demeure art déco de l’éditrice, le sujet brille par son absence. Watkins inclura un exemplaire de ce portrait imaginaire au dos du livre de Katherine Dreier, Modern Art, publié en 1926 à l’occasion d’une exposition au Musée de Brooklyn, en ajoutant en couverture le portrait de celle-ci, Katherine Dreier at Home (Katherine Dreier chez elle) (1926). Dreier est connue pour sa participation au mouvement avant-gardiste américain et a fondé La Société Anonyme Inc. aux côtés de Man Ray et de Marcel Duchamp, à New Jersey, en 1920. Quelque chose pousse pourtant Watkins à ajouter cette inscription ambiguë sur le tirage : « Cette photo évoque-t-elle l’habitat d’une artiste ‘moderne’ ? »
L’Amérique des Années folles reste imprégnée de valeurs traditionnelles. « L’Ère réformiste (1900–1914) qui a précédé la Première Guerre mondiale laisse place dans les années 1920 à une période de conservatisme dans laquelle hommes politiques et experts glorifient le ‘Big Business’ en tant que sauveur de la démocratie et de l’entreprise aux États-Unis », écrit Lynn Dumenil dans The Modern Temper. Pour son portrait du sévère H E Vance (1926), qui figure parmi les photos qu’elle expose, Watkins, moqueuse, a un surnom tout trouvé : « Babbitt ». Dans son Only Yesterday: An Informal History of the 1920s, paru en 1931, Fredrick Lewis Allen explique : « Les intellectuels n’avaient qu’à lire les œuvres de [Sinclair] Lewis, [Main Street (Grand-Rue) (1920) et Babbitt (1922)], pour comprendre que les aspects de la vie américaine qu’ils méprisaient et craignaient le plus étaient précisément ceux que l’auteur avait mis sous son microscope pour mieux les disséquer. George F Babbitt était l’ennemi juré des esprits éclairés, et c’était bien la mentalité de la Grand-Rue qui entravait la civilisation américaine ».
Malgré ses longues années d’enseignement à la Clarence H White School, ce n’est pas à elle que revient le poste de professeur principal, lorsque celui-ci se libère en 1924, mais à un étudiant de l’école, Paul Outerbridge. Durant le reste de sa période newyorkaise, elle se maintient au cœur de l’action et se tourne vers la photographie publicitaire, dans laquelle elle déploie autant de ferveur et de finesse que pour ses autres projets. Ainsi, elle est l’exemple même de ce que le publicitaire Earnest Elmo Calkins décrit en 1928 : « Les hommes qui produisent des pièces d’art publicitaire sont aussi ceux dont les œuvres sont présentées dans les expositions. Il n’y a plus de distinction entre l’art en tant qu’art et l’art en tant que commerce, libéré des stigmates d’autrefois. Les artistes s’aperçoivent que la publicité leur offre une opportunité tout aussi intéressante que n’importe quelle autre non seulement d’être bien payés pour leur travail, mais aussi de concrétiser leurs ambitions artistiques sans avoir à sacrifier leurs standards ou leurs idéaux ».
Parmi les plus fervents admirateurs de ses photographies, en particulier de celles qui offrent au regard des surfaces à la géographie immaculée dans lesquelles elle isole des groupes d’objets singuliers, qu’elle fragmente pour créer de nouvelles perspectives, figure le directeur artistique de Condé Nast, Heyworth Campbell. Entre 1924 et 1928, la production commerciale de Watkins orne les pages de tous les magazines, à travers tout le pays. « Même l’homme d’affaires le plus rétif à la moindre œuvre un tant soit peu artistique peut voir que son produit est mis en valeur par des tonalités aux nuances fines et par la beauté de textures contrastées », affirme-t-elle en 1926 dans un texte intitulé « Advertising and Photography » (Publicité et Photographie) :
« Avec Cézanne, Matisse et Picasso est née une nouvelle approche. L’expression des sentiments y était tabou, la romance raillée, l’anecdote méprisée ; la beauté du sujet fut remplacée par la beauté de la construction, la relation entre les idées supplantée par la relation entre les formes. Des choses étranges et surprenantes prirent place sur la toile ; d’austères objets mécaniques révélèrent soudain une dignité insoupçonnée ; des articles ordinaires dévoilèrent des courbes et des angles répétables à l’envi, comme autant de variations sur le même thème d’une fugue. Le photographe à l’écoute vit la chose, s’arrêta un instant et saisit son appareil ! Et tandis que les plus conservateurs exposaient encore des photographies belles au sens généralement accepté, des compositions bizarres commencèrent à étonner les jurys ; des images originales peut-être, mais rarement jolies, témoignant de choix apparemment étranges et difficiles à accepter pour les plus orthodoxes ».
De superbes œuvres de Watkins, dont Design – Curves et Design – Angles (toutes deux de 1919), sont recoupées pour les besoins des publications commerciales. C’est aussi le cas de ses photographies destinées au savon pour le visage Woodbury et au fromage Phenix, ou encore de son Untitled (Still Life, Glasses and Pitcher) (Sans titre : Nature morte, Verres et Pichet) utilisé en 1924 par la Compagnie du Verre Fostoria, dans lequel l’artiste amplifie la présence des articles de verre par sa passion pour l’intangibilité des ombres (une idée copiée deux ans plus tard par le photographe Albert Renger-Patzsch, de la Neue Sachlichkeit). Autant d’exemples précoces d’une photographie publicitaire déjà tournée vers l’avenir. O’Connor et Tweedie ont raison d’affirmer que « Watkins a modernisé sa forme sans céder à la propreté de la modernité ».
Dans sa réflexion sur l’Amérique des années 1920, Fredrick Lewis Allen décrit la façon dont, pour la jeune génération, « le victorianisme a quelque chose d’à la fois indécent et drôle […] En fait, certains semblent persuadés que toutes les époques antérieures à l’avènement du modernisme ne peuvent avoir été que ridicules – à l’exception de la Grèce antique, de l’Italie du temps de Casanova, de la France à l’époque des grandes courtisanes et de l’Angleterre du XVIIIe siècle ». Les nus, portraits et photographies de gens en extérieur de Watkins font référence à ces périodes. Elle se moque des maniérismes affectés des jeunes femmes de l’époque victorienne dans sa facétieuse photo de 1924 Untitled (Verna Skelton Posing for Cutex Advertisement) (Sans titre : Verna Skelton prenant la pose pour une publicité Cutex). (Dans une autre très belle étude pour la même marque de vernis à ongles, on voit la main d’une coquette en gros plan faisant tournoyer un collier de perles.) Dans le même temps, sa photographie commerciale influence aussi ses œuvres personnelles, comme la splendide Head and Hand (Tête et Main) (autour de 1925), sur laquelle une main de femme tient délicatement en son creux une petite tête de femme endormie.
À l’été 1925, lors d’un voyage scolaire avec un groupe d’étudiants, à Mexico, Clarence White est victime d’une crise cardiaque et décède. Il a 54 ans. Lui et Watkins ont collaboré intensément à la création d’un portfolio des plus belles œuvres de White, qu’ils espèrent voir un jour partir au Metropolitan Museum of Art. Les deux artistes ont convenu que Watkins achèterait les 44 tirages moyennant la somme symbolique de dix dollars – en partie parce que l’école traverse des difficultés financières et que Watkins n’a pas été rémunérée depuis longtemps pour son travail d’enseignante, mais aussi parce qu’elle est la seule dont l’expertise et l’autorité ne font aucun doute pour White.
À la mort de White, le portfolio se trouve encore dans son établissement. L’année suivante, les œuvres qu’il contient ressurgissent lors d’une exposition de commémoration organisée par Pictorial Photographers of America, à l’Art Center de New York : l’épouse de White, suspicieuse, les a vendues à la Bibliothèque du Congrès. Une fois l’exposition terminée, le 1er mai, Watkins fait retirer des murs les tirages qu’elle estime devoir conserver. Elle les perdra au cours du procès qui s’ensuivra. Elle perdra aussi ses associés et sa place à l’Art Center, avec lequel elle avait entretenu des liens étroits pendant des années et où elle avait exposé une seule fois en solo en 1923.
En août 1928, Margaret Watkins part passer trois mois de vacances à Glasgow. Jamais elle ne reviendra de sa « cure de repos » et ne quittera sa maison victorienne, avec ses tantes mourantes et ses canalisations percées.
Une semaine après l’arrivée de Margaret au 41 Westbourne Gardens, tante Anna tire sa révérence. Dans une lettre adressée à un(e) ami(e), deux ans plus tard, elle décrira à quoi ressemble sa vie dans la maison d’enfance de sa mère : « La plus jeune [Grace] (!), qui a 77 ans, est alitée depuis cinq ou six ans ; puis il y a la suivante [Jane], 80 ans, encore vaillante quoique très chancelante et sujette à des tourbillons de révolte intérieure des plus extrêmes ; enfin, il y a l’aînée, [Louisa/Louie] 86 ans, vraie dynamo humaine qui adore le cinéma, voudrait régenter jusqu’au système solaire et est furieusement outrée si j’ai le malheur de lui suggérer qu’elle n’est peut-être plus aussi forte qu’elle l’était au bon vieux temps ». Watkins est consciente d’être « la seule parente féminine disponible et suffisamment détachée pour s’occuper d’elles. Et quel travail cela représente ! Bien plus que je n’aurais pu l’imaginer ; sachant que ni mon tempérament ni mon caractère ne me prédisposaient vraiment à devenir curatrice honoraire d’un foyer pour vieilles dames ! Mais c’est ainsi – il n’y a pas le choix ! »
Jusqu’à leur mort, elle ne s’échappera que trois fois de cette « tan(t)ière ». À l’automne 1928, armée de son Graflex, Watkins se rend à l’immense Pressa, à Cologne, salon international sur les avancées récentes en matière de conception graphique, d’impression, d’édition et de publicité occupant trois salles d’exposition et 42 bâtiments, sur trois kilomètres le long du Rhin. El Lissitzky (qui se trouve en Allemagne à l’époque) est commissaire des fascinants intérieurs du Pavillon soviétique, dont un photomontage mural intitulé The Task of the Press is the Education of the Masses (Le Rôle de la presse est d’éduquer les masses), réalisé par les rares artistes d’avant-garde encore autorisés à briller au seul prétexte que Staline tient à convaincre l’Occident de la supériorité de son premier plan quinquennal. Watkins, qui est friande de ce genre de petits miracles du quotidien, savoure l’expérience.
Après le salon Pressa, elle passe deux mois à Londres, mais, fauchée et malade, elle doit retourner au « sarcophage » de Westbourne Gardens en début d’année. Son état de santé empire lorsqu’elle apprend par son amie Polly que son appartement de Greenwich Village – seule et unique adresse qu’elle ait jamais considérée comme la sienne – devra être évacué à l’été pour permettre la destruction de l’immeuble. « J’ai perdu toutes mes attaches newyorkaises », écrit-elle à l’âge de 46 ans. « C’est la situation la plus démoralisante qu’il m’ait jamais été donné de connaître. Maintenant que Jane Street a disparu et qu’il ne me reste plus aucune base, je ne vois vraiment pas comment je vais pouvoir reprendre ma vie à New York. » Elle se fait une petite chambre noire au dernier étage de la « tan(t)ière » afin de rester en lien avec la photographie et l’art de jouer avec du poison, devient membre associée de la Royal Photographic Society de Londres et, au niveau local, membre de la Glasgow and West Scotland Photographic Association, où on la connaît comme l’étrangère au style vestimentaire original et au travail photographique inhabituel.
Le 18 septembre 1931, elle envoie à sa tante Jane une lettre de Paris : « J’ai commis beaucoup d’erreurs, comme des doubles expositions, oublier d’inscrire l’heure, etc., mais le lot qui m’est revenu de la boutique aujourd’hui est assez prometteur. C’est toujours plus sage de développer soi-même ses photos quand on le peut, cela permet d’adapter le traitement au sujet, mais il fallait que je sache si celles-ci étaient exploitables ou non et j’ai dû refaire plusieurs choses pour en améliorer la composition ou obtenir un meilleur éclairage. J’aurais beaucoup d’argent à ramener si je ne l’avais pas dépensé en pellicules et en développements, mais après avoir consacré près de vingt ans à ce métier, il me semblait un peu idiot de tout laisser tomber. Alors quand l’intérêt est revenu, j’ai décidé de jouer mon va-tout et d’avoir matière à travailler pour l’hiver ».
L’été précédent, durant la première semaine d’août, elle retourne sur le Continent afin de participer au 8ème Congrès international de photographie scientifique et appliquée de Dresde. Elle en profite pour passer un peu de temps dans la capitale allemande, récemment immortalisée par le cinéaste Walther Ruttmann dans son chef-d’œuvre moderne, mécanique et rythmique Berlin, Symphonie d’une grande ville (1928), joyau du cinéma de la période de Weimar. Toutefois, c’est à l’Exposition coloniale internationale de Paris de 1931, qui remplit tout le Bois de Vincennes, que Watkins se remet sérieusement à la photographie. Sur ses 26 territoires, la France a anéanti un grand nombre d’indigènes, tout comme les autres « empires ». Bien que l’Exposition mette en scène des personnes comme s’il s’agissait d’animaux dans un zoo, pour Watkins, il s’agit « littéralement [d’]un voyage autour du monde en un seul jour ! »
Watkins aime l’effervescence qui règne sur et autour de la Seine. Elle écrit à sa tante Jane : « le fleuve me fascine tant que j’ai réalisé toute une série d’images de la vie qui l’entoure : d’immenses embarcations qui servent de sanitaires aux pauvres ; des petits bateaux à vapeur qui arrivent et repartent des quais, surchargés de vacanciers ; de longues et plates barges à charbon venant du Rhin par le canal ; des pêcheurs à bord de petits bateaux pointus, d’autres suspendus au-dessus des chaperons et des marches de pierre qui descendent jusque dans l’eau ; des artistes partout, installés n’importe où pourvu qu’ils puissent y planter leur chevalet ; un homme qui sort les entrailles d’un matelas avec une sorte d’outil à bascule, tandis que sa femme les remet dans la housse ; un couple de chiens terriers qui se font gratouiller par leur maîtresse ; des grues, des pelles à vapeur et d’énormes tas de pierre et de sable destinés aux nouveaux docks ; un demi-acre de barriques de vin enroulées les unes autour des autres ; des clochards qui préparent à manger là où ils peuvent, d’autres qui lavent leurs vêtements en même temps qu’eux-mêmes, et tout le long des parapets des ponts, un noir chapelet de têtes et d’épaules appartenant à des messieurs qui ‘excellent dans l’art de ne rien faire’ ».
À Paris toujours, elle photographie les affiches, les devantures, les commerçants des Halles, des fragments d’immeubles et la Tour Eiffel sous des angles indirects, rien de bien spécial. Elle renoue avec la modernité dans son Self-Portrait (Autoportrait), où elle pose devant la colonne de la Place Vendôme, cachée derrière son gros appareil tandis qu’un policier vient parfaire une image déformée qui se reflète entièrement dans le chrome bombé du phare d’une voiture garée là.
Lorsque Margaret Watkins réalise The Bathroom Window (La Fenêtre de la salle de bain), dans le cocon de son appartement newyorkais, en 1923, les fenêtres sont fermées et les rideaux tirés : ce monde de Greenwich Village se suffit à lui-même. À l’inverse, les fenêtres des « scènes » qu’elle photographie à l’automne 1931 durant son séjour à Londres sont toutes ouvertes, comme pour permettre à l’artiste de fuir à tout moment.
Si la trame utilisée à Londres est la même que celle utilisée à Paris, ses productions londoniennes sont beaucoup plus fortes et déterminées et reflètent la volonté de l’artiste de réimaginer sa pratique de photographe. Elle rencontre ses collègues de la Royal Photographic Society, où elle voit une exposition sur la photographie en couleur (un type de photographie qui a éveillé son intérêt il y a quelque temps déjà), et se rend au Salon annuel de la photographie, à Londres, intitulé Invention in Design, qui inclut un certain nombre de ses photos nord-américaines. Dans ses « photos de rue » londoniennes, il n’y a pas âme qui vive – signe du dépouillement qu’elle traverse alors – mais en dépit de leur morosité (Stairway to Where (Un escalier pour où ?), elles laissent transparaître le délicieux regard de Watkins sur le monde.
Le dernier voyage de l’artiste a lieu à bord d’un navire de fret reliant London Bridge à Leningrad par le Canal de Kiel, en août 1933. Watkins a soif d’en apprendre davantage sur l’avant-garde artistique soviétique et sur les effets du stalinisme sur l’art, en rapport avec les récents crashes financiers qui ont frappé les États-Unis et l’Europe. Avant le départ du train pour Moscou, Watkins réussit à fausser compagnie au groupe avec lequel elle s’est rendue jusqu’à Leningrad (dont le Secrétaire de la Royal Society of Arts, Peter Le Neve Foster) et prend [sa] première photographie – une statue du tsar Pierre le Grand sur son cheval – tandis que le groupe reste faire un deuxième énorme repas à l’hôtel ».
Dans leur biographie, Mary O’Connor et Katherine Tweedie racontent : « En général, les arts visuels et les arts du spectacle, par la radicalité de leur forme et de leur contenu, laissent Watkins abasourdie, mais il faut dire qu’elle assiste aux prémices d’un bouleversement fondamental dans le monde de l’art soviétique. À Moscou, elle va voir la rétrospective intitulée Artists of the Russian Federation over Fifteen Years (Quinze ans d’artistes de la Fédération de Russie) [1917–32], qu’elle ‘fréquente assidûment deux demi-journées durant [et] apprécie jusqu’à n’en plus pouvoir’. Le rejet du formalisme y est inscrit en filigrane. L’exposition a débuté à Leningrad l’année précédente ; à son arrivée à Moscou, elle a été copieusement remaniée : la principale omission concerne les peintures abstraites de Malevich, dont l’œuvre avait pourtant bénéficié d’une salle entière, à Leningrad. Entre-temps, le passage du constructivisme au social-réalisme dicté par Staline a frappé. À cette période charnière de 1933, la photographie, elle aussi, traverse une mutation, pour s’éloigner du formalisme et de la fragmentation de l’avant-garde, avec ses angles aigus et ses gros plans extrêmes. Toute marque d’individualisme est supprimée pour ouvrir la voie aux mythes de la nouvelle société soviétique. »
Contrairement à son élève Margaret Bourke-White, qui se laisse convaincre par la propagande staliniste sans la remettre en question, Watkins n’est pas crédule. Elle quitte l’Union soviétique avec 600 photos dont la teneur et la critique sociale, digne des œuvres d’August Sander, échappent aux censeurs. L’une de ces photos est Street Photographer, Moscow (Photographe de rue, Moscou). On y voit une pauvre femme en train de tricoter (probablement bien moins âgée qu’elle n’en a l’air) ; sur un trépied, son appareil est tourné vers un arrière-plan pathétique destiné à placer le sujet dans un monde lointain, à mille lieux de l’URSS.
Au cours de ses premières années à Glasgow, Margaret photographie l’angle ouest des Westbourne Gardens Park. Elle en offre une vue panoramique venteuse et semi-abstraite, depuis la demeure où elle va passer le reste de sa vie. Dans une lettre jamais envoyée, elle confie qu’« il serait vain de chercher à la vendre maintenant ; il n’y a aucune demande pour ce type de maisons et il paraît que les appartements sont moins recherchés qu’avant. Je pense que je ferais mieux de continuer à travailler. Si je survis aux tantes, j’essaierai de ranimer des liens et de vivoter avec mes fonds subsistants, tout en veillant sur ma santé et sur ce qu’il me reste de cerveau ». Watkins commence à errer dans le quartier du port – où elle n’est pas la bienvenue – telle une Rosa Bonheur sans déguisement, « afin de voir l’homme tel qu’il est, dans sa vraie perspective : une créature minuscule qui s’affaire nerveusement à la surface de la Terre » (autre métaphore de sa propre vie). Parmi les « monstres préhistoriques » qui peuplent le port, elle aime particulièrement la grue Finnieston, sur le Queen’s Dock – du haut de sa petite grue, Watkins, « battue par le vent frais, [se] penche au-dessus du garde-fou et regarde le toit du dôme trapu marquant l’entrée du tunnel ; les silhouettes réduites des camions et des hommes en contrebas ressemblent à des insectes pressés alternant entre ombre et lumière ». Le fleuve, le Clyde, devient son exutoire mental.
« Pourvu que je ne me transforme jamais en vieille fille acariâtre n’ayant que ses symptômes pour préoccupation », écrivit-elle un jour. En 1937, Watkins, qui vit maintenant seule dans sa maison de seize pièces, a pour principal projet de trouver des producteurs de textiles et de tapis pour donner vie aux designs kaléidoscopiques qu’elle a créés à partir de ses photographies les plus abstraites. Lorsque ce projet tombe à l’eau, elle se lance dans le commerce d’antiquités, en compagnie d’un(e) ami(e) lointain(e). Elle a le don de découvrir les objets les plus originaux du marché de Barrow, à l’autre bout de la ville, qu’elle fait envoyer par bateau à Toronto. Puis la Deuxième Guerre mondiale éclate. Durant cette période, Watkins fait une chose que d’autres Glasvégiens font moins volontiers, en ouvrant ses portes à des réfugiés. Après 1945, elle hébergera pendant encore quelques années plusieurs pensionnaires, dont Walter Süsskind (le chef d’orchestre de l’Orchestre national d’Écosse de l’époque).
Au milieu des années 1950, devenue agoraphobe, Margaret n’ose même plus s’aventurer hors de chez elle pour aller jusqu’à son club de cinéma, elle qui adore le cinéma. Les enfants qui passent devant sa maison pensent qu’il s’agit d’une maison hantée. Engoncée dans une sorte de torpeur créative, entourée de ses innombrables livres, rare chose qui l’intéresse encore, elle passe ses journées à noircir des calepins et des catalogues de souvenirs et de notes. Pour les auteures de Seduced by Modernity, « les multiples retours sur son passé – annotés sur les lettres de ses parents, les marges des livres et les catalogues d’exposition qu’elle avait achetés, ou sur les coupures de journaux qu’elle avait conservées – indiquent qu’elle souhaitait laisser une trace qui fasse sens. Parfois, nous avons senti qu’en vérité, elle attendait que des biographes poussent leur travail un peu plus loin, écrivent sur sa vie et comprennent son œuvre ».
Dans la préface du même livre, son voisin, Joseph Mulholland affirme : « Selon moi, Margaret Watkins est parvenue à son but. En me léguant cet héritage mystérieux, elle m’a aussi confié un devoir : en découvrir autant que possible sur qui elle était – et veiller à ce qu’on ne l’oublie pas. Pour ce faire, elle ne m’a laissé guère plus que quelques étiquettes au dos de ces merveilleuses photographies, une date de naissance et une date de mort, le souvenir d’une dame ayant un léger accent d’Amérique du Nord, et une maison dont chaque pièce était remplie de 200 ans de vêtements, de papiers et de meubles ayant appartenu à sa famille. Au cours de mes recherches, j’ai découvert des critiques d’expositions dans lesquelles ses photographies avaient été louées et récompensées, et j’ai peu à peu réussi à recoller les pièces de son histoire ».
En 1981, le Third Eye Centre de Glasgow présente la première rétrospective de l’œuvre de Margaret Watkins. Ce n’est que lorsque la Light Gallery, galerie de photos newyorkaise pionnière en son genre, présente des clichés de Watkins en 1984, que l’artiste commence enfin à être reconnue aussi au Royaume-Uni. Au cours de l’exposition Pictorialism into Modernism (Du pictorialisme au modernisme), produite par le Detroit Institute of Arts, qui fera le tour du monde de 1996 à 1998, son œuvre est considérée comme étant la « plus grande découverte de l’exposition ». Un autre livre sur Margaret Watkins est publié à l’automne 2012 lorsque la National Gallery of Canada d’Ottawa fait découvrir son travail au public canadien à l’occasion d’une exposition intitulée Domestic Symphonies.
Dans Tout ce qui est solide se volatilise : l’expérience de la modernité, Marshall Berman offre une magnifique description de la nature irrésolue du modernisme : « Être moderne, c’est vivre une vie de paradoxes et de contradictions. C’est être écrasé par le poids d’une bureaucratie géante qui a le pouvoir de contrôler et souvent de détruire toutes les communautés, les valeurs et les vies ; tout en restant déterminé à affronter ces forces, à se battre pour changer le monde auquel elles donnent naissance et à le faire nôtre. C’est être à la fois révolutionnaire et conservateur : ouvert aux nouvelles possibilités d’expérience et d’aventure, effrayé par les abîmes nihilistes auxquels mènent tant d’aventures modernes, avide de créer et de s’accrocher à quelque chose de tangible alors que tout part en fumée ».
À l’été 1962, alors même que tout autour d’elle part en fumée, Watkins écrit ces mots : « En novembre 1908, je suis partie de chez moi pour vivre ma vie et la gagner. (La Quête continue.) » En 1919, elle réalise son Untitled (Woman Holding Photographic Print) (Sans titre : Femme tenant une photo), un cliché si dynamique qu’il aurait pu être l’ingénieux portrait d’une femme d’aujourd’hui, au style ancien, tenant dans sa main un smartphone. Au milieu des années 1930, elle se photographie en train de gravir un escalier sous l’apparence d’une ombre portant un chapeau dans Untitled (Self-Portrait and Shadows) (Sans titre : Autoportrait et Ombres). Cette photographie, qui évoque les premières œuvres de la secrète Vivian Maier – dont l’œuvre fut révélée en 2007 – nous marque aussi par sa tristesse, puisque ce sera la dernière jamais prise par Margaret Watkins.
Au chat perdu sur le toit du monde : nous voyons encore le monde à travers vos yeux. Merci.
Tintin Törncrantz
Ce texte – traduit par Jean-François Allain – est un essai de Margaret Watkins : Black Light, publié en éditions française et anglaise par diChroma Photography à Madrid. Les dates et lieux actuels et futurs de l’exposition du même nom sont CentroCentro à Madrid (9 juin – 26 septembre 2021), Mai Manó House à Budapest (12 octobre 2021 – 16 janvier 2022) et Art Gallery of Hamilton, Ontario , Canada (12 février 2022–mai 2022).