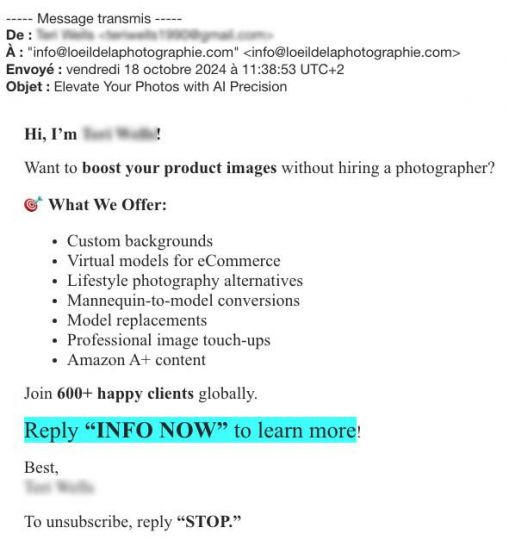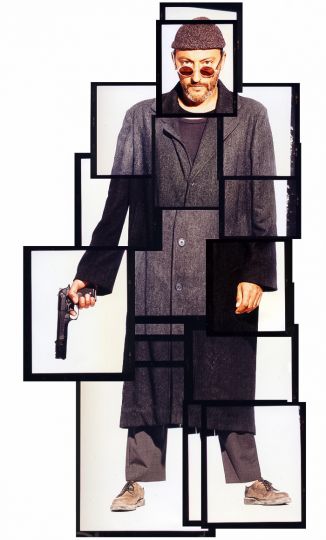Comme de nombreux lecteurs le savent, je suis l’auteur du blog hebdomadaire Photojournalism Now, qui propose une sélection éclectique d’actualités internationales sur la photo, en portant une attention particulière au photojournalisme et au documentaire social. Je travaille également sur ma thèse de doctorat, consacrée à l’évolution du photojournalisme et à l’impact des médias actuels sur ce genre spécifique. C’est un travail en cours, qui se poursuivra dans les années à venir, et qui implique d’interroger de nombreux professionnels du milieu.
S’il ne fait aucun doute que le photojournalisme vit une période de transition, il reste à débattre sur la signification de cette transition. Certains la considèrent comme une crise, d’autres comme une opportunité de se réinventer. Alors que de plus en plus de photographes se lancent dans le milieu, les missions rémunérées sont de moins en moins nombreuses. Nous apprenons presque quotidiennement que des journaux et des publications réduisent leurs départements photo. Les photojournalistes ont-ils toutefois besoin des médias traditionnels pour se faire une réputation, trouver un public et prétendre pouvoir changer les choses ?
C’est la question centrale de ma recherche. Si certains esquivent la question avec désinvolture en prétendant que les médias traditionnels ne font plus le poids face à la portée d’Internet, la réponse à cette question est multiple. C’est ce qui m’enthousiasme dans mon projet de thèse : le défi que représente l’analyse en profondeur de la complexité du photojournalisme et en quoi tout cela impacte la capacité de la photographie à éduquer et à susciter des changements. En fin de compte, j’espère produire une thèse profitable tant au niveau académique que pratique. Comme je l’ai dit toutefois, c’est un travail en cours. Tout en poursuivant mes recherches, je partagerai quelques réflexions à travers mes articles pour L’Oeil de la photographie ainsi que sur mon blog.
C’est ce qui m’amène à proposer cet article, le premier de ma participation mensuelle à L’Oeil sur le photojournalisme. Je vous invite à commenter et à soumettre vos informations ou idées pour de futurs articles. Le journalisme, qu’il soit écrit ou visuel, a tout à gagner à la collaboration. Nous ne pouvons pas être partout à la fois. Il y a tant de projets incroyables en cours sur la planète. J’aime l’idée de partager ici cette diversité.
La collaboration n’est pas un gros mot.
Au mois de novembre, FoAm, World Press Photo Foundation (WPPF) et DeBalie ont organisé un débat à Amsterdam avec les photojournalistes Susan Meiselas (également Présidente de la Fondation Magnum), Donald Weber, Pierre Terdjman de #Dysturb, et Bas Vroege de Paradox, organisation néerlandaise à but non lucratif qui développe des projets consacrés aux problématiques contemporaines, en collaboration avec des auteurs documentaires.
La discussion a abordé de nombreux points importants, notamment ceux du financement et de l’authenticité. La notion-phare du débat a toutefois été celle de collaboration, comme moyen pour les photojournalistes de tirer parti du nouvel environnement médiatique et de créer une industrie durable.
La remarque de Meiselas selon laquelle « nous devons passer de la compétitivité à la collaboration » a donné le coup d’envoi de la discussion, au cours de laquelle les participants ont exprimé ce que signifiait pour eux la notion d’environnement collaboratif dans le cadre du photojournalisme.
Weber a confirmé que la collaboration était essentielle pour produire un travail de qualité : « elle ne devrait pas être un défi, mais un fait. Je crois qu’elle devrait faire partie de notre langage. » Selon lui, la réticence passée des photojournalistes à collaborer était influencée par certains facteurs. « C’est peut-être à cause du côté héroïque du photographe. On a quelque chose de très important à dire donc on le garde pour soi. En faisant cela, on peut perdre de vue les possibilités que les autres peuvent nous offrir, que ce soit le spectateur ou le collaborateur, qui détiennent une information qu’on n’a pas, ou qui ont connaissance d’un sujet quelconque que nous ignorons. »
Il a poursuivi : « En photojournalisme notamment, c’est presque un interdit de collaborer avec son sujet, de s’engager largement auprès de lui, jusqu’à ce que cela influence notre photographie et notre façon de raconter. On nous incite à prendre du recul … Je crois vraiment à tous les types de collaboration. Que ce soit pour une heure ou pour tout un projet, nous devons attirer les autres, pas seulement parce qu’ils nous aident à réaliser de grands projets, mais aussi parce qu’on travaille avec eux, ils sont nos sujets, et notre public aussi. »
Une collaboration peut prendre des formes diverses. Elle peut se situer sur le plan d’un investissement direct dans la création mais aussi du financement, de la réception ou de la distribution. Paradox travaille avec des auteurs documentaires depuis 1990. Vroege a expliqué avoir constaté un passage d’un modèle Business to Business (B2B) à un modèle Business to Consumer (B2C), où le producteur, ici le photographe, est désormais en mesure d’intéresser directement son public. C’est un changement signifiant par rapport au modèle B2B, où les médias traditionnels contrôlaient l’étendue de l’audience et son engagement.
« Paradox est arrivé lorsque les médias traditionnels ont cessé de soutenir le photojournalisme, dans les années 1990 » a déclaré Vroege. « Fondamentalement, nous suivions encore en de nombreux points (à l’époque) le modèle business to business, mais en portant notre attention sur le Web Documentaire. Ensuite, Apps a permis l’émergence de tout un monde nouveau, qui permet de construire des relations durables avec de très nombreux consommateurs. »
Selon lui, le plus difficile dans le modèle B2C, c’est de maintenir l’intérêt des consommateurs. Si les plateformes de crowfunding comme Kickstarter sont des outils formidables, chaque projet a potentiellement une audience spécifique, qui requiert une approche différente propre à générer l’intérêt et l’engagement. « Cela vient s’ajouter aux problèmes des temps difficiles que nous vivons tous actuellement. La tragédie, c’est que l’audience la plus stable pour nous tous… ce sont les gens du milieu, la communauté photographique… C’est vraiment dur. »
Montre moi l’argent
Nous sommes tous d’accord que c’est un moment difficile du point de vue financier. Comme l’a dit Meiselas, « La visibilité ne paie pas le loyer ». Un grand nombre de partisans en ligne n’est pas synonyme de revenus, et cette évidence est au coeur de ce qui affecte l’industrie et au cœur de ma recherche; nous avons tous à notre disposition des outils étonnants et le potentiel d’atteindre directement le public, mais comment les photojournalistes peuvent-ils gagner leur vie dans ce nouvel environnement des médias?
Weber a dit: «Je pense qu’il est probablement beaucoup plus difficile aujourd’hui de financer quelque chose, mais je crois aussi de nos jours c’est diablement plus facile d’obtenir que quelque chose soit financé. Ca me rappelle ce que disait Kevin Costner dans le film Field of Dreams – «si vous le construisez, ils viendront». C’est une phrase terriblement cucul, mais je pense sincèrement que quand on se met à faire quelque chose, les gens réagissent si on le fait avec passion, professionnalisme (et) désir. Si vous démontrez qu’un projet a du sens et de la valeur, les gens vont soutenir ce travail et le financement peut suivre. Peut-être que quelqu’un viendra vous voir et dira qu’il veut donner 50 dollars de contribution. 50 dollars c’est mieux que zéro dollar. De là, vous pouvez contacter une autre organisation et faire une demande de financement.” Et cette ligne de raisonnement nous ramène à ce que dit Vroege: la collecte de fonds pour un projet nécessite de travailler sur de multiples plateformes. Et elle exige que les photojournalistes soient des entrepreneurs.
L’expansion du public pour le photojournalisme
Peut-être que par le biais de l’expansion du public pour le photojournalisme, un nouveau modèle de financement se créera par le simple fait que la demande influence l’économie de marché. #dysturb utilise les rues comme une toile de fond et affiche des images en grand format sur les murs de certaines des plus grandes villes du monde dans le but de prendre davantage d’ampleur.
Terdjman, qui est co-fondateur de #dysturb dit, «La rue est le premier réseau social et nous sommes en partenariat avec les rues. Nous voulions cibler un public différent. La génération des quinze-vingt-cinq ans ne fait pas confiance à la presse ou à ce qu’ils lisent- si ils lisent. Nous voulions les amener à regarder ce que nous voulions leur montrer d’une autre manière que par le biais de l’Internet « . Il a également dit que cette génération a moins confiance dans les médias traditionnels. « S’ils voient une image dans la rue, une image forte avec le logo et le hashtag qui les intéresse, ils croiront davantage cette image unique et sa légende qu’un reportage sur l’Internet ou un magazine ».
#dysturb a choisi de présenter des œuvres sous forme d’affiches imprimées de grand format pour avoir la même visibilité que les publicités commerciales. Le groupe travaille aussi avec des écoles en France et dans d’autres pays,en leur fournissant une image par mois avec un programme pédagogique d’accompagnement. Mais que produit toute cette activité ? Comment affecte-t-elle la viabilité de l’industrie?
Meiselas dit, « Ca me fascinerait de connaître la réaction des gens, de savoir comment nous pouvons toucher cette communauté et ensuite la faire grandir. Que voudraient-ils savoir de plus? En un sens, c’est déjà fantastique s’ils ne font que passer. Mais est-ce qu’ils s’arrêtent, et est-ce qu’ils regardent? Nous devrions avoir une webcam d’observation pour voir ce que les gens font; et puis que serait la prochaine étape? »
Les questions qu’elle soulève sont tout aussi applicables aux plates-formes de médias sociaux. Qu’est-ce que cela signifie d’avoir des dizaines de milliers de partisans sur Instagram, par exemple? Cela se traduit-il par des commandes rémunérées? Pour certains photojournalistes, avoir de nombreux partisans sur les médias sociaux fait partie de leur argumentaire de vente, car leurs clients pensent qu’ils seront en mesure de toucher de nouveaux réseaux. C’est particulièrement vrai pour les ONG, qui gagnent à être exposées à de nouveaux publics. Les entreprises commerciales peuvent également s’intéresser à la possibilité de toucher de nouveaux groupes de consommateurs.
Travailler dans l’espace ONG
Citant son experience personnelle, Meiselas dit que l’espace ONG a beaucoup changé «Quant à moi, j’ai toujours collaboré avec elles après coup plutôt qu’avant,” dit-elle en citant comme exemple le travail qu’elle a fait et qui a été utilisé ensuite par Human Rights Watch plutôt que commandé. « C’est très différent si vous êtes sur une commande et et que vous devez produire un travail à partir d’un point de vue particulier. Je sais que pour certains, ces commandes d’ONG sont des fonds qui leur permettent de se rendre quelque part pour observer un problème. Mais il m’est arrivé que des ONG me disent que je ne pouvais pas utiliser mes photos dans un autre contexte. J’ai pensé, s’agit-il d’un problème, ou s’agit-il de l’image de marque de votre organisation? Voilà une vraie question. L’idée qu’une organisation à but non lucratif va faire un embargo … C’est une chose de vivre avec cet embargo territorial, mais encore une fois il s’agit de compétitivité. Mais quel est notre objectif, qu’est-ce que nous essayons de faire? »
Terdjman dit que son expérience personnelle avec les ONG a été différente, et que celles avec lesquelles il a travaillé n’ont pas défini l’ordre du jour en termes de style de couverture ou de restriction d’utilisation. En fait, il a mis une clause dans son contrat qui stipule que lorsque l’ONG souhaite qu’il partage ses images dans ses réseaux de médias sociaux, il recevra une compensation supplémentaire. Voilà un exemple clair de la façon de gagner de l’argent sur les médias sociaux. « Si vous êtes assez bon pour travailler pour eux, ils doivent vous payer pour cela », a-t-il dit.
Economie contre Principes
La tension entre le désir du photojournaliste de raconter une histoire avec authenticité et honnêteté et les demandes de ceux qui commandent le travail a toujours existé. Quelle commande un photojournaliste acceptera et comment il la produira, ce sont bien sûr des choix individuels; mais comme l’a dit Weber, indépendamment de qui finance un projet, il y aura toujours des paramètres à l’intérieur lequels le photojournaliste devra travailler.
« Je pense que le photojournalisme a toujours été dépendant du facteur économique », a déclaré Weber. « C’est notre travail de fournir [des images] à quelqu’un d’autre. Si c’est un magazine ou un journal, leur loyauté va à l’annonceur, donc mon travail est filtré pour se conformer à un certain standard de l’entreprise. En fin de compte, la loyauté des ONG va à leurs donateurs … Ignorer le quotient économique est un peu naïf de la part du photographe. Finalement, tout le monde a une sorte d’agenda économique et bien sûr, si je peux aller voir la fondation XY et Z pour financer mon travail, alors j’aurai une sorte de loyauté envers elle. Donc, la question est de savoir combien êtes-vous prêt à vous prosterner devant ces seigneurs? »
Cette table ronde a également abordé d’autres sujets, comme le rôle de la voix dans le visuel, et dans de prochains articles je vais explorer ce thème et d’autres. Mais pour l’instant, j’espère que ceci vous a donné matière à réflexion et je suis impatient d’entendre vos commentaires pour que nous continuions la conversation. Si vous voulez consulter l’intégralité de la session, cliquez sur les liens ci-dessous. Pour me contacter par email [email protected]
Links: Photojournalism Now
http://www.photojournalismnow.blogspot.com
Foam, World Press Photo Foundation and De Balie videos