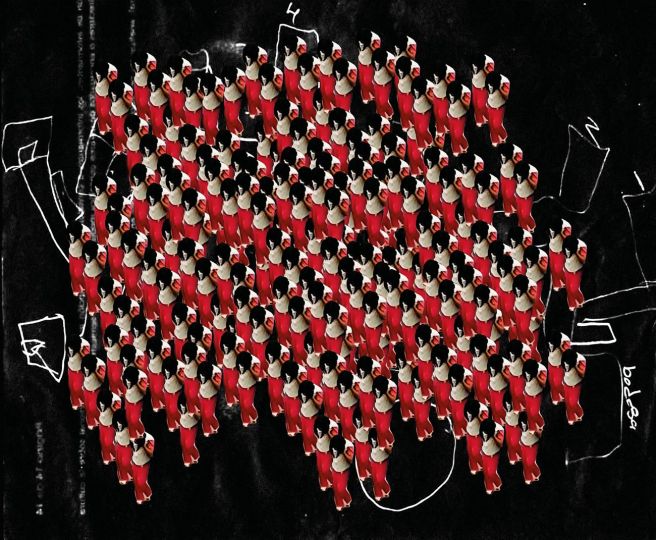De 1974 à 1976, Langdon Clay a erré dans les rues de New York pour prendre en photo des voitures. Il les a photographiées garées, de nuit, baignant dans une langueur digne d’Edward Hopper. Les voitures ? Elles sont comme des New-Yorkais : des stars, des clochardes, des grosses (surtout des grosses), de toutes les couleurs et de toutes les formes, des tunées et des amochées. Il les a photographiées avec un appareil Leica, en Kodachrome, avec une telle attention, un tel sens de l’observation que les Chevrolet Impalas de 5 mètres de long et la Buick Electra trois couleurs s’intègrent facilement a décor – si facilement, en réalité, qu’on dirait qu’elles y sont nées. Le livre de Clay s’intitule Cars, mais les voitures ne sont qu’une partie de l’histoire : il a créé une capsule témoin de New York dans les années 1970, rappelant de façon obsédante à quel point la nuit pouvait être grande. L’Œil de la Photographie s’est entretenu récemment avec lui par téléphone, depuis sa maison de Sumner, dans le Mississipi (300 habitants), à propos de Cars – pour savoir notamment comment ses photos ont fini, quarante ans après, par former un livre.
Comment en êtes-vous venu à travailler sur ce projet ?
Au début des années 1970, New York était à plat, mais j’étais dans ma vingtaine. Ça ne coûtait pas grand chose de vivre là-bas, et sur le plan visuel, c’était fascinant. Je passais la journée dans l’appartement d’amis dans le centre, et je rentrais le soir dans mon appartement de la 28e rue. J’avais toujours un appareil avec moi. J’ai commencé à prendre des scènes de rue avec beaucoup de voitures. Au bout d’un certain temps, j’ai fini par me limiter, ne plus photographier qu’une seule voiture. D’une certaine façon, la nuit est devenue importante pour moi. J’étais saisi. J’ai senti que quelque chose se passait.
Le livre s’intitule Cars, mais les décors sont fascinants – les fenêtres, les murs, les panneaux. Cela faisait-il partie du projet de départ ?
La voiture en soi importe peu. Ce qui compte, c’est la façon dont elle se mêle au décor. C’est une esthétique. C’est ce qui rend la photographie si intéressante, quand elle fait la synthèse de deux éléments, comme la couleur et le dessin, qui fusionnent. Mais les voitures avaient du style à l’époque. Elles étaient dessinées par des gens qui les fabriquaient à la main. Les voitures d’aujourd’hui n’ont pas autant de caractère : elles sont interchangeables.
Au beau milieu de la nuit, il y a des déchets sur le sol et des graffiti sur les murs, mais des couleurs magnifiques et subtiles.
Je venais de passer du noir et blanc à la couleur. Et c’était mon premier projet. Je m’y suis lancé avec zèle, c’était devenu une obsession. Il fallait que je trouve cette lumière folle parce que je voulais distinguer mon travail de mes aînés : les photographes du style Magnum et les scènes artistiques en noir et blanc.
Dans le livre qui rassemble ces photos, vous avez écrit : « La nuit a sa propre couleur ». C’est une très belle réplique. Que voulez-vous dire par là ?
Vient d’abord le crépuscule, puis la pleine nuit. Quand les lumières sont allumées dans la rue, avec les phares de voitures, les néons et les lumières fluo, la nuit prend une couleur différente, sa propre couleur. Marcher de nuit dans les rues de New York, ce n’est pas la même chose que de le faire le jour. Ça me fascine toujours autant.
Dans les années 1970, les rues de New York n’étaient pas sûres la nuit. Je suis curieux de savoir comment vous vous y preniez : à quoi ressemblait votre quête ? Identifiiez-vous d’abord un lieu pour attendre qu’une voiture s’arrête devant?
La plupart des photos ont été prises dans West Village ou Hoboken. Quand on marche dans ces rues pendant deux ans, on foule le même sol encore et toujours. Certains immeubles sont attirants mais rien ne se passe jamais devant. Et puis une nuit, il se passe quelque chose et on est là pour le prendre en photo. Ça vous saisit complètement, comme un scientifique qui essaie de régler un problème et que tout se résout en un instant. C’est à ce moment-là que ça se met à chanter. Il faut que ça retentisse, que tout fonctionne. On le sent. Et puis parfois, on prend une photo et il se passe quelque chose qui dépasse le sujet littéral, qu’on ne voit que plus tard. C’est ce qui fait le plaisir, en réalité.
Pourquoi avoir décidé de ne pas intégrer de figures humaines ?
Je ne l’ai pas décidé. Il y en a, en réalité, mais elles sont comme des fantômes. Le temps d’exposition était de quarante secondes, donc à moins que les gens ne s’arrêtent, on ne les voit pas.
Il y a 115 photos dans le livre : combien en avez-vous pris en deux ans ?
Je dirais environ 200. Il faut faire attention parce qu’avec la pellicule, ça devient cher. Les choses deviennent plus faciles après deux mois : on ne gaspille plus de pellicule.
Avec quelle photo avez-vous eu pour la première fois la sensation que vous aviez trouvé ce que vous recherchiez ?
Il y en a une avec une voiture dorée, un arbre vert juste à côté, et la traînée des feux arrière, avec dans le coin, un escalier de secours dans le brouillard. C’est la première qui m’a fait penser que je tenais quelque chose avec la couleur. Celle qui m’a fait me dire : « Ok, c’est cool. » Si on voit les images comme des capsules témoins, celle-ci est LA capsule.
Votre projet a-t-il été influencé par d’autre photographes ?
Hopper et Brassaï m’ont ouvert la voie – en d’autres termes, ils m’ont permis de faire de la nuit un sujet. Les voitures, c’est Atget et Evans. Eggleston m’a influencé, en ce qu’il a rendu la couleur acceptable – mais je ne voulais pas l’imiter. Je le connaissais à l’époque ; il a dormi sur notre canapé pendant un temps. Je lui ai dit que je voulais rencontrer John Szarkowski [directeur du département photographie du MoMA] et il m’a dit : « Il va falloir te limer les dents et attendre ton tour. »
Et Bernd et Hilla Becher ? Le fait de reprendre le même sujet fait ressortir les variations.
Oui, les photographes se définissent les uns par rapport aux autres. J’ai découvert leur travail dans le magazine Camera dans les années 1970. J’étais impressionné – je le suis toujours. On se rend compte qu’on peut tout prendre en photo. Mais qu’est-ce qui fait une bonne photo ? La question reste ouverte…
Vous avez donc pris ces photos au début des années 1970. Pourquoi le livre sort-il aujourd’hui, c’est-à-dire quarante ans plus tard ?
C’est une question de chance, purement et simplement. Il y a quelques années, ma femme [la photographe Maude Schuyler-Clay] a envoyé un mail à Gerhard Steidl [éditeur des livres Steidl]. Sur les 1500 demandes qu’il reçoit chaque année, il ne répond qu’à deux. Et il a répondu à Maude. Le 4 juillet 2014, il est venu à Sumer, dans le Mississipi, la petite ville où nous vivons et où nous avons élevé nos enfants. Il est arrivé en limousine et il a passé quelques heures chez nous. Nous avons une grande table, sur laquelle il a regardé tous les tirages, ceux de Maude et les miens, en faisant des tas. Il a agi très vite mais avec une grande précision, et beaucoup de concentration. Il est arrivé avec une grosse valise vide dans laquelle il a rangé nos originaux. J’ai fait un signe de croix. Et puis il est allé à Memphis rendre visite à Eggleston – qui s’avère être le cousin de ma femme – et il est reparti en Allemagne. Il n’a même pas passé la nuit dans le pays.
Que ressentez-vous à l’idée que ce livre sorte ?
Je me dis : « Enfin ! » J’aime ces photos depuis toujours. Elles gardent une trace des années 1970. Je les aime en tant qu’images, j’aime l’iconographie, le décor, et la façon dont elles fonctionnent en tant qu’ensemble. Et j’ai toujours adoré New York.
Que pensez-vous quand vous les regardez à nouveau ?
J’ai 67 ans aujourd’hui. Je vis en milieu rural depuis 28 ans, donc quand je vois ces images, je revis le sentiment de la ville, je ressens ce qui fait une ville. J’ai toujours adoré les photos de New York et Paris, et je reste attiré par ces grands centres. C’est en moi. Je ne suis pas un expressionniste. Je n’essaie pas d’utiliser la photo pour exprimer des émotions intérieures. J’ai toujours cherché à enregistrer des choses. Mais il faut faire ça sur le moment. Si l’on photographie seulement ce qui rend nostalgique, on rate sa mission. Pour moi, la mission est toujours de saisir l’époque, et pas pour en faire un livre quarante ans après.
Entretien par Bill Shapiro
Bill Shapiro est l’ancien rédacteur en chef de Life magazine ; @billshapiro sur Instagram.
Langdon Clay : Cars – New York City, 1974-1976
Publié par Steidl
95 $ – 85 €