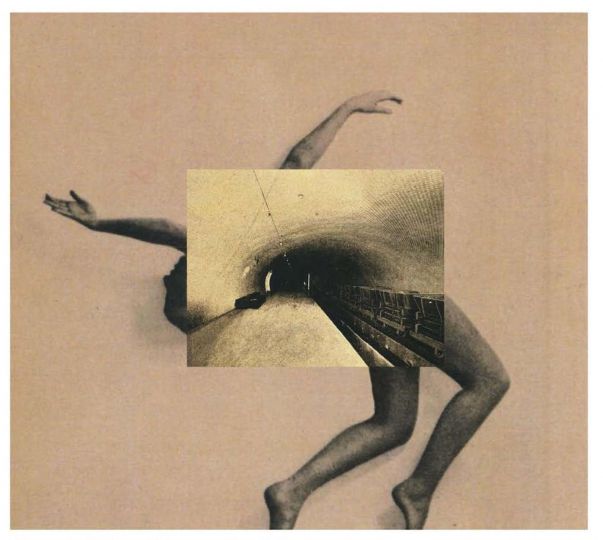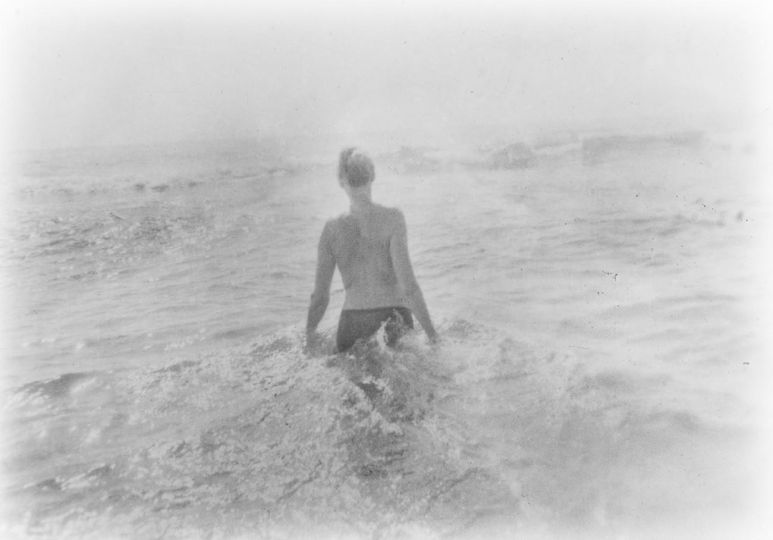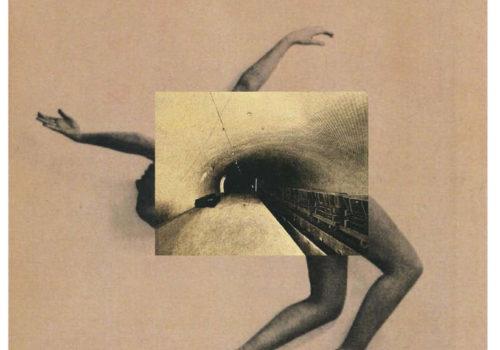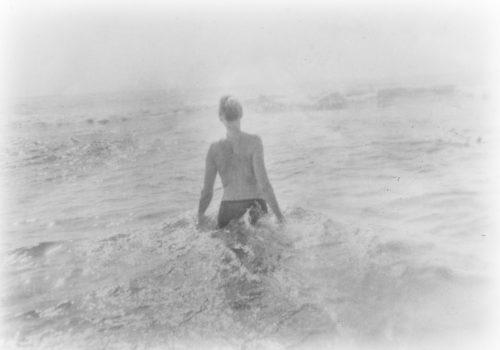Cinq questions à Jorge Ribalta par Chantal Grande
Tu utilises la photographie comme instrument qui te permet analyser, observer et ordonner les modèles culturels de notre société. Comment élabores-tu ce projet documentaire, cette archive produite souvent à partir d’évènements mineurs, que le spectateur doit recomposer et interpréter à travers une multitude d’images ?
Jorge Ribalta : Ma pratique repose sur une lecture et une mise en application la plus littérale possible des sources du discours documentaire des années 30 : celui selon lequel la photographie peut expliquer la complexité sociale et représenter la vie quotidienne de « l’homme de la rue », du travailleur. Sergei Tretiakov est ma référence la plus importante, avec ses thèses sur la sérialité et l’immobilité de la photographie, qui articulent la pensée matérialiste dialectique sur la fonction social et politique de la photographie. Ma lecture reprend la genèse de cette idée documentaire dans le présent, en lui rendant l’actualité et en même temps qu’en incorporant une autocritique dans l’inscription de mon propre travail à l’intérieur du système de l’art contemporain. D’où le choix de « travaux de champs » ou « recherches sur le terrain » pour désigner mes séries, comme de petites études photographiques des formes spécifiques dans lesquelles se déroule aujourd’hui le travail dans le champ culturel. Ce sont des études comme la production de la ville historique comme marchandise culturelle dans une ville romaine comme Tarragone, la trame de la culture du Flamenco en Espagne et sa tension entre culture officielle et d’opposition, les mécanismes de production et de reproduction d’un édifice emblématique comme l’Alhambra, etc… Mon travail cherche à défendre l’actualité de la photographie comme instrument d’observation et d’analyse de la complexité sociale, telle qu’elle a toujours été appréhendée depuis son incorporation dans la culture moderne, et en opposition au discours stérile sur la mort de la photographie.