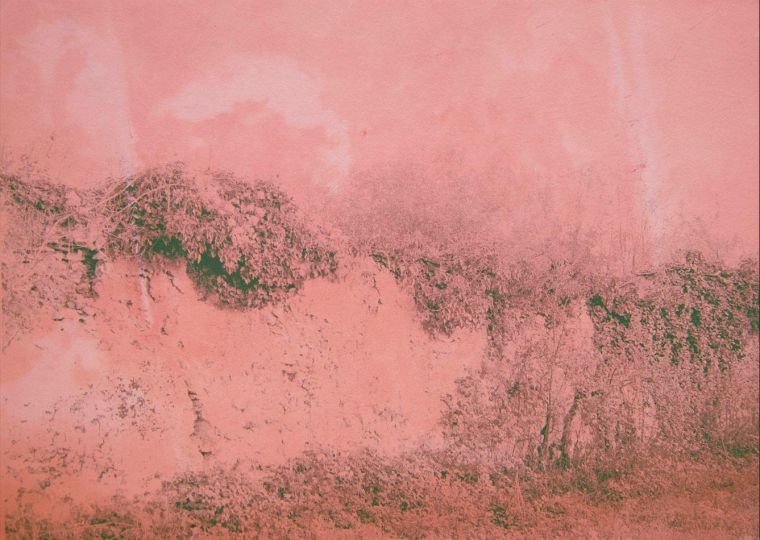Hors Cadres – texte par Éric Bouvet
L’horloger mesure la course du temps, le photographe l’arrête. C’est autant sa liberté que sa contrainte. Libre de mettre le monde en pause le temps d’une image. Contraint par un cadre technique dont il doit s’affranchir pour embrasser du regard l’étendue de la terre. Car, pour exercer le plus beau métier offert aux hommes, il y a un prix à payer : celui de porter une immense liberté créative au service de la stricte documentation de l’humanité. C’est l’essence du photojournalisme. Un objectif merveilleux. Une gageure. Dans la pratique, le monde n’est jamais noir ou blanc, mais fait de nuances de gris. Ses peurs tues, le chasseur d’images crues doit concilier deux réalités antagonistes : aimer le monde et le montrer tel qu’il est. Chercher le contraste, cette opposition de deux choses dont l’une fait ressortir l’autre. Mais laquelle choisir ?
En 1985, j’immortalise la petite Omeyra, une jeune colombienne coincée par une coulée de boue, que les secouristes ne peuvent dégager. Elle mourra pourtant bientôt, mais pas devant mes yeux. Je n’ai saisi que la vie, avant le drame. Deux ans plus tard, je découvre l’intégrisme islamique au fond d’une vallée près de la route de Khost, en Afghanistan. Un certain Ben Laden, encore inconnu à l’époque, dirige le groupe qui n’aime pas les étrangers, me laisse sans nourriture, et sans accueil, après une traversée éreintante des montagnes enneigées à pied en plein hiver, de plus dangereux car perdu sur les lignes russes. Je n’ai aucune image à montrer, elles restent en moi. À Belfast, en 1988, pendant une commémoration dans le cimetière catholique de Milltown, un protestant lance soudainement des grenades sur les gens au milieu des tombes. Une cérémonie du souvenir qui vire au carnage. Une certaine condition humaine. Pour la chute du mur de Berlin en 1989, je suis dessus, en homme libre. Je documente, mes images entrent dans l’Histoire, je suis heureux. Je fais alors le plus beau métier du monde. Puis vient la Somalie. En 1992, je découvre l’effroi. Premier journaliste arrivé à Baidoa, l’épicentre de la famine. Je franchis ma ligne noire, celle où la folie et la mort emportent tout. Je réalise très peu d’images, car je ne suis pas là. Mon cerveau refuse ce que mes yeux voient. C’est le comble pour un photographe : la censure en étendard, l’objectif en berne. Puis en 1995 les commandos russes en Tchétchénie, l’horreur est humaine : tout être humain peut se transformer en animal. Je sais désormais ce que signifie le verbe survivre. J’essaye de travailler avec seulement sept films diapo disponibles, je documente comme je peux car tout se passe de nuit, je fais mon métier et ce n’est pas toujours le plus beau du monde.
Témoigner et s’interroger, questionner le public et le bousculer, tel est mon rôle depuis quarante ans. Avec une ligne de conduite claire : s’en tenir aux faits, tout en respectant la dignité des personnes photographiées. Car ce sont elles qui font les images que les livres d’Histoire retiennent. Souvent gérer l’absurdité, ce qui est loin d’être évident. Aujourd’hui, la donne n’a pas tellement changé, malgré les technologies avancées. Il faut toujours marier l’excellence objective de la prise de vue, à la subjectivité du point de vue. Et surtout garder en soi que la meilleure image n’est pas encore faite. Il faut la chercher. Et si tout le monde s’accorde à dire que, de nos jours, le temps s’accélère, voilà une bonne raison pour le photographe de démontrer que l’on peut encore le figer. Et s’arrêter sur l’image.
Genèse
Il y a trois ans, je rends visite à ma fille Cerise habitant Berlin. A la librairie de la fondation Helmut Newton, je lui achète un journal de Saul Leiter.
L’année dernière elle a l’idée de faire un journal comme celui ci pour mes 40 ans de photographie. Suite à cette production j’ai contacté Jean François Leroy du festival de photojournalisme « Visa pour l’image » à Perpignan, si cela pouvait l’intéresser. Il m’en a fait une magnifique exposition de 54 images. Résultat : 23 interviews dans les plus grands médias, une foule de visiteurs incroyable, attentive et passionnée. Une folle semaine !
Éric Bouvet
Le journal des 40 ans dédicacé est en vente au prix de 20€ en main propre sur Paris.
Ou bien par la poste à 27€
Me contacter sur le mail : [email protected]
Eric Bouvet