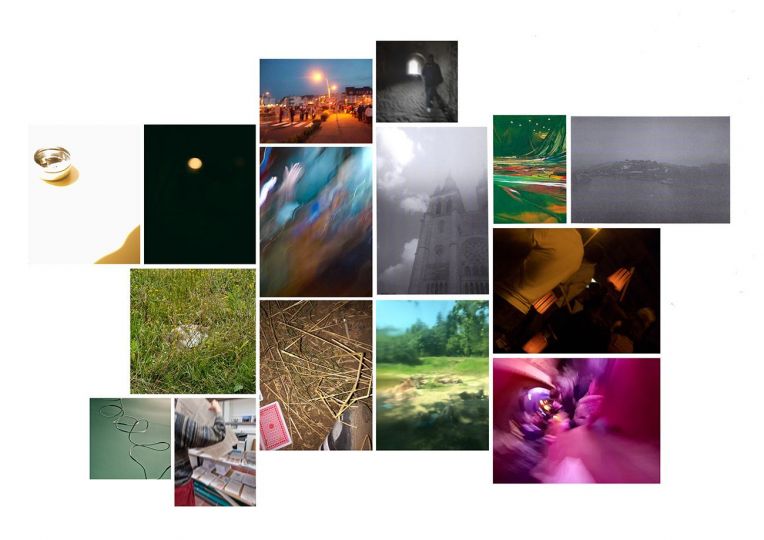Je tapais à la porte d’un étranger.
J’avais traversé la moitié du monde pour le rencontrer.
Mon père.
J’avais sept ans la dernière fois que je l’ai vu.
Lorsque l’Union soviétique s’est effondrée, ma famille a fait de même.
Je me souviens comment mon père et moi dansions ensemble dans notre minuscule appartement de Moscou et aussi de lui m’offrant ma première poupée.
Je me souviens également du jour où il est parti.
Parfois, il disparaissait pendant des mois d’affilée et revenait soudain de manière inattendue.
Jusqu’à ce qu’un jour, ce soit notre tour de partir.
Ma mère me réveilla et me dit d’emballer mes affaires. Elle me dit que nous partions en voyage. Le jour suivant, nous arrivâmes dans notre nouvelle maison, en Californie.
Nous ne parlions presque jamais de mon père. Je n’avais pas de photos de lui, et avec le temps, j’oubliais à quoi il pouvait ressembler.
Je me demandais souvent ce que ça aurait fait d’avoir un père.
Je me le demande toujours.
Voici ma tentative pour reconstituer une image d’un étranger familier.
Ces mots touchants de la photographe Diana Markosian accompagnent sa nouvelle série intitulée My father, the stranger (Mon père, l’étranger). Le Journal a pu lui parler cette semaine alors qu’elle est actuellement en voyage en Birmanie.
Après Goodbye My Chechnya, un sujet de société, vous avez choisi avec ces nouvelles photos sur votre père de travailler sur un sujet plus intime et personnel. Y a-t-il une raison à ce changement ?
C’était une partie de ma vie que j’avais évité jusque-là. La décision de rencontrer mon père était une évidence. Il m’a juste fallu 15 ans pour rassembler le courage nécessaire pour le faire.
Je lui ai été enlevée alors que j’étais en train de grandir. Son souvenir dans ma vie a été détruit. Dans toutes les photos de famille, ma mère avait déchiré les images de lui et je n’avais donc rien pour pouvoir m’en souvenir.
Ce travail et le temps que j’ai pu passer avec mon père m’ont aidé à remplir les blancs, confirmer mes impressions, et offrir une preuve là où aucune n’existait auparavant.
Est-ce que vous avez regardé votre père de la même manière que vous avez vu les femmes de Goodbye My Chechnya?
Je n’ai jamais considéré cette démarche comme un projet. J’ai passé le plus clair de mon temps sans appareil. Je voulais être là. Auprès de mon père. C’est quelqu’un qui m’a manqué quand j’étais enfant, et d’une certaine manière, je pense que je voulais rattraper les années perdues.
Quelles étaient vos relations avec votre père avant de faire ce travail ? Et maintenant ?
Je savais peu de choses sur sa vie, et je n’avais aucune certitude quand au fait qu’il m’aimait. Pire encore, je ne pouvais même pas être sûre que je l’aimais. Tout cela semblait un peu vain.
Il a pris vie pour moi à travers cette démarche. Je redécouvre doucement ce que cela veut dire d’être en contact avec lui, avec une famille et une culture. Ce n’est pas l’affaire d’une nuit. J’avais tant de colère envers lui de m’avoir quittée et de ne pas avoir cherché à me retrouver. Mais j’apprends à dépasser cette colère.
Les souvenirs que je crée avec lui aujourd’hui sont les miens. C’est ce qui compte pour moi. Le reste est sans importance.
Est-ce que la photographie est devenue, d’une certaine manière, un instrument de thérapie pour vous et/ou votre père ?
Absolument. J’ai une blessure, à l’intérieur. Et je ne réalise que maintenant à quel point elle est profonde. J’ai perdu mon père, mais dans le même temps, je l’ai aussi retrouvé. Au début, je ne savais pas comment réagir à ce qui m’arrivait. Je ne pouvais pas en parler. J’en ressentais de la honte. Mais j’apprends que c’est normal de vouloir avoir un père.
Pourquoi avez-vous choisi le noir et blanc pour vos images ?
Je voulais séparer ce travail du reste de ma production. Il traite de la mémoire, de la perte et d’une aspiration. Je ne pouvais pas l’imaginer autrement qu’en noir et blanc.
Dans ces nouvelles images, on peut voir que vous jouez bien plus avec les puissances de suggestion que la photographie peut développer (les reflets, les scènes vues de derrière, les ombres, etc.) Avez-vous remarqué que votre style est devenu peut-être plus artistique sur ce projet ?
Je n’ai pas photographié avec une méthode ou une esthétique particulière à l’esprit. Je construisais une relation avec mon père et prendre des photos faisait partie de cette démarche. Peut-être que ce travail est plus vulnérable que le reste de ma production, mais je ne l’ai pas fait de manière intentionnelle. C’était la manière dont je ressentais les choses.
Jonas Cuénin