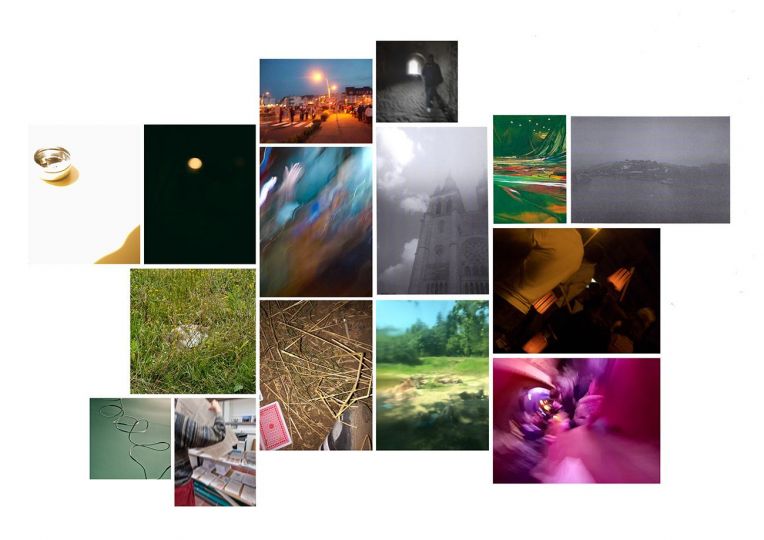L’ange de l’histoire (Yougoslavie, été 1986)
En noir et blanc, dans le magazine, ce sont des photos de réfugiés du Kosovo chassés par l’armée serbe. Les femmes ont des foulards trop grands qui cachent leurs cheveux. La poussière du voyage et la fatigue s’accumulent aux plis de leurs joues. Ecrasés de chaleur, le front collé aux vitres et les cuisses aux sièges de skaï, les enfants attendent. Des hommes il n’y en a pas. Leur mort se lit sur le visage de ces vivants.
Et d’ailleurs les morts suivent: voici la litanie des os brisés, des mâchoires à la belle blancheur souillée de terre que les pelles ont raclées dans des jardins de terreur. Aux organisations humanitaires de faire les comptes: le nombre des morts sera impensable, immense.
D’autres corps suivent: ceux que les tortionnaires n’ont même pas enterrés mais ont abandonné au bord de routes de campagne, dans les fossés. Avant l’exécution ils leur ont lié les chevilles et les bras. L’un, âgé, avait bouchonné ses chaussettes dans ses chaussures comme font les enfants à la piscine. Il a des pieds christiques et maigres, déformés par la marche, les ongles cassés, un cor à un orteil. Ces détails sont humiliants, terribles.
Mais aujourd’hui ma tristesse n’apporte pas de compassion. Je suis aussi morte que ces morts dont la puanteur me colle à la peau.
A la nuit tombée, dans le plus grand silence qui suit ces images je roule à rebours dans un rêve qui m’étreint et me berce comme un placenta, une vase épaisse.
Je suis jeune, beaucoup plus jeune. Le monde est plus jeune, dans son été, son plein soleil. Mes cheveux longs caressent mon cou, je transpire un peu.
Je vois la hutte, une fumée mince s’échappe au-dessus du toit fait d’épines et de foin tressés. C’est dans l’île de Korcula sans doute, ou à Brač, tout en haut de la montagne, où j’avais fait un festin avec des Titistes, résistants de la deuxième guerre.
Pleine de curiosité, d’attente, je me courbe pour pénétrer dans la hutte L’intérieur est recouvert de suie ou de cendre, une poudre grise et douce qui enrobe tout: les poutres devant l’âtre, les louches en fer et les marmites pendues au plafond, la longue table de ferme aux tréteaux épais.
Derrière la table se tient un homme dont le visage est libre de poudre. Sa barbe carrée est noire, sa blouse bouffante, de jute grège, porte comme autant d’ombres les marques entrecroisées de pinceaux essuyés.
Perçant le chaume du toit, un rayon de soleil traverse la hutte en oblique. Entre le peintre et moi trône un plat à tajine, massif, en terre cuite, couvert de poudre grise.
Comme une autre photo en noir et blanc
Je soulève le couvercle conique: Dedans, bombé, parfait, couché sur un lit de riz safrané apparaît le ragoût de mouton avec ses lamelles d’amandes et de piments, d’aubergines et de tomates. La vapeur monte avec les couleurs somptueuses, les effluves aigres-doux des épices qui mouillent le palais. Nous nous attablons.
Je m’éveille délivrée des images de mort. Un rayon de soleil tombe en oblique sur mon visage. Je touche à mon côté le torse de mon amant.
Le plat rond est l’objectif par où voir le monde en couleurs.
*
C’est le dernier reportage que j’ai fait en Europe, mais je ne savais pas que ce serait le dernier. C’était il y a trente ans dans le pays qui portait alors un nom: Yougoslavie.
A Zagreb Petar Dabac, un ami photographe, m’a conseillé de me rendre en Istrie. Il m’a montré des photos prises l’automne passé au moment de la fête du raisin. Mais il ne pouvait pas m’accompagner: je devrais faire seule texte et photos.
En louant la minuscule Fiat j’ai acheté une carte routière, mais je me suis vite rendue compte qu’elle ne faisait que refléter l’optimisme d’un plan quinquennal interrompu: les routes s’arrêtaient net, souvent au faîte d’une colline. La plupart des pompes à essence et des garages n’existaient que sur papier.
Je suis tombée en panne à Sveti Petar U Usumi, Saint Pierre des Bois, sur la place d’un très petit village, devant une église baroque d’un beau jaune mais assez délabrée. Dans une niche de la façade, Saint Pierre ouvrait les plis de son manteau. Une ombre qui tombait sur sa joue y faisait planer comme un léger sourire. Deux enfants jouaient au foot sous un vieux platane, une vieille femme balayait les feuilles sur les marches de l’église.
Elle m’a recueillie le temps que ses neveux et voisins accourus trouvent un pneu de rechange et de l’essence. Comme les distractions étaient rares au village ils ont fait durer la course. Cette nuit-là j’ai dormi dans le grand lit sculpté, entre les draps brodés de son mariage qui n’étaient guère sortis de l’armoire depuis des années et sentaient l’amidon, la pomme reinette. Nevenka était veuve depuis longtemps. Elle savait un peu d’allemand. Elle avait un beau sourire.
Au moment des adieux j’aurais voulu être seule avec elle. J’avais l’impression qu’elle voulait me dire quelque chose. Mais une voisine curieuse restait plantée là, les pieds dans la poussière. Finalement Nevenka m’a demandé de lui envoyer une montre de Ljubljana: elle n’en avait jamais eu. J’ai promis. Autre chose? Elle a dit un de ces non qui veulent dire oui. Je n’aime pas les adieux, j’ai démarré.
Reculaient le crucifix de pierre, la fontaine, la façade de l’église, mais il me semblait que c’était moi, immobile sur la route, qui agitais le bras dans un geste ralenti de vol ou de nage.
Son visage derrière mes yeux. Sa province ancienne, fine et fraîche, avec des strates d’Italie, d’Autriche, de Russie et de Moyen-Orient. Après les chênes-verts, les marronniers, les peupliers et les sapins, il y avait la surprise d’églises presque italiennes. Des popes brandissaient une grosse clef. Je me souviens des longues flammes des cyprès, des fresques des saints et martyrs.
*
Les couleurs de l’Istrie flambent encore dans ma mémoire: piments jaune d’or pendus en tresses sur des portes médiévales, murs chaulés au bleu avec les photos de famille, voûtes grise et roses, rues claires, petites villes fortifiées enroulées dans leur enceinte blanche comme une conque marine, cimetières carrés, peuplés de papillons géants, de tronçons de chapiteaux, de pierres aux noms effacés, ceints de bracelets de lierre noirci. Le silence y était profond, apaisant, un chevreuil venait parfois brouter tout près de moi puis s’enfuyait au galop. C’était comme un commencement du monde.
L’ange dont je me souviens, sur une fresque du onzième siècle pauvrement éclairée par un lumignon ne portait pas de ces ailes irisées, grandioses comme un arc-en-ciel, qu’on voit aux épaules de ses frères de Toscane et d’Ombrie. Ces ailes-là étaient pointues, rousses et brunes comme celles d’une poule de basse-cour. Il avait un air frileux et un peu retors- un gamin pris sur le fait à faire une bêtise. Ses ailes l’enveloppaient comme une écharpe. Il planait sous la voûte basse. Ses traits étaient sûrement ceux d’un gosse du village où vivait ce peintre inconnu il y a neuf siècles.
*
Je m’éloignais de Sveti Petar. Par des chemins de traverse j’ai parcouru des forêts denses survolées de grands oiseaux de proie gris fer. Je suis redescendue dans des vallées travaillées de main d’homme. Avec des murets de pierre sèche, des oliviers, des champs de tournesol dont le coeur et les pétales se tournaient vers la route comme vers un auditoire attentif. Dans les champs, au coin des haies, se pressaient de toutes petites huttes de pierre coniques, comme les bories provençales: des kazun où les paysans se réfugiaient en cas d’orage. Des espèces d’échafaudages aux toitures d’herbe hissés sur des piquets, servaient de remises à foin.
L’orage s’annonçait dans un ciel mauve. Près d’un chemin bordé de mûriers, sous un chêne, un paysan parti s’abriter avait laissé une brouette d’osier tressé. Sur un lit de feuilles de chou dormaient les courges, les pastèques, les melons tachés de clair. Une petite serpe était plantée dans la chair écarlate d’un melon d’eau, comme une blessure au soleil.
Un peu plus loin j’ai passé une fabrique de céramique et une carrière de craie. Tout autour les feuilles, les troncs, les herbes étaient entièrement blanchies par cette poudre qui décolorait un pan entier du paysage. Le pare-brise s’est immédiatement criblé de gouttelettes blanches. J’avançais dans un brouillard.
J’ai versé l’eau de ma gourde sur le pare-brise. Je pleurais. L’idée de retrouver la grande ville, les hordes de touristes et les panneaux Zimmer Schnitzel me faisait horreur.
*
De Mostar à Sveti Petar U Usumi tous ces villages d’Istrie ont dû être détruits. Les rivières ont charrié le sang et la pourriture et sous les chênes noircis les toits ont crevé comme des coquilles d’oeufs. J’imagine les photos de mariage aux verres cassés dans les gravats, l’effrayant silence qui règne après un massacre, la peur de l’autre, la haine.
Le coeur de l’Europe a été jeté aux chiens.
Où errent les anges sans églises?
Je n’ai pas voulu retourner dans l’ex Yougoslavie.
Ses petits-enfants ressemblaient à ceux du voisin musulman. Ils pêchaient ensemble à la rivière pour le souper. A la vendange, aux mariages, ils jouaient de ces musiques aigres où la joie s’empèse comme un jupon de dimanche.
*
Je regarde la dernière photo: des lettres, des photos de famille souillées de terre, au milieu des décombres d’une maison de campagne. Le monde est noir et blanc, infiniment vieux, fait de fragments de ruines et de gravats. S’il se retourne l’ange de l’histoire va pleurer.
Je pense à toi, Nevenka, à ton foulard sombre trop grand pour ta figure. J’espère que pour ton alliance usée, pour la petite montre neuve du bijoutier de Ljubljana, avec son bracelet doré, ils ne t’ont pas coupé les mains.
Pyramides (Borre, Norvège, novembre 2017)
C’est un cimetière dans l’île, visible depuis les eaux grises du fjord.
Ceux qui autrefois approchaient dans leurs vaisseaux de bois
à la proue recourbée l’auraient vu de loin, ils auraient su
Qu’un grand royaume résidait là.
Sept grandes pyramides vertes hautes de plusieurs mètres
Faites de cailloux et de terre tassée, et un cairn de pierre grise.
Inexplorées, muettes, elles ont abrité en leurs flancs d’herbe
des tombes des éperons de fer, des harnais, l’or et les os calcinés des rois, les parures des reines.
Les hêtres, les bouleaux laiteux marqués de sombres hiéroglyphes,
Les pins debout dans la brise d’automne qui ploie leur cime
Inclinent leurs branches en hommage, solennelle assemblée
Qui garde le sommeil des tumuli de Börre.
Oublieux des temps anciens, de la ville des morts, les indifférents promènent des chiens en laisse par les chemins bordés de fougères géantes.
Carnac (août 2017)
Locmariaquer: le menhir brisé
une grande baleine grise
échouée à marée basse
au sable de la lande
André Kertesz, frère voyant (Paris, été 1978)
Il y a presque soixante-dix ans qu’André Kertesz est photographe. Pourtant, sur lui l’habitude ne prend pas: elle glisse, comme l’eau sur des plumes. Aujourd’hui qu’il y a du soleil et du vent, il marche à petits pas vifs, désigne, de ses mains expressives et fines qui tremblent un peu, un vol de pigeons, les branches qui bougent dans une flaque, un chien endormi en travers du pavé, les arches du Pont Marie qui ricochent d’une rive de la Seine à l’autre. Il vit à New York depuis plus de quarante ans, mais Paris reste sa ville préférée, celle pour laquelle il a quitté sa Budapest natale.
Kertesz s’appuie à mon bras. Son sourire est contagieux, il rayonne. Ses yeux obliques sont transparents de malice et de bonté, sa voix douce escalade la gamme et la redescend. Il accentue les mots aux endroits les plus surprenants et mêle, comme ça lui vient, le français et l’anglais.
« J’ai commencé la photo en 1912. Pendant la guerre, les magazines organisaient des concours d’amateurs. J’étais au front. Nous ne pouvions pas nous laver, nous étions tellement dirty. Et puis un jour, derrière nous, un ruisseau. Je me trempe dans l’eau et hop ! avec un pied, j’ai fait un « autoportrait pinçant les poux » : je l’ai envoyé à Borszen Janko, un journal satirique politique hongrois. Et puis deux mois après, je visitais un camarade blessé, et en parlant avec lui,
Qu’est ce que je vois sous le bouteille, mon nom imprimé¡ j’avais le dernier prix…mais ma photo n’était pas reproduite.
J’ai eu aussi une couverture dans Erdekens Usjag, une photo faite avec mon frère à Buda en 1914, la nuit. J’avais posé six-huit minutes, sans éclairage artificiel. Une vieille rue ordinaire. Une silhouette, une simple silhouette dans la rue. C’est la rue qui domine. »
En 1925, Kertesz est à Paris. « Ma mère m’a dit : ‘Ici, en Hongrie, pas de possibilités pour toi. Si tu veux partir, pars.’ J’ai habité Montparnasse, dans la rue de Vanves, qui a changé de nom depuis. J’avais un peu d’économies de mon emploi de bureau. J’allais au Dôme, je montrais mon travail à des journalistes et à des artistes, et j’ai été un peu compris. À cette époque, il n’y avait que l’Illustration comme magazine. Vu n’existait pas encore. Et comme photographes, seulement Brassai, Man Ray et moi. Les premiers Leica sont sortis en 1928, et j’en ai acheté un aussitôt. C’était la liberté : Push the button, c’est net. »
La même année, Kertesz montre ses images à la galerie Le Sacre du Printemps. Le dadaïste Paul Dermée écrit pour lui un poème préface, où il parle des yeux du photographe « dont la rétine redevient vierge à chaque clin, film qui se dévide sans fin ». Cette phrase superbe et juste peut aussi engendrer une équivoque: Kertesz serait innocent, il créerait de la beauté par hasard, comme les fleurs sentent ou les oiseaux chantent. Or il me semble que l’émerveillement du photographe n’a rien à voir avec un quelconque primitivisme : « Dans notre Hospice des Quinze Vingt, Kertesz est le frère voyant » écrit plus loin Dermée. Que, chez Kertesz, la connaissance approfondisse à chaque fois la vision, sans pour autant entamer l’émerveillement, c’est peut-être le véritable sens du mot voyant.
« C’était si beau, une grande surprise pour moi. Les surréalistes et les dadaïstes étaient à la fête. J’ai dit, vous pouvez donner toutes les définitions de mon travail. Surréaliste ? Pourquoi pas… Mais je suis un ordinary photographer. Je n’ai pas voulu participer à leur mouvement. C’était artificiel pour moi: je suis resté seul, et je reste encore seul. »
Kertesz gardera toujours son dégoût pour les discours et les catégories. Lorsqu’on lui demande de parler photo, il répond en général : “il faut être réaliste “- bonne façon de décourager gentiment le questionneur.
Être réaliste ? Explorer comme lui toutes les sortes d’espaces, tous les sujets, refuser les catégories. Kertesz s’est d’abord attaché à la Hongrie d’avant-guerre : un monde sur le point de disparaître, et dont il ne savait pas encore qu’il le quitterait. Les églises et les places, les ruelles, les balayeurs, les vieilles en fichu, les chevaux au cul ciré, les chanteurs mendiants, les enfants du marché: Szigot-Becse, Pozsony, Tisza Szalka.Une image tactile autant que visuelle : toison des brebis, chaumes rêches. Et déjà tous les degrés du blanc au noir : la neige, lorsque durcie en sillons croûteux autour des traces de roues, elle fait comme une partition ; l’ombre portée d’un arbre qui escalade le trottoir et un pan de mur ; une passante aux jambes fines, fantomatiques, que prolonge encore une flaque. Puis Budapest, la guerre : uniformes, tissus cassants, guêtres, faces inquiètes, trains bondés, bras aux vitres, quais des au- revoir.
Paris des années trente voit défiler les grandes figures: Eisenstein tassé sur un tapis, le sourire indécis et barbu de Brancusi, Tzara, Chagall, Calder, Mondrian, des artistes hongrois, des inconnus aussi, tous dans une distance et un calme souverains.
Au nageur sous l’eau de 1917 qui, vu sous la loupe aquatique, apparaissait avec des membres démesurément allongés répond en 1930 la série parisienne des Distorsions : géographie étrange où nombril et chevelure se joignent au-dessus de courbes en lacis : on dirait les premières Formes libres de Moore, le Nu Rose de Matisse ou la Femme devant un miroir de Picasso, avec leurs chairs bombées qui se plient docilement au rectangle du cadre.
« J’ai fait une série pour Querelle, qui dirigeait la revue Le Sourire. Pour quelques sous, j’avais acheté une petite glace pour un parc d’amusements, dans un junk store.
Et puis je suis parti en Amérique en 1936; nous étions ma femme Elizabeth et moi sur le bateau, voguant vers ce que nous croyions être une année sabbatique. Je suis resté quarante ans en Amérique.
« Beaumont Newhall, le conservateur du Musée d’Art Moderne, a vu mes Distorsions. Il m ‘a dit : ‘Je veux les exposer, mais pourrais-je couper le sexe ? Les poils, c’est de la pornographie’.
-Mais vous, vous êtes complet comme vous êtes, que diriez-vous si je cadrais vos oreilles ou vos orteils ?
Complètement désorienté, j’ai fini par céder. Mais j’y pense encore. J’aurais dû comprendre et rentrer tout de suite à Paris. »
A New York, Kertesz continue à travailler surtout en noir et blanc :
“Dans le blanc et noir l’on a toutes les couleurs que l’on veut. En couleur, on ne peut qu’utiliser la gamme voulue par le fabricant. Ça donne de temps en temps de très jolies choses, mais pas exactement ce qu’on veut. Et moi, ça m’ennuie: mon image, je veux la contrôler complètement. »
Images où parfois l’espace est simplifié, réduit à quelques signes: résilles des ombres de chaises en conversation, humains noyés comme des îlots dans le tissu des pavés, des moellons, géométrie des fils électriques ou des cordages de bateaux, dents de fourchette, branches de lunettes, cordes de violon. Dans les plans imbriqués des parois, la photo découpe des jambes sans torses.
Parfois Kertesz s’attache aux corps sensuels, aux mains abandonnées dont l’une retient le doigt de l’autre; aux moments de creux, quand la tête se relâche et pend sur le dossier, aux rires, aux lectures, aux baisers, aux surprises. Parfois, au contraire, il édifie avec le verre et les ombres, les graffitis et les gratte-ciel, une architecture des instants. Il me commente quelques-unes des images qu’il va donner à la Bibliothèque Nationale, et que le grand tireur new-yorkais Igor Bakht a
rendues avec cette justesse qui vient d’une longue collaboration quotidienne : » Vous voyez, le petit nuage qui flotte, là, près des buildings, il est tout perdu. Un nuage de campagne égaré… Ici, c’est le petit train de Meudon. C’est l’année où j’ai eu le Leica. J’ai entendu le bruit du train, j’ai attendu qu’il rentre dans la photo. »
Il y a des photographes qui s’approprient un territoire et passent leur vie à le baliser. D’autres sont comme de grands oiseaux qui balaient un territoire immense. Leur vol imprévisible alterne lignes droites et courbes, chutes en piqué, grands battements concentriques, changements brusques d’altitude.
Ainsi Kertesz déroute; il ouvre les portes. Ses multiples suiveurs le pillent d’autant plus aisément qu’il n’a rien verrouillé et que, prévoyant les impasses de toute systématisation, il ne s’est pas donné la peine d’exploiter ses découvertes.
Aussi, bien qu’on reconnaisse ses photos au premier coup d’œil, il n’y a pourtant pas de « style Kertesz »; mais une façon d’être fluide, de passer sans peser, sans démontrer. Une économie de la vision, une horreur du pathos, la connivence souriante du promeneur à la petite semaine qui prend au vol des fragments.
Tendre, Kertesz crée là où il s’arrête une aura de tranquille évidence. Regarder ses photographies, c’est comme se retrouver, retrouver une source obstruée, s’en abreuver. Reconnaître que nous étions aveuglés d’habitude, et murmurer pour soi : oui, c’est cela, exactement cela.
Quoi ?
Le grain du monde.
Temple de Saihō-ji (Saihō-Ji, Kyoto, 2015)
Orage sur le magnolia
Cent lèvres mouillées sourient
Dans l’herbe du lendemain
Pétroglyphes (Parc national de Saguero, près de Tucson, août 2008)
Il serait facile de ne pas voir ces roches, au bout du chemin encombré de broussailles; on pourrait se laisser distraire par la splendeur des arêtes violettes à l’horizon, la beauté des cactus épineux parés de fleurs rouges, les lanières effilochées des nuages qui se bousculent comme un troupeau de brebis folles.
Les roches noires luisent. Il faut regarder avec les doigts, au ras du sol. Longuement contemplées, les griffures du granit deviennent spirales, et peu à peu la forme d’un labyrinthe s’affirme, comme une photographie qui monterait à la surface du révélateur.
Une illusion des sens, presque, qu’un pas de côté effacerait.
L’orage gronde. Sous la pluie, la roche est comme une joue mouillée de larmes qui porte, dans son tatouage de pétroglyphes, le souvenir de tribus disparues.
Récits instantanés : avec 22 photographies
Atelier de l’Agneau, coll. “biophotos”,
Atelier de l’Agneau, 2019,
144 p. — 20,00 €.
ISBN 978-2-37428-026-4
Pour commander le livre : https://atelierdelagneau.com/accueil/232-recits-instantanes-avec-22-photographies-9782374280264.html