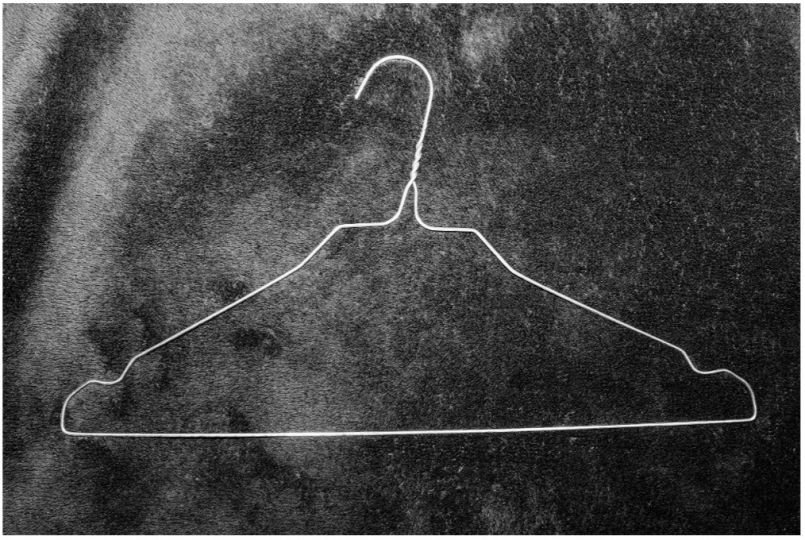Au Centre Pompidou, l’exposition-fleuve Corps à corps propose une relecture intelligente et puissante de l’histoire photographique par le prisme de deux collections, celle de l’institution en dialogue avec celle de Marin Karmitz.
Résumer l’histoire de la photographie est une tentative vaine comme inépuisable. Des ouvrages s’y sont exercés avec plus ou moins de réussite. Aux exemplaires encyclopédiques ont fait face des lectures circonstanciées, parfois brillantes comme Une histoire mondiale de la photographie de Naomie Rosenblum, des approches nationales et historicisées comme 50 ans de photographie française de 1970 à nos jours de Michel Poivert, des essais brefs et lumineux comme la Petite histoire de la photographie de Walter Benjamin ou La Chambre claire de Roland Barthes, et plus récemment, de nombreux ouvrages féministes proposant une histoire de l’art dégondée de ses carcans (Femmes Photographes dirigé par Clara Bouveresse ou encore Une histoire mondiale des femmes photographes de Luce Lebart & Marie Robert).
La littérature sur le sujet est légion, sans jamais épuiser (encore) le sujet des inventions techniques, de l’aventure du photojournalisme, de la sensualité elle aussi aventureuse, des bousculades formelles, des chapelles du noir et blanc défendues contre l’ineptie de la couleur, jusqu’à la récente transformation de l’image en un flux permanent. Livres comme expositions donnent à comprendre une histoire gigantesque formée en si peu de temps, deux siècles à peine, si peu d’années pour un vieil art. C’est là la force comme l’écueil de ce médium : suivre les technologies et les économies, être à la fois l’apanage d’un art et le passe-temps des loisirs.
Sur les murs des musées, l’exercice a été plus d’une fois tentée. L’exercice des collections demeure souvent le prisme d’une histoire particulière, reflet non seulement de l’institution, mais des sensibilités de chacune. Celle qu’offre en ce moment le Centre Pompidou est toute sauf exhaustive — et c’est là un écueil savamment évité. Elle témoigne de sensibilités communes propres à deux collections, celles du Musée national d’art moderne et celle du collectionneur Marin Karmitz. Sous-titrée Histoire(s) de la photographie, elle veut avant toute chose montrer comment l’humain fut et s’est représenté au XXe et XXIe siècle par l’œuvre photographique.
Explorons d’abord ces deux entités qui font corps. La collection du Musée national d’art moderne est indéniablement la plus riche de France, sinon d’Europe en nombres. Avec près de 45 000 épreuves et 60 000 négatifs, elle couvre les grands mouvements des décennies constitutives de l’histoire photographique — du surréalisme au constructivisme — tout en étant attentive à la création récente. Ses grands fonds (László Moholy-Nagy, Brassaï, Eli Lotar, Man Ray, Gaston Paris, Sabine Weiss etc.) témoignent aussi de quelques manques et faiblesses, les collections étant hélas souvent regardées à l’aune de ce qui ne s’y trouve pas.
La collection de Marin Karmitz, cinéaste militant dans les années 1960 et 1970, figure incontournable du cinéma européen, se trouve en nombre bien plus réduite. 1000 tirages constituent face à une collection publique enrichie de donations et acquitions une comparaison bien ridicule, qu’il faut juger dans la qualité de sa sélection et dans la conduite d’un geste individuelle, celui du collectionneur avisé, aux fascinations éclairées.
Ici regards publics et privés se complètent plus que ne s’opposent. C’est un face à face sans que ne soit pensé une opposition, ou bien plutôt, une histoire complémentaire sans exhaustivité ni généralité. Pensée par la conservatrice Julie Jones, Corps à corps veut bien davantage dévoiler des fascinations communes, sinon des obsessions qui se révèlent tant dans la collection publique que chez l’homme-collectionneur.
L’exposition se décline en chapitres déclinant un vocabulaire aussi propre à la figure humaine qu’au champ photographique même : premiers visages, automatismes ?, fulgurances, fragments, en soi, intérieurs, spectres. Le corps est un sujet bien contemporain, comme le sont l’identité ou l’intimité, mais cette porte d’entrée semble la plus naturelle tant l’humain tourne d’abord son objectif vers soi, sinon vers l’autre, du moins vers la chair, un visage, une émotion.
Le dialogue commence avec une série de visages, dont des études souvent ignorées dans l’œuvre du sculpteur Brancusi saisissantes de réalisme et d’angoisse. Donner à voir l’autre, le faire exister, le sortir de son anonymat, le représenter passe avant tout autre geste par son visage. L’œuvre Ian Walker, South Uist, Hebrides de Paul Strand (1954) est l’un de ses portraits qui attirent immédiatement l’œil, qui se défait des marqueurs historiques propres à chaque photographie, pour ancrer dans un sentiment vif un saisissement inhérent au regardeur.
Plus loin, le chapitre Fulgurances revient sur la traque de l’immédiat, sur les impressions fugaces, sur la majuscule des anonymes. Ce sont les gueules usées des travailleurs du métropolitain new-yorkais de Walker Evans, et puis les voyous de Brassaï, farauds parigots qui dans l’œil du photographe-chasseur montre l’humain dans ses relâchements complets, quand il n’est plus que soi ou paraître.
Et puis il y a ces morceaux de corps, ces bouts de muscles et ces silhouettes à peine perceptibles. C’est le chapitre Framents, qui aurait pu s’appeler aussi bien Fugaces et qui donne libre voix et cœur aux jeux des compositions comme à la fascination des détails. C’est cette Canopée de Saul Leiter (encore lui, comment m’en échapper ?) et surtout les muscles luisants brandis comme des massues de Riveteuse pour navire de Jakob Tuggener (1947).
Sautons encore quelques chapitres, ne suivons pas les lignes, car au fond, l’exposition dans ses derniers instants brille, fascine, émeut, renverse encore et encore. Il y a le plaisir à revoir la série San Clemente de Raymond Depardon sur l’enfermement psychiatrique et ses dérives et son pendant, Pigalle et sa folie nyctalope de Christer Strömholm avec la série « Les amies de Place Blanche ». Il y a encore les spectres, les fantômes, les silhouettes, les apparitions, les dédoublements, les jeux de reflets qui n’épuisent pas les figures de style, de la partie spectre. Tout un monde de dédoublements et de reflets, qui dit en conclusion que la figure humaine n’est jamais ce qu’elle est, n’est jamais non plus représentation, mais plutôt bien l’entre-deux d’une fiction et d’une vérité.
Un mot encore, un dernier. Corps à Corps s’avère une lecture partielle de la photographie réussie par sa sélection comme par son jeu scénographique. Le dialogue espacé entre les œuvres est élégant dans ses murs gris perle et le jeu des dédales, des chapelles et intérieurs donnent l’impression tenace d’un plongeon. Celui de notre l’intériorité ? Celui d’une histoire qui s’ouvre et vous aspire ?
Arthur Dayras
Corps à corps.
Histoire(s) de la photographie. Collections de photographies du Centre Pompidou – Musée national d’art moderne et de Marin Karmitz
Commissariat : Julie Jones, conservatrice au Cabinet de la photographie, Mnam-Cci avec Marin Karmitz.
6 septembre 2023 – 25 mars 2024
Galerie 2, niveau 6
Centre Pompidou,
75191 Paris cedex 04