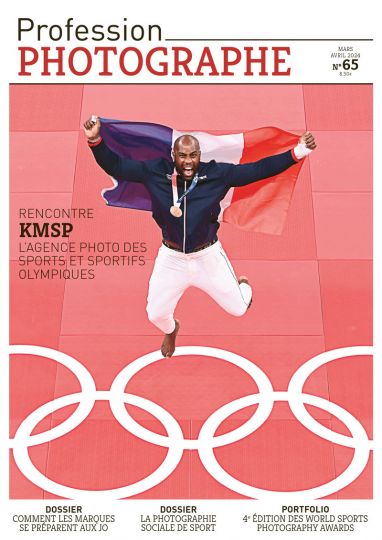Dans le livre Une histoire contrariée. Le musée de photographie en France (1839-1945), l’historienne Éléonore Challine retrace le lent et délicat processus de légitimation de la photographie au sein de la sphère institutionnelle française. Cette histoire est animée par des personnalités singulières, toutes convaincues de la nécessité de préserver la photographie et de lui donner un musée. Conçu sous la forme d’une vaste et minutieuse enquête, à la recherche d’archives et de traces écrites ou visuelles inédites de ces projets, cet ouvrage se déroule, tel un drame bourgeois, en cinq actes. L’Œil de la Photographie vous propose aujourd’hui un extrait—le dernier d’une série de trois—intitulé « Les ambiguïtés d’un collectionneur ».
Tous les musées, quels qu’ils soient, se sont constitués originairement de la même manière. Une collection-mère, due à une initiative privée, en forme de premier apport, puis peu à peu, avec le temps, s’ajoutent à celle-ci à titre de legs ou de don d’autres collections. Celui de la photographie ne serait ni long ni difficile à mettre sur pied. Il existe en puissance. Une parcelle de ses richesses, c’est-à-dire de la richesse d’une collection unique au monde, celle de M. Cromer, a constitué déjà l’année dernière, sous le nom de « Rétrospective Niepce Daguerre », une sorte de petit musée provisoire à l’Exposition de la photographie du Palais de la porte de Versailles.[1]
Beaucoup pensaient que la collection Cromer deviendrait facilement une collection publique, à une époque marquée par l’augmentation des dons et des legs à l’État. Certes, depuis la fin du XIXe siècle, le collectionnisme était repéré comme l’un des phénomènes « les plus notoires de la modernité, associé à l’essor du bibelot, la croissance du marché de l’art et la multiplication des musées. »[2] Walter Benjamin voyait même dans la pratique de la collection privée une manifestation sociale et culturelle majeure du XIXe siècle et, faudrait-il ajouter, du premier XXe siècle. Ce collectionnisme privé n’était pas sans conséquence sur la sphère publique des musées. En effet, à partir de 1900, l’augmentation des dons et legs accompagne la politique mise en place sous la IIIe République, qui soutient les créations muséales au nom de la grandeur nationale et du rayonnement international de la France.[3] Pour autant, comment passait-on de la collection privée à la collection publique ? L’un des principaux outils juridiques en était la donation qui constituait en ce sens une reconnaissance du goût des collectionneurs. Or, précisément, ce processus échoue pour la collection Cromer, qui avait pourtant une longueur d’avance sur les collections publiques en matière de photographie.
À deux reprises, Cromer propose ouvertement sa collection à l’État.[4] En 1925, il se déclare prêt à l’« abandonner » : « Et nous-mêmes, le jour où notre projet se trouverait réalisé, au moins dans des proportions suffisantes, nous serions prêts à abandonner notre propre collection à l’œuvre nouvelle, contre certaines conditions purement morales. » Il faudrait que l’une des salles porte le nom de son demi-frère cadet, mort pour la France, que lui-même soit autorisé à continuer de s’occuper de cette collection et à l’augmenter, « comme si elle était toujours nôtre ». Cromer peine à aller au bout de la dépossession. D’une manière ou d’une autre, il en restera le gardien à vie. De ce fait, ses propositions sont toujours ambivalentes.
La deuxième fois que Cromer cherche à convaincre l’État de la valeur unique de sa collection, c’est en 1931. Mais alors, il n’est plus question de don. Face à la crise financière et boursière qui a mis à mal ses revenus, Cromer veut échanger sa collection contre une rente. Il propose donc de la céder à l’État, en l’installant, la classant, et la cataloguant pour 24 000 francs annuels. Il fait le calcul : cette rente ne coûterait pas plus de 320 000 francs au trésor public (soit treize années de revenus). Et d’ajouter que cette somme est inférieure à la fois aux offres reçues de l’étranger et au prix que la réunion de cette collection lui a coûté. Le collectionneur a revu ses exigences à la hausse :
« Cette collection devrait au surplus, entre autres conditions, être conservée (partie accessible au public et réserves) dans des locaux appropriés et à l’abri des risques ; elle devrait toujours former un tout portant mon nom, et dont aucun élément ne pourrait jamais être séparé ; aucun des objets la composant ne devrait jamais être prêté, même temporairement. »
Comme de nombreux collectionneurs, Cromer vit dans l’angoisse de la dispersion de cet ensemble qu’il a conçu comme un tout organique. On ignore la réaction de la Direction des beaux-arts à sa lettre – le silence des archives est parfois éloquent.[5] À sa mort, la question est de nouveau posée :
« Et maintenant que le futur conservateur du Musée de la photographie—ainsi l’appelait-on souvent—vient de nous quitter, une question importante se pose. Que vont devenir des collections qui, pour la France, Mère de la photographie, devraient nécessairement faire partie intégrante de son patrimoine ? Vont-elles être dispersées ? Vont-elles partir à l’étranger ? Les convoitises du dehors sont nombreuses et ardentes. »
Dialogue de sourds
Les archives le confirment, la Direction des beaux-arts a bien fait une timide tentative de rachat. Au lendemain même de la mort du collectionneur, le directeur d’Arts et Métiers graphiques, Charles Peignot, a été envoyé en éclaireur. Voici ce qu’il écrit à la veuve de Cromer :
« Je n’avais eu le plaisir de voir Monsieur Cromer qu’une fois, lorsqu’il avait bien voulu me recevoir pour me montrer son admirable collection photographique. À ce moment, Monsieur Cromer m’avait dit qu’il regrettait qu’il n’y ait pas en France un Musée de la Photographie auquel il pourrait faire abandon de sa collection. Je ne sais quels sont vos projets, ni si Monsieur Cromer a exprimé ses volontés à ce sujet. Je me permets de vous écrire, car je suis en mesure de vous dire qu’un projet est actuellement à l’étude dont la réalisation aurait sûrement répondu au désir exprimé par Monsieur Cromer. J’aimerai [sic] beaucoup vous voir et savoir quelles sont vos intentions. »
Sans aucune fonction officielle à la Direction des beaux-arts, Peignot est l’un des émissaires choisis pour entamer les négociations avec Mme Cromer. Deux semaines plus tard, en janvier 1935, Peignot revient à la charge dans une lettre, où il précise que c’est le directeur général des Beaux-Arts lui-même, Georges Huisman, qui l’a chargé de cette mission. Un rendez-vous est littéralement imposé à la veuve le samedi suivant. C’est un fiasco. Voici la version de Marie Cromer, qu’elle a griffonnée au recto et au verso de la lettre :
« J’ai reçu à Clamart trois personnes (sont arrivées avec une heure de retard). Ce jour étant réservé au cimetière, j’ai dû leur faire comprendre que je n’avais plus le temps, ne voulant pas manquer ma visite au cimetière. […] Ces trois personnes cherchaient les avantages qu’ils pourraient tirer de cette collection. »
Charles Peignot bien sûr, Laure Albin Guillot, photographe et directrice des Archives d’art et d’histoire depuis 1932, d’autre part. On ignore qui était le troisième homme. Et elle griffonne sur la même lettre, excédée : « Mme Albin Guillot me fit entrevoir en ces termes que mon devoir de Française était de léguer la collection faite par mon mari depuis passé trente ans de 1903 à 1934 à l’État purement et simplement. »
Pour la veuve Cromer, il est hors de question de léguer la collection de son mari. Elle se rend elle-même rue de Valois, où elle rencontre le commissaire général de l’Exposition internationale de 1937, Edmond Labbé, et Huisman lui-même. On ignore à quelle date précise elle a accompli cette démarche, mais probablement vers 1938 ou au début 1939, au moment où elle négocie avec Kodak, à qui elle hésite encore à vendre la collection. La réponse qui lui est faite est sans appel, qu’elle griffonne toujours sur la lettre de Peignot : « On me fit comprendre que de grands événements allaient surgir et que l’État ne pouvait rien faire. […] La guerre va survenir, ce n’est pas le moment de penser au musée ! » S’il y a bien eu une offre du gouvernement français en vue de l’acquisition de la collection, elle a été jugée trop basse : l’administration française en aurait offert 300 000 francs, alors que la veuve en voulait 700 000 francs.[6] La collection est donc proposée au plus offrant.
Éléonore Challine
Née en 1983, agrégée d’histoire et ancienne élève de la rue d’Ulm, Éléonore Challine est maître de conférences en histoire de la photographie à l’Université Paris 1—Panthéon-Sorbonne. Une histoire contrariée. Le musée de photographie en France (1839–1945) est son premier livre.
Éléonore Challine, Une histoire contrariée. Le musée de photographie en France (1839–1945)
Publié par les éditions Macula
33€
http://www.editionsmacula.com/
[1] Pierre Liercourt, « Le futur musée de la photographie », Photo-Illustration, no 6, 15 août 1934, pp. 9–10.
[2] Véronique Long, Mécènes des deux mondes, Les collectionneurs donateurs du Louvre et de l’Art Institute de Chicago, 1879–1940, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2007, p. 10.
[3] Ibid., pp. 180–181.
[4] Dès 1918, il faisait preuve de volontarisme à propos de l’Atelier national de photographique qu’il appelait de ses vœux : « Passionnément j’ai consacré ma vie à l’étude et à la pratique de la photographie : je livrerai sans réserves tout ce que j’ai pu trouver d’intéressant au cours de ma carrière, tout ce que mes observations et mon expérience m’ont appris quant à l’établissement et à l’organisation des ateliers et laboratoires […] ». Article inédit de Gabriel Cromer : « Le procédé au charbon et les collections de photographies documentaires | un atelier photographique d’État », mai 1918, exemplaire tapuscrit, BnF, Ad993(9), pp. 7–8.
[5] La copie dont on dispose est celle de Cromer, conservée depuis peu dans les archives du George Eastman Museum. Aucune trace de cette lettre n’a été retrouvée dans les archives de la Direction générale des Beaux-Arts aux Archives nationales.
[6] Lettre de Brigeau, Kodak Pathé, Paris à J. Pledge, Kodak Limited, Wealdstone (Middlesex), Londres, 21 juil. 1938, GEM, boîte 92.