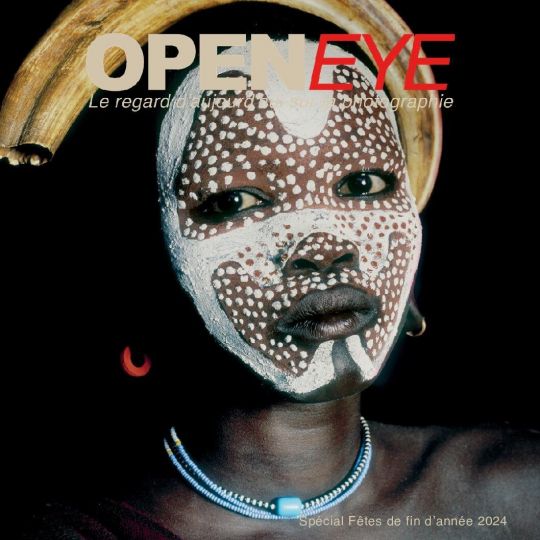Fil tendu entre passé et avenir, entre réalité et fiction, la photographie puise dans ce double va-et-vient sa force mais aussi une ambivalence qui lui confère depuis ses début un statut unique.
Certaines images nous paraissent étrangement familières. Une couleur, un geste, la façon dont la lumière tombe sur un objet : il n’en faut pas plus pour qu’éclatent sans crier gare de brefs éclairs de reconnaissance. La photographie est sans conteste le témoin privilégié des liens qui nous unissent aux gens que nous aimons, aux lieux auxquels nous appartenons. Véritable révélateur de nos états d’âme, elle esquisse jour après jour, une topologie du souvenir. Sa plus grande force réside dans son aptitude à faire surgir une poésie du détail au cœur du désordre qui nous entoure. Si le lien entre mémoire et image photographique n’est plus à démontrer, il est bon de rappeler que c’est la charge poétique de cette dernière, son caractère d’empreinte irréfutable bien plus que sa capacité à ressusciter le passé qui lui confère ce pouvoir ambivalent.
J’ai éprouvé il a peu de temps ce léger trouble devant la dernière série de Linda Brownlee. Les images de la photographe britannique irradient cette beauté tranquille qui échappe à toute chronologie. I Zii explore le quotidien d’une famille dans un village sicilien de quelques milliers d’habitants, non loin de Palerme. Des portraits sans apprêt côtoient des scènes prises sur le vif. Chaque instant possède une densité, une épaisseur tangible dans laquelle vient s’ancrer le réel. Linda Brownlee enregistre avec une tendre curiosité des détails visibles d’elle seule. On sent chez elle une forme de disponibilité à ce qui existe au plus profond de chacun, une volonté de s’ouvrir à l’infinie singularité des êtres et des choses. Son regard dépourvu du moindre voyeurisme se porte sur les petits rituels qui emmaillent nos existences, les instants fugitifs de bonheur : un repas d’anniversaire, la douceur d’une après-midi d’été. Sur une image, deux jeunes filles vues de dos se lavent sous la pluie. Le plan est assez large et laisse deviner un bout de maison et un paysage détrempé.
Ces champs disparaissant dans la brume automnale, ces sentiers tapissés de fruits trop mûrs ressemblent aux vestiges rêvés de notre enfance. Les saisons se succèdent, le temps s’enroule sur lui-même… Mieux que l’instrument du souvenir, la photographie en est le substitut. « Elle est le grain et l’essence » écrivait Susan Sontag. En nous rappelant notre impuissance fondamentale face au temps qui s’enfuit elle modèle douloureusement notre identité et nous oblige à repenser notre rapport au monde. Passé et présent cohabitent, se transforment mutuellement en fonction de nos craintes et de nos peurs. Marcel Proust poussant un peu plus loin l’analogie comparait la mémoire à une sorte de chambre noire intérieure qui garderait, dans un état de latence, les impressions trop douloureuses, ainsi préservées intactes par le vide protecteur de l’oubli.
Longtemps, j’ai gardé, épinglée au-dessus de mon lit, la reproduction d’un polaroid du cinéaste russe Andrei Tarkovski pris en Toscane pendant les repérages du film Nostalghia. On peut y voir un bouquet de fleurs posé sur une table, les traces d’un repas, trois fruits posés sur une petite assiette en porcelaine. La fenêtre à l’arrière-plan déverse une lumière chaude sur la nappe blanche et enflamme le jaune des dahlias. Cette image à la simplicité trompeuse, exprime pleinement la profonde complexité des connexions qui président à la création de nos souvenirs. Elle ouvre une brèche dans le futur, nous projetons vers l’infini au lieu d’entretenir une inépuisable nostalgie envers un passé devenu inaccessible. Pour Andrei Tarkovski, une image artistique est « une image qui garantit son propre développement, un symbole de la vie plutôt que la vie elle-même, une incarnation de l’espoir ».
Tout œuvre d’art échappe à son créateur pour se soumettre au regard du spectateur. Et c’est dans ce mouvement même qu’elle trouve sa raison d’être. Elle s’adresse à quelque chose d’indéfinissable qui sommeille en nous. Les artistes de tout temps n’ont jamais fait autre chose qu’interroger ce mystère. Comment dire l’indicible ? Comment faire entendre cette petite musique secrète ? Citons les corps aériens en suspens, entre terre et mer, de Jacques Henri Lartigue, les détails vibrants d’intensité, extorqués au quotidien de Rinko Kawauchi, la douceur élégante des premiers clichés de Saul Leiter, bien avant la couleur et la reconnaissance. Des images de son père, de ses amis, de ses amours. Qui mieux que lui a su capter la grâce de l’instant qui passe. Le miroitement de la vie dans ce qu’elle a de plus intime ? Saul Leiter est le photographe d’un monde flottant à la lisière du réel cherchant sans répit les traces de vies révolues ou encore à venir. « Quand nous ne savons pas pourquoi le photographe a pris une photo et quand nous ne savons pas pourquoi nous la regardons, alors seulement nous commençons à voir. J’aime cette confusion », déclarait-il.
Comme l’analyse le psychiatre et chercheur Serge Tisseron, si la photographie propose depuis ses origines une réalité mixte, c’est parce que réalité et fiction s’y entremêlent d’une façon presqu’impossible à départager. Elle se construit dans un va et vient permanent entre la réalité objective et cette autre forme de réalité que sont les images intérieures du photographe. La mémoire ne fonctionne pas de façon différente. « Elle ne cesse pas de transformer la matière du souvenir : elle l’étire, elle le concentre selon les cas, en prélève un détail, l’agrandit, le modifie, et cela sans fin ».
Pour reprendre la jolie formule de la photographe française Camille Bonnefoi, « la photographie est une écriture blanche venant à chaque instant reformuler notre mémoire. Elle se montre capable de combler, les vides, créer les souvenirs qui nous font défaut ». Elle forme une sorte de grand album de famille universel dont nous possédons tous une infime parcelle, et chaque image qui le compose fait à tout jamais partie de nos vies, de notre expérience personnelle. C’est aussi l’histoire d’une identité perdue, celle de l’enfance qu’on croit connaître parce qu’on l’a vécue. Le plus terrible, c’est que d’autres s’en souviennent mieux que nous et possèdent quelque chose de nous qui forcément nous échappe. « Nous sommes tous étrangers à nous-mêmes, et si nous avons le moindre sens de qui nous sommes, c’est seulement parce que nous vivons à l’intérieur du regard d’autrui ».
Cathy Rémy
Cathy Rémy est journaliste au Monde depuis 2008, où elle s’attache à faire découvrir le travail de jeunes photographes et artistes visuels émergents. Depuis 2011, elle collabore à M Le Monde, Camera et Aperture.