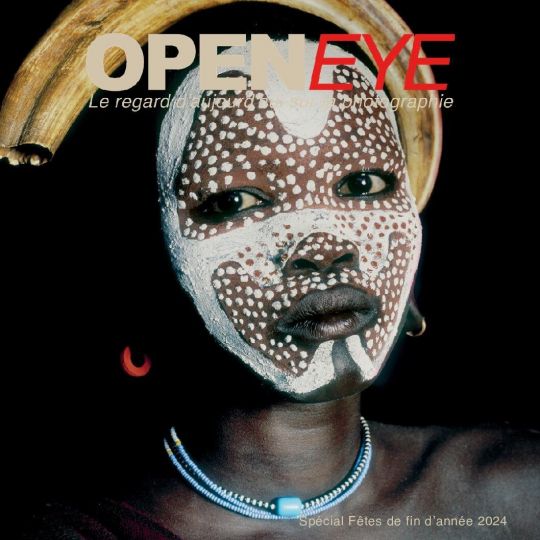Il est des œuvres qui, immédiatement, s’inscrivent dans une tradition. Qui la prolongent, l’actualisent, voire la dépassent ou, en tout cas, lui offrent de nouvelles perspectives. C’est le cas du Julie Project de Darcy Padilla, chronique attentive d’une rencontre faite le 28 février 1993 qui allait devenir plus qu’un accompagnement : une autre façon de vivre, jusqu’à la disparition, le 27 septembre 2010, du personnage central de ce “portrait” hors norme, et au-delà.
Ce travail au long cours appartient indéniablement à une tradition américaine : celle de l’essai photographique, de la narration journalistique en images, qui fut rendue possible par un type de publication hebdomadaire — Life,en l’occurrence —, différent de ceux qui avaient existé avant la Seconde Guerre mondiale dans une Europe inventant une place pour la photographie dans la presse illustrée. Un modèle qui sera repris par Paris Match et Stern, entre autres, dès l’immédiat après-guerre.
Darcy Padilla — dont on apprécie qu’elle ait été honorée du prestigieux prix portant le nom de son photographe de référence — cite évidemment W. Eugene Smith, inventeur du genre et, tout particulièrement, son Country Doctor, dont pas moins de 28 photographies furent publiées le 20 septembre 1948 par Life, sur douze pages, pour conter la vie quotidienne du Dr. Ceriani dans l’État du Colorado. On remarquera cependant que le photographe n’avait consacré “que” trois semaines à son reportage, et que ses travaux ultérieurs, à Pittsburgh ou à Minamata, s’apparentent davantage à la pratique de celle qui n’a pas hésité à poursuivre durant des années le même sujet.
Par le choix du noir et blanc, par la décision de se fondre dans le quotidien de ceux qu’elle photographie, par l’empathie — qui ne signifie ni une acceptation ni une justification — pour des personnages dont elle cherche avant tout à comprendre et à nous faire comprendre l’histoire et la logique, par la claire volonté de nous mettre face à une situation sociale inacceptable dont la responsabilité ne saurait incomber aux seuls “marginaux ” qui en sont les victimes, elle nous entraîne à la fois dans le partage, la découverte et le questionnement. La question, centrale dans ce type de projets, est résolue par l’évidence que donne la décision de poursuivre dans le temps, et la chronologie s’impose. Afin, entre autres, de ne pas aboutir à des descriptions caricaturales ou à des “humanismes” confits de bonnes intentions, dénonciations faciles qui donnent bonne conscience et ne servent à rien. Car le récit de Darcy Padilla, qui s’interdit tout jugement moraliste, n’a pas pour fonction de tenter de “sauver” des malheureux mais, au-delà de l’accompagnement vécu — qui relève de la sphère privée entre Julie et elle —, de nous permettre de décrypter des comportements dans leur complexité. C’est là que la photographe actualise au mieux une modalité de la photographie documentaire que l’on pourrait penser comme datée. Sachant qu’elle n’œuvre plus dans le champ d’un “photojournalisme ” qui n’a plus cours, elle sait éviter à la fois le sentimentalisme, la démonstration — que la photographie est incapable de mener de façon satisfaisante —, le spectaculaire facile et l’œuvre de charité. Cela tient essentiellement à une capacité, instinctive puis maîtrisée, de trouver la distance de prise de vue juste, le point de vue exact qui permettra de contourner tous les écueils repérés.
Mener, par touches répétées qui dépendent entièrement de la situation, un récit sur le long terme revient à une permanente prise de risques — risque de la répétition, entre autres, parce que les situations, dans l’univers concerné, se répètent, hélas. Non seulement Darcy Padilla assume cette difficulté mais elle la met à profit pour nous faire saisir à quel point son héroïne se retrouve dans une situation difficilement dépassable. Le huis-clos dans lequel elle se trouve et s’enferre n’est jamais que la transcription de celui dans lequel la société l’a placée. Drogue, sida, marginalisation sociale, nous connaissons tous ces situations et elles ont donné lieu à bien des “reportages”, de grande qualité parfois. Ce qui différencie la proposition de Darcy Padilla, outre l’ampleur du travail dans le temps, réside dans la position qu’elle adopte vis-à-vis de Julie. Elle parvient à conserver un équilibre entre sa position de témoin, de chroniqueuse, et celle d’accompagnatrice, à la limite du travail social sur le terrain. Elle redonne un autre sens au travail de ceux que les Américains ont qualifiés de « concerned photographers » — photographes engagés —, au premier rang desquels ils ont naturellement fait figurer W. Eugene Smith.
Si cette fresque impressionne autant qu’elle émeut par sa dimension, elle ne manque pas de poser, aujourd’hui, les questions de sa fonction et de son sens. Alors que les images circulent tous azimuts sous forme de pixels, encombrant les réseaux au point de devenir indéchiffrables, il n’y a pas encore d’espace — fût-ce actualisé — pour occuper la fonction des Life, Paris Match ou Stern d’antan. Alors, à quoi bon ? Cette photographie, tout d’abord, exige que nous prenions le temps, pour la lire, d’adopter une attitude qui fasse écho aux conditions qui ont présidé à son élaboration. Que nous résistions calmement à l’accélération permanente qui fait que nous restons à la surface et, par conséquent, ne voyons plus et comprenons encore moins la situation des millions de Julie que génère le monde contemporain. Cet appel à voir et non à survoler, cette prise de conscience des possibilités qu’a la photographie de transcrire et de décrypter, de proposer des éléments d’analyse et des directions de lecture de situations actuelles et complexes sont tout bonnement salutaires. Ils supposent un vrai fonds d’optimisme et une réelle générosité, la conviction, également, que nous ne sommes pas prêts à fermer les yeux devant ce qui nous semble difficile, inacceptable ou tout simplement problématique dans le monde contemporain.
Alors que les mutations et crises de la presse généraliste et des hebdomadaires d’information qui n’accordent plus guère d’espace aux essais photographiques et réduisent l’image fixe à une médiocre fonction d’illustration, que faire de tels ensembles d’images ? C’est de façon absolument naturelle que le livre ou de nouveaux types de périodiques qui y font référence s’imposent. Non seulement parce que le livre permet de publier de façon développée le propos mais aussi parce qu’il est un espace naturel, dont on reconnaît enfin aujourd’hui l’importance dans la constitution de l’histoire de la photographie, pour une expression contrôlée de leur propos par les photographes. Il n’est pas inutile de rappeler que sur la couverture du numéro de Life qui publia le Country Doctor de W. Eugene Smith figurait l’actrice Joan Diener, star de Broadway, photographiée par le même Smith. Et qu’il serait hasardeux de croire à un quelconque “âge d’or” de la presse illustrée : il suffit pour cela de lire les mémoires du même W. Eugene Smith qui claqua, après maints conflits, la porte de son magazine de prédilection qui modifiait ses légendes et censurait partiellement ses enquêtes visuelles en fonction de décisions rédactionnelles qu’il ne partageait pas.
Le livre apparaît donc comme le vecteur le plus approprié au travail de Darcy Padilla, parce que, comme lui, il pactise avec le temps, laisse une trace, convertit l’expérience en objet, permet le partage.
Il permet de percevoir ce qui anime un projet dont on ne sait s’il peut avoir une conclusion tant il est devenu lié à la vie même de celle qui le mène avec une discrétion et une modestie que l’on ne saurait comparer qu’à sa ténacité. Il dit la vraie dimension de ce qui ne se fait que par nécessité.
Christian Caujolle
LIVRE
Family Love
Photographies de Darcy Padilla
Editions de la Martinière
1re édition – en français
336 pages
www.editionsdelamartiniere.fr
www.darcypadilla.com