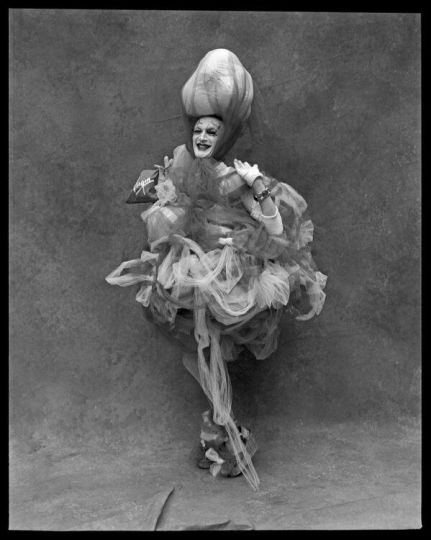Sandra Calligaro est née en 1981. Elle vit et travaille depuis 2007 entre la France et l’Afghanistan. Photographe indépendante, elle est représentée par l’agence Picturetank.
Après avoir suivi des études d’art et de photographie à l’Université Paris 8 et obtenu sa maîtrise, Sandra Calligaro s’oriente vers le grand reportage et fait alors un premier voyage en Afghanistan en 2007 avant de s’y installer. Depuis les quatre dernières années, la photographe alterne reportages pour les médias français et européens (Le Monde, De l’air, Le Nouvel Observateur, Paris Match, Grazia, Elle, Causette, Neon, Omvärlden, Expressen) et commandes institutionnelles pour le compte d’ONG et d’organisations internationales (Médecins du Monde, Action Contre la Faim, Madera, UNHCR, UNODC) et fondations (Fondation Aga Khan).
Elle a notamment réalisé un reportage sur une communauté d’usagers d’héroïne à Kaboul et un travail sur l’exil afghan, qu’elle appréhende depuis deux points de vue : ceux qui partent, ceux qui restent. Le travail fait notamment l’objet d’une publication du UNHCR (Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés) au début de l’année 2011. En 2011, elle s’est notamment consacrée à la réalisation de 10 ans après, Kaboul, un portrait de la capitale afghane dans lequel elle s’éloigne du reportage photographique pour se rapprocher d’une approche plus personnelle.
La série est notamment exposée en Octobre 2011 à l’Institut Français d’Afghanistan à Kaboul avant de l’être à Confluences à Paris en Novembre 2011. Son travail a également été exposé à l’Institut des Cultures d’Islam à Paris en 2009 (Paysans et paysannes d’Afghanistan, une autre réalité) et plus dernièrement à la Maison Européenne de la Photographie dans le cadre de l’exposition collective des 10 ans du magazine De l’air.
2001.
Le Commandant Massoud est assassiné. Deux jours après, le 11 Septembre, les Twin Towers s’effondrent. Les Etats-Unis sont attaqués sur leur sol, la guerre en Afghanistan est déclarée en réponse. Le 14 novembre, Kaboul est libérée. Le régime Taliban chute en décembre, deux mois après le début de l’intervention américaine. Les organisations internationales se déploient dans le pays.
2011.
Après une décennie de présence civile et militaire occidentale, des milliards de dollars dépensés dans l’aide au développement et autant perdus dans les limbes de la corruption, Kaboul est une ville contradictoire, complexe et en pleine mutation, tant au niveau architectural que humain. Elle développe un style unique, celui d’une capitale d’un pays à deux vitesses : d’un côté une croissance économique faussement gonflée par une présence internationale massive et la guerre de l’autre. Comme un reflet de l’évolution des mœurs et de la culture de ses habitants, les bâtiments récents aux couleurs clinquantes jouxtent les constructions traditionnelles, avec plus ou moins d’harmonie et de logique. Les mesures de sécurité de plus en plus drastiques font s’élever toujours plus haut des murs de béton. Barricadés, isolés et défigurés, tels apparaissent le centre-ville et les quartiers d’affaires. Pour autant, les jeunes fréquentent fast-food et supermarchés foisonnants. Quelques mètres plus loin, les bergers font brouter tranquillement leurs troupeaux au milieu des ordures. L’asphalte ne semble pas effrayer les chèvres et les moutons. Jouant avec des bouts de ficelles et des sacs en plastiques dans les terrains vagues, les enfants aux cheveux sales et joues roses sont quant à eux les emblèmes parfaits de la misère.
De Kaboul, on a certainement tout montré, tout vu. La manière de représenter un pays « en guerre » est sans retenue, quasi pornographique. Travaillant régulièrement pour la presse, c’est avec un regard d’auteur que je photographie la capitale afghane, « dix ans après ». Je propose une vision personnelle et sensible de Kaboul, ville qui m’a toujours autant fascinée qu’exaspérée.
J’ai cherché l’humain dans la ville, en tâchant de garder une certaine pudeur et distance. Juste souligner quelques petits détails, ce qui est à peine tangible. Comme un signe de respect pour cette ville qui m’est devenue familière, mais dans laquelle je resterai toujours une étrangère, une «invitée » comme disent les Afghans.
Sandra Calligaro