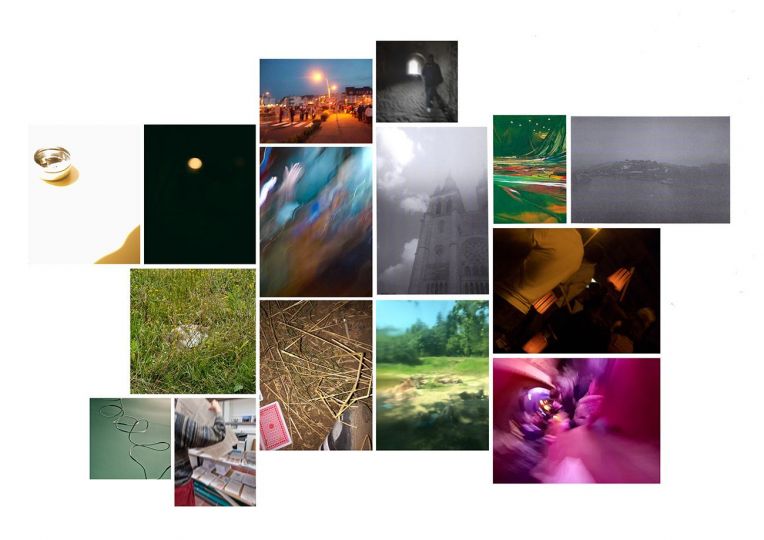À Stockholm et jusqu’au 4 mars 2018, la maison de la culture Kulturhuset nous présente Lee Miller, War and Fashion, une remarquable rétrospective sur cette photographe de mode américaine.
« Bombardier Lancaster, répondez, à vous Lancaster. » C’est la nuit dans le ciel européen et nous sommes le 2 mai 1945. La voix d’une opératrice radio américaine de la Women’s Auxiliary Air Force (WAAF) se mêle au timbre singulier d’une voix qui émane d’un Avro Lancaster en flammes. Le pilote a mis le cap sur la Grande Bretagne après un raid aérien mené au-dessus de Berlin. Peter Carter (David Niven) sait qu’il est condamné. « Je n’ai pas de parachute », explique-t-il à l’adorable June (Kim Hunter), qui déborde de compassion. Production des films Archers, cette romance de guerre céleste s’intitule A Matter of Life and Death (Une question de vie ou de mort, 1946). Peter récite des poèmes et demande à June de transmettre un message d’adieu à sa mère. Il viendra la voir, depuis l’au-delà et la supplie de ne pas avoir peur (elle n’a pas peur du tout). Il veut savoir où elle se trouve et d’où elle vient, lui déclare son amour, lui dit qu’elle est la vie même, mais qu’il doit la quitter. Ils bavardent à bâtons rompus, puis la voix de l’opératrice se brise – car finalement, tout ceci ne rime à rien… L’aviateur l’assure aussitôt du contraire, affirme qu’il a eu de la chance de l’avoir, et s’éjecte du cockpit pour plonger à la rencontre de l’éternité.
Au Royaume-Uni, la WAAF et le Women’s Voluntary Service comptaient environ deux cent cinquante mille et un million de femmes respectivement. Avec toutes les autres mères courage de la population civile, ces femmes époustouflantes représentaient tout le meilleur de ce que pouvait espérer une nation, pour livrer combat contre les conceptions infernales et malveillantes d’un pays désaxé, avec ses idées de « race supérieure », de « solution finale » et d’un « Reich de mille ans ».
À la fin de la guerre, une femme déboule en furie dans les studios de Vogue, à Londres. Armée d’une énorme paire de ciseaux, elle se rue sur les négatifs des photos qu’elle a prises le 30 avril 1945 à Dachau, l’enfer insoutenable implanté à côté de Munich. Antony Penrose, unique enfant de la légendaire Lee Miller (1907-1977), nous raconte : « elle a lancé ‘Je ne veux pas que quiconque puisse voir ce que j’ai vu, mais je vais en laisser juste assez – personne ne doit douter de ce qui est arrivé’. Ils ont essayé de l’arrêter mais ils n’ont pas pu. Je regrette tellement qu’elle ait détruit ces négatifs. J’aurais voulu les avoir aujourd’hui, chacun d’entre eux. C’est difficile à déterminer, mais elle en a probablement saccagé quarante ou cinquante. Il nous en reste à peu près autant. Ces images sont vraiment très dures. Si c’est aux pires qu’elle s’est attaquée, comment oser imaginer ce qu’elles figuraient ? »
Installés au cœur de l’un des espaces brutalistes de la Kulturhuset, deux fauteuils modernistes serviront de point d’ancrage pour un entretien d’une heure avec Antony Penrose, juste avant l’ouverture de l’exposition. Ce monsieur britannique a joué pendant son enfance avec Picasso. Dans le même temps, il a pourtant dû endurer le manque d’instinct maternel de sa mère et ses rages d’alcoolique. « Avec de simples mots, elle était capable d’infliger toutes les souffrances qu’elle désirait. Et elle était particulièrement éloquente. » Malgré tout, il manifeste un immense plaisir à entendre tout ce qui concerne Lee Miller et son travail incomparable, notamment ses photographies de la Seconde Guerre mondiale.
Et nous voici soudain dans cette exposition, dont il dit qu’elle est « une entreprise hautement audacieuse » et « formidablement inspirée ». Demain, M. Penrose aura soixante-dix ans et il se montre enchanté, comme s’il venait de recevoir le plus beau cadeau de sa vie.
« L’ensemble s’est vraiment attaché à la personnalité de Lee Miller et je suis convaincu qu’il va permettre de mieux la connaître. J’en suis reconnaissant. Lee avait le don de rassembler des fragments de vie pour en faire un tout qui ait du sens, et je trouve que ce talent est bien mis en valeur. Où qu’elle se trouve – dans les rues, à Paris sous l’occupation ou à Londres durant l’après-guerre, dans les studios de Vogue ou ailleurs – on voit clairement à quel point elle aimait improviser, créer à partir de rien, nous dit-il. Il eut été facile de remplir la moitié de cette galerie avec des images de combat datant de la guerre. Pour moi, ce que Karine exprime ici, c’est que les gens ont déjà vu ce type d’images et ce n’est pas parce que nous ne voyons pas d’explosions, de fusils et de bombes que la guerre n’est pas présente dans ces photographies. »
Karina Ericsson Wärn dirige le département Art, design et mode de la Kulturhuset, et c’est elle qui a organisé cette exposition si unique en son genre. « Je situe Lee Miller dans la même classe qu’Isadora Duncan, Marlene Dietrich, Elsa Schiaparelli ou encore, à une époque plus moderne, Miuccia Prada et Vivienne Westwood, m’explique-t-elle. Elles ne sont pas photographes, mais ça n’a aucune importance. Ce qui les unit, c’est surtout leur attitude vis-à-vis du monde extérieur et leur expression personnelle. Tout en travaillant à cette exposition, j’ai appris à connaître Lee Miller et j’ai découvert une femme très fragile, qui portait en elle une immense tristesse. Si je dis qu’à mes yeux, elle était en réalité une photographe de mode médiocre, cela peut paraître insensé. Mais ses photos représentent bien plus que des clichés de mode : son travail constitue une véritable fresque de l’époque. Cette femme, qui savait valoriser les autres, était également une pionnière : elle emmenait les mannequins dans la rue et les plaçait dans des situations de la vie quotidienne. »
Sans doute est-il utile de rappeler, à cor et à cris, que la Seconde Guerre mondiale n’avait rien d’une petite révolution catalane de pacotille, baignée de sentimentalisme nationaliste et saluée à grand renforts de drapeaux agités par des âmes crédules. C’était le conflit le plus terrible et le plus sanglant de toute l’histoire, un carnage de six ans qui décima trois pour cent de la population mondiale – soixante-dix millions d’êtres humains. Pendant cette guerre, qu’elle vécut et photographia comme personne d’autre, Lee Miller fit des miracles chez British Vogue et on peut dire qu’elle excellait. Dans une lettre datée du 14 décembre 1941 et adressée à ses parents, qui vivaient aux États-Unis, elle se confie : « il semble assez idiot de continuer à travailler sur un magazine aussi frivole que Vogue. C’est sans doute bon pour le moral du pays, mais pour le mien, c’est terrible. » Dans le même temps, dans son ouvrage Lee Miller, Caroly Burke témoigne de sa « réponse sensée aux accusations de frivolité portées contre le secteur de la mode. Elle concédait volontiers que ‘les vêtements séduisants n’avaient que de peu rapport avec les corps affamés’, tout en précisant qu’ils ‘faisaient beaucoup pour les âmes affamées’. »
Il faut comprendre que les travaux de photographie de Lee Miller sont nés dans des conditions extrêmes, mais que la guerre la faisait bouillir à la fois de fureur et d’excitation. N’oublions pas qu’elle était une surréaliste dans l’âme, et que ses images ont grandement participé à l’effort de guerre. La mode en tant que force perturbatrice et dynamisante, comme courant de résistance – ces images sont tout, sauf médiocres. L’exposition Lee Miller – War and Fashion rend un merveilleux hommage à l’étoffe des femmes.
Quels sont les éléments que M. Penrose apprécie, dans la photographie de mode de Lee Miller ? Sa réponse fuse aussitôt. « J’apprécie l’humour et l’inattendu, le côté certes étrange mais incroyablement élégant. Elle fait en sorte que les femmes soient magnifiques, dans des contextes tout à fait ordinaires. Derrière chaque image, il y a une histoire, grande ou petite. Dans l’instant créé se trouve toujours un épisode de vie microscopique. La photo avec la femme en chapeau à plumes, postée devant le site d’une énorme explosion, est sublime, à la fois techniquement et d’un point de vue artistique. Elle dit tellement de choses. Ces images étaient vues en Amérique et il était très important pour les Britanniques, dans leur démarche de propagande, d’essayer d’influencer les Américains et de les persuader d’entrer en guerre. L’attaque de Pearl Harbour (7 décembre 1941) n’avait pas encore eu lieu. »
Les murs du parcours sont peints en utilisant la même palette que celle de la maison de Farleys House – des teintes étranges de rose, de bleu, de vert, de jaune et de brun. Dans le long métrage Their Finest (Une belle rencontre, 2016) réalisé par Lone Scherfig, avec Gemma Arterton dans le rôle de Catrin Cole, scénariste de films de propagande pour le ministère de l’Information de l’époque, la présence de la guerre est à la fois visible et invisible. C’est la démarche adoptée pour les soixante-et-onze photographies de l’exposition. Les épreuves gélatino-argentiques ont été réalisées pour l’occasion, à partir des négatifs originaux, avec un petit nombre de tirages à développement chromogène, en noir et blanc, et pour la plupart en format Rolleiflex. Fait enthousiasmant, quarante-deux de ces clichés ont été tirés pour la première fois et n’avaient jamais encore été vus.
L’œuvre Fire Masks, Downshire Hill, London, England, 1941 est un merveilleux tableau bouillonnant de surréalisme. Deux mannequins Vogue masquées, l’une coiffée d’un casque et l’autre agrippant un sifflet dans sa main soignée, s’apprêtent à plonger dans le conduit étroit d’un abri anti-aérien, terrier de fortune rose et bleu que Roland Penrose avait creusé dans le jardin de leur maison de Hamstead vers les débuts du Blitz. On a presque l’impression que les deux protagonistes se rendent à une soirée déguisée souterraine. L’image est pleine d’humour, mais ce qu’elle dit vraiment, ce que ces femmes expriment, c’est « nous n’avons pas peur ». Roland Penrose disait que Lee Miller « appréciait, en toute innocence, l’excitation que provoquait le danger ». Et d’ailleurs, elle consultera un jour son cher ami le Dr Goldman, pour lui avouer qu’elle se sent lasse et déprimée. La réponse est claire : « vous êtes en parfaite santé. Le monde ne peut rester en guerre dans le simple but de vous amuser ».
Vive et brillante, Lee Miller est douée d’une audace sans limites et sa créativité inhérente ne s’épanouit que dans l’adversité – guerre et aventures mêlées de danger et de sensualité débridée. C’est ainsi qu’elle parvient à vaincre le traumatisme survenu dans son enfance, une tragédie dont elle ne dit jamais rien. Antony Penrose nous explique : « le viol en lui-même fut un drame terrible, une expérience désastreuse. Les conséquences furent encore pires : elle avait contracté une blennorragie. En 1914, le médicament nécessaire pour la guérir ne serait mis au point que quinze ans plus tard. Pour commencer, elle a dû subir un traitement clinique. Par chance, c’est sa mère, infirmière, qui le lui administrait. Les interventions étaient cependant affreusement invasives et douloureuses. Elle n’avait que sept ans ! Nous pensons qu’elle n’a été guérie que dans les années 1930, à Paris. Elle est allée à l’hôpital Américain, en consultation avec un certain Dr Dax et nous croyons qu’elle a été soignée grâce aux premiers antibiotiques. »
Dans le parcours Lee Miller – War and Fashion, on découvre un instantané d’une prise de vue qui la montre recouverte d’une épaisse couche de peinture blanche, dans Le sang d’un poète, de Jean Cocteau (1932). Elle y joue une statue qui s’anime, pour dire à l’artiste que le seul moyen de sortir du studio est de passer de l’autre côté du miroir – et de plonger ainsi dans l’Hôtel des Folies Dramatiques). Il était dans ses habitudes de voyager à travers les miroirs, d’explorer l’autre monde et de libérer quelque chose de précieux. Dix ans plus tard, alors que l’alliance entre les États-Unis et la Grande Bretagne se noue enfin, elle rencontre l’Américain David Sherman, joyeux personnage et photojournaliste travaillant pour Life magazine. C’est avec lui qu’elle va sillonner le continent européen en tant que correspondante de l’armée américaine pour Vogue. « Elle avait tellement peur de ne pas pouvoir couvrir le plus grand événement de la décennie qu’elle en était presque folle. C’est moi qui lui ai suggéré de poser sa candidature – elle était tout de même citoyenne américaine authentique, une Yankee de Poughkeepsie. »
Le soir du 30 avril 1945, Lee Miller se baigne longuement dans la baignoire d’Adolf Hitler. « Mein hôte n’était point là », écrit-elle à Audrey Withers, rédactrice en chef de Vogue. Lee Miller a déjà été photographiée dans une baignoire, au Grand Hôtel de Stockholm, en décembre 1930, par son ingénieur de père. Il travaillait pour DeLaval, une entreprise suédoise. C’était un véritable Lewis Carroll. Adepte de l’appareil stéréoscopique, il avait un goût prononcé pour les filles jeunes et dénudées, et Lee était son Alice Liddell. Lorsque la BBC diffuse l’annonce du suicide d’Hitler dans son bunker de Berlin, il est minuit. Au même moment, Lee Miller et Sherman s’ébattent dans le lit du Führer, dans son appartement de neuf pièces du 16, Prinzregentenplatz à Munich.
Cette séquence d’événements si étrange est consignée sur une planche contact de douze clichés Rolleiflex. Pour M. Penrose, ils constituent « un genre de poème surréaliste ».
Lee Miller parlait de sa jeunesse en ces termes : « j’étais incroyablement jolie. J’avais l’air d’un ange. Mais à l’intérieur, j’étais un véritable démon ». Paris était la ville idéale, pour une jeune fille délurée de dix-huit ans, animée de vagues aspirations artistiques et dévouée à la culture, la mode et aux plaisirs de la chair. « J’étais passionnée de tout et devant moi, toutes les portes s’ouvraient. » Elle y séjournera en 1925 pendant sept mois – c’est sa mère qui vient la chercher et la ramener à Poughkeepsie, dans l’état de New York. Elle tombe alors dans la dépression. Un jour à New York, à l’époque où elle fait des études à l’Art Students League, une main l’agrippe et la tire brusquement sur le trottoir, alors qu’une voiture va la percuter. L’homme qui vient de lui sauver la vie est Condé Nast, éditeur de magazines. En mars 1927, Lee Miller fait la couverture d’American Vogue.
Ses années courtes mais intenses avec Man Ray, à Montparnasse, se devinent aisément, au travers de cinq photographies solarisées, réalisées depuis son luxueux studio new-yorkais, où elle s’est installée après avoir rompu avec lui en 1932, et dans le studio de Vogue à Londres, dix ans plus tard. Son compagnon lui avait appris l’importance de la plus grande précision, à chaque étape du processus dans sa minuscule chambre noire. Un incident heureux survient malgré tout : un rat lui court sur les pieds alors qu’elle est en train de développer une pellicule de Man Ray. Par réflexe, elle allume la lumière et les douze photos d’une femme nue sont alors exposées, prenant une teinte surréaliste, en négatif.
Un jour, Lee Miller transporte un sein authentique sur une assiette, dans les rues de Paris. Arrivée au studio de Vogue, elle parvient tout juste à prendre une photo de l’organe, encadré de coutellerie et posé sur une nappe – avant de se faire jeter à la porte, avec le sein en question. Dans le théâtre Stadsteatern qui donne sur la Kulturhuset, un chef accessoiriste a conçu deux magnifiques décors très concentrés, une petite cuisine des années 1960 avec une assiette ébréchée et une minuscule armoire des années 1940, avec un miroir brisé.
Les plus belles réalisations de Lee Miller ont été enfermées dans des boîtes, remisées et oubliées. Sa mort, survenue le 21 juillet 1977, ne mérite même pas un entrefilet dans le New York Times. Les dernières prises de vue de l’exposition Lee Miller – War and Fashion sont des images de maillots de bain, de nombreuses photos de Sicile, et un trop grand nombre de Farley Farm et de ses environs – les photos en intérieur manifestent pourtant toute l’énergie qu’on pourrait espérer. « Elle était de l’avant-garde, même avec ses clichés de la Sicile. Aujourd’hui, nous sommes trop gâtés, avec des essais photographiques qui associent mode, nourriture et voyage, mais à l’époque, la recette était inhabituelle. Pourtant, je dois dire moi aussi que les photos de mode de Farley Farm sont plus sages que passionnantes », réagit Karina Ericsson Wärn.
Dépression réfractaire, paralysie, angoisse extrême, obsession du passé… voilà le sort de toute personne qui survit à un choc grave. Continuer à survivre n’est cependant jamais suffisant, il faut toujours faire mieux. Un ami de Lee Miller disait qu’elle était « dans son monde, et pourtant entièrement dans le présent ». Roland Penrose va alors accomplir des exploits – fonder l’Institute of Contemporary Arts de Londres en 1947, avec Herbert Read, écrire des biographies sur les maîtres modernistes, et se faire adouber en 1966. Sa célébrité ainsi acquise va éclipser la vie et l’œuvre de Lee Miller au fur et à mesure que le couple prend de l’âge.
« Elle ne parlait jamais des photos dans le grenier, raconte Antony Penrose. Jamais. Nos maisons étaient bourrées d’œuvres d’art, mais il n’y avait que deux de ses photographies. L’une d’elles s’intitulait « The Procession », et représentait des vaguelettes de sable, parcourues d’empreintes d’oiseaux. L’autre, « On the Road », montrait la carcasse d’un bœuf, dans une charrette dont dépassait ses cornes. Je crois qu’elles avaient été exposées, et c’est pour ça qu’elles étaient joliment encadrées. Ensuite, on les a accrochées et plus personne n’y a fait attention. »
Elle ne faisait pas partie du personnel de Vogue. Par conséquent les Lee Miller Archives détiennent tout ce qu’elle a fait pour Vogue. « Nous avons dû le prouver dès le début, et nous y sommes parvenus. Ils ont arrêté d’essayer de s’approprier les droits d’auteur. C’était dur. Et c’est ce que j’ai fait de plus difficile et désagréable de toute ma vie, se souvient M. Pensore. Il reste très peu de tirages en captivité ailleurs dans le monde. Certains se sont retrouvés au Philadelphia Museum of Art et à l’Art Institution of Chicago – car David Travis, conservateur particulièrement intelligent et avisé, les a achetés à la succession au moment du décès de Julien Levy, l’agent artistique new-yorkais de Lee Miller. Ses œuvres n’atterrissent sur le marché qu’à l’occasion d’un héritage. Et elles sont toujours bien trop onéreuses pour que nous puissions les acquérir. »
L’exposition de la Kulturhuset rend un vibrant hommage à la gloire et à la persévérance des femmes, tout comme le numéro de Vogue publié en janvier 1945, à l’occasion de la Libération. « L’un des faits essentiels qui frappe ceux qui sont à la guerre et qui saisira les historiens, c’est la contribution apportée par les femmes dans tous les domaines, qu’il soit social, médical ou militaire, leur engagement absolu dans l’effort incommensurable que mène chaque nation. »
À la fin du film d’Emeric Pressburger et Michael Powell, tourné en Technicolor à l’automne 1945, l’aviateur de A Matter of Life and Death se réveille dans les bras de la femme qui l’a ramené sur le chemin de la vie.
« On a gagné », s’exclame-t-il, un vibrato dans la voix.
« Je sais, mon chéri. »
Tintin Törncrantz
Tintin Törncrantz est un auteur spécialisé dans la photographie. Il vit et travaille à Stockholm, en Suède.
Lee Miller, War and Fashion
Jusqu’au 4 mars 2018
Kulturhuset
Sergels torg
111 57 Stockholm
Suède
www.kulturhusetstadsteatern.se