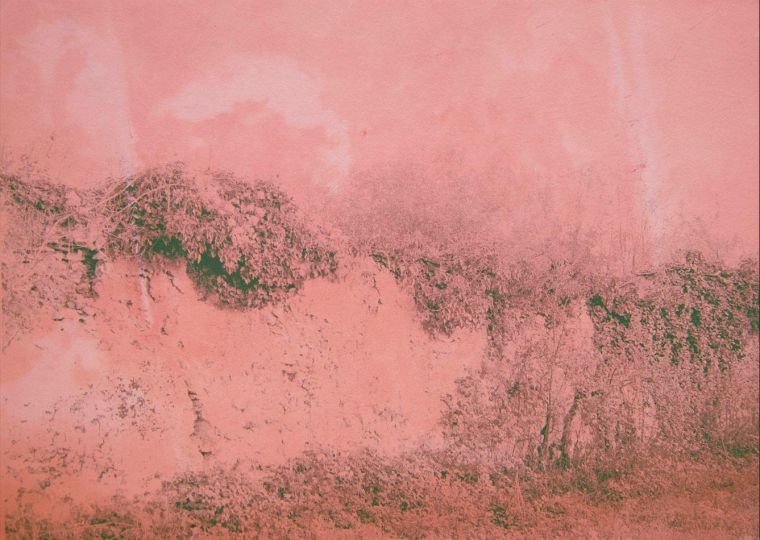En 1999, Babeth Djian – rédactrice de mode et styliste avant-gardiste – crée Numéro, magazine parisien désormais célèbre pour son esthétique unique et audacieuse liant mode et art contemporain.
Dès le premier numéro, puis tous les mois, Babeth donne carte blanche à Guido Mocafico pour les pages de clôture du magazine. Le photographe est libre et ne subit aucun diktat, que ce soit de la direction, des stylistes ou des annonceurs. Un privilège rare dans le monde des magazines de mode d’aujourd’hui, dirigés par la publicité. Mocafico crée des natures mortes immuables et provocantes (de bouteilles de parfums, chaussures, montres ou bijoux) traversées par les grands genres de la photographie tels que l’architecture, le paysage, ou le nu.
Cette tribune – lieu d’innovation et d’expérimentation – offerte par Numéro à l’artiste, lui permet de laisser libre cours à son imagination, de proposer un regard franc-tireur, décalé, critique, voire même cynique sur notre monde contemporain fait de vanités. C’est dans l’émulation de ce foyer créatif qu’il met en place les principes de ses grandes séries comme Medusa, Movement, Serpens, Stilleven qui seront plus tard publiées aux éditions Steidl. Cet ouvrage en trois volumes dévoile cette production créative et annonciatrice de l’œuvre du photographe.
Peut-on savoir comment vous vous êtes rencontrés ?
Guido Mocafico : Ah ça, on ne peut pas le dire.
Babeth Djian : (Rires.)
GM : Je pars du principe que tout ce que l’on dit ici peut être publié.
Vous est-il déjà arrivé de fricoter ensemble ?
GM : Non. Tu confirmes, Babeth, au cas où j’aurais oublié ?
BD : Si c’était arrivé, Guido, crois moi, tu n’aurais pas oublié. (Rires.) Pour répondre à votre question, Guido et moi nous sommes rencontrés au Festival de la photographie de mode de Monaco que dirigeait Hady Sy et où je faisais partie du jury avec Fabien Baron et bien d’autres. On y avait exposé aux côtés des photographies de Guido des tirages de David Sims, Mario Sorrenti, Nathaniel Goldberg, Juergen Teller – au tout début de leurs carrières. Une magnifique exposition était également consacrée à Karl Lagerfeld. Nous nous sommes retrouvés dans l’avion avec Guido et avons parlé très longuement de notre vision du métier, et je lui ai dit à quel point j’étais admirative de son travail. D’ailleurs, pour le premier Numéro, Guido a photographié le pays où je suis née, le Maroc. J’étais bouleversée par ces images mystérieuses et impénétrables du désert la nuit. Guido fait donc partie intégrante de l’ADN de Numéro depuis le début du magazine.
GM : Je me souviens très bien de cette série. La température nocturne dans le désert marocain avoisine les 5 degrés, il faisait un froid glacial et j’ai dû dormir dans le 4X4… Mais que ne ferais-je pas pour Babeth… On s’aime. D’ailleurs, on n’aurait pas pu faire ce qu’on a fait ensemble si on ne s’aimait pas.
BD : L’amour est la plus grande force dans la vie.
GM : La loyauté, c’est une forme d’amour. Est-ce qu’on peut dire qu’on s’aime ?
BD : Je t’aime, moi non plus.
Comment vous est venue l’idée de faire un livre ?
GM : L’idée est de moi. Même si la première à qui j’en ai parlé, c’était Babeth, bien sûr – la principale intéressée. Je voulais qu’elle soit d’accord, qu’elle n’ait pas honte.
BD : Au contraire. J’étais très enthousiaste qu’il souhaite publier un recueil de ses collaborations avec Numéro. Ses séries sont tellement emblématiques de l’esprit du magazine et de la liberté d’expression que nous défendons depuis toujours.
GM : Ma directrice de studio a rempli un classeur de toutes les séries que j’avais signées dans le magazine. Il y avait un corpus d’images phénoménal, qui avoisinait les mille photos… peut-être même plus si l’on compte les séries du Numéro Homme. 1999-2016 : c’est une formidable collaboration sur plus de quinze ans. Il y a même des séries que j’avais oubliées. Du coup, c’était surprenant pour moi de redécouvrir la quantité de travail qu’on a fait ensemble. On a commencé avec des sujets voyages, qu’on a un peu abandonné au fil du temps pour se focaliser sur les papillons, les coquillages, les méduses et les serpents.
BD : Cette série de serpents est passée dans les annales. Elle est devenue complètement iconique. D’ailleurs, elle a inspiré nombre de créateurs. C’était pour le première édition du Numéro Homme, et quelle meilleure allégorie que le serpent pour représenter le désir sexuel des hommes. C’est le symbole phallique par excellence.
GM : Indépendamment de la durée, il y a surtout le fait que Babeth me laisse toujours carte blanche, même s’il y a des moments où je ne suis pas tendre avec le milieu. Souvent ça frise le cynisme. C’est assez pervers par moments. C’est ludique, j’ essaie souvent de faire rire les gens. De les faire rire blanc, ou des les faire rire jaune. Bref, c’est toujours très irrévérencieux.
BD : Je ne suis pas quelqu’un de cynique, bien au contraire. Mais j’adore prendre des risques et être surprise. Quant au résultat, les photos de Guido sont toujours splendides dans l’irrévérence.
Qui élabore les concepts des prises de vue ?
GM : En général, j’élabore les concepts dans mon coin en fonction du thème du magazine qui est défini en amont par Babeth. Puis je lui envoie les images, et elle m’appelle pour me dire : « It’s amazing ! ». C’est pour cette raison, d’ailleurs, que la relation est belle, parce qu’à chaque fois je me dis : « Osera-t-elle publier ça ? » Il y a toujours une part de doute. Babeth est tout de même la patronne d’un magazine qui a maintenant des éditions dans le monde entier. On n’est pas entrain de parler d’un fanzine bricolé dans une cave à Londres. Il s’agit d’un magazine grand public, connu et reconnu, alors que mon attitude, elle, n’est pas du tout commerciale. La seule fois où nous avons eu une discussion avec Babeth…
BD : …était au sujet des perles.
GM : Oui. C’était pour la cinquième édition de Numéro, au tout début du magazine. Au lieu de faire six colliers de perles, on a décidé de partir sur l’idée d’apprendre à compter avec Numéro. J’ ai donc photographié des perles disposées comme les perles en bois d’un boulier pour enfant. J’envoie les photos à Babeth, et elle me dit : « Guido, je ne peux pas publier ça, on ne voit pas les colliers ». Et moi de lui répondre : « Ecoute, Babeth, on ne va pas commencer comme ça. Je n’ai ni Dieu, ni maitre, je veux un terrain d’expression libre en rédactionnel et je tiens à garder ma liberté absolue ». Babeth me répond, « J’adore prendre des risques, mais là tu vas trop loin. C’est impossible, Guido, les joailliers ont besoin de reconnaître leurs créations ».
BD : Guido m’a répondu « Je m’en fous. Les photos sont sublimes et ils vont adorer. » Il n’avait pas tort, au final les photos étaient divines, j’ai adhéré à son idée, et je ne l’ai pas regretté.
GM : Le coup de fil a duré 42 secondes, et le problème était réglé pour dix sept ans.
BD : Dix sept ans d’une relation idyllique car nous nous comprenons totalement, sans même avoir à se parler. Les photos de Guido sont sublimes et intemporelles. C’est ni plus ni moins de l’art.
GM : Ce n’est pas de l’art dans la mesure où si vous me demandez spontanément ce que j’ai envie de photographier le matin quand je me réveille, ce n’est pas une montre Hermès. Le plus important, pour moi, dans mon approche, c’est de ne jamais faire deux fois la même chose. Si tu regardes les 100 séries – voire plus – que j’ai faites, il n’y a jamais deux fois la même idée. Parce que sinon je m’ ennuie. Et si je commence à m’ennuyer, ce n’est pas la peine, je suis sûr d’ ennuyer le specteteur… Il faut qu’on continue à s’amuser, à provoquer, à faire réfléchir avec le regard critique et amusé que nous portons sur la vanité de notre milieu. L’idée, ce n’est pas de faire le 100e Vogue. Parce qu’il y en a déjà trop, ils se ressemblent tous, et à la fin tu ne sais même plus ce que tu regardes. Ce qui est important, c’est de développer un discours qui soit transgressif. Ce qui est assez périlleux en soi, parce qu’à chaque fois je risque de scier la branche sur laquelle je suis assis.
BD : C’est toujours sur le fil du rasoir. Derrière chaque image il y a plusieurs degrés de lecture, et c’est justement toutes ces strates qui sont intéressantes dans ton travail.
GM : Si j’avais une quelconque retenue de peur de perdre mes clients, je ne ferais pas ça. Le problème, c’est que je m’en fiche. C’est là où le serpent se mord la queue : à la fin, nombre d’entre eux sont contents de faire partie de nos séries. Je me souviens, par exemple, avoir photographié de la haute joaillerie dans des sacs d’aspirateur éventrés, comme si la femme de ménage avait aspiré les boucles d’oreilles et les bagues de madame. C’était très irrévérencieux. Par contre, graphiquement, je m’efforce toujours de rendre les choses esthétiques et élégantes. L’ironie, c’est que les marques qui ne figuraient pas dans la série ont appelé le magazine pour se plaindre de ne pas en faire partie. Ce qui est assez génial et habile. On a crée un langage et une interprétation qui sont propres à Numéro. Et désormais toutes les marques se prêtent au jeu.
Pourquoi n’avez-vous jamais réalisé de photos incarnées au cours de votre collaboration avec Numéro ?
GM : J’ai essayé, je fais de temps en temps des portraits, mais c’est un autre métier.
BD : Guido est le roi de la nature morte. Le digne héritier d’Irving Penn. Très sincèrement, il est vraiment unique.
GM : Pour Numéro, je ne fais pas uniquement des photos, je développe surtout des concepts. C’est un laboratoire d’idées. Je ne suis pas entrain de faire des jolies photos de sacs à main, ça, je le laisse aux autres. Tout le monde peut faire de jolies photos. Ce qui est important, c’est de trouver à chaque fois une interprétation, une lecture différente du même sujet. La photo, c’est juste la matérialisation du concept. D’abord je trouve l’idée, puis ensuite la photo vient toute seule.
D’où vous viennent les concepts pour vos séries ?
GM : J’adore m’amuser en poussant le bouchon un peu plus loin chaque fois. Une énième série de parfums ? Qu’est ce qu’on va faire ? Et bien, on va fracasser tous les flacons. Et à la fin, c’est d’une élégance à couper le souffle. Babeth parlait à l’instant du fil du rasoir… le tout, c’est de ne pas tomber du mauvais côté, dans la vulgarité et l’obscénité. Je pourrais très bien me dire aujourd’hui : « Qu’est ce que je vais faire? j’ai encore une série de montres… je n’ ai qu’à les mettre dans des merdes de chien ». Sauf que là, ça ne fait plus rire personne. C’est toujours fait avec intelligence, esthétisme et retenue.
A-t-on le droit de parler de Thomas Lenthal [ancien creative director de Numéro]?
GM : Bien sûr qu’on a le droit de parler de Thomas Lenthal. D’ailleurs, il faut parler de lui. Toute la genèse de l’approche photographique, conceptuelle et stylistique de mon travail pour Numéro s’est faite en très étroite collaboration avec Thomas. On se renvoyait des idées. Le travail a sans doute évolué depuis son départ il y a dix ans, en devenant de plus en plus recherché, créatif et givré. La série de la Reine d’Angleterre, par exemple…
BD : C’est une de mes séries préférées : Elizabeth II avec les parures des joailliers en guise de couronnes. Tellement d’humour, c’était complètement dingue. En voyant la série, Eric Troncy (co-directeur du centre d’art Le Consortium à Dijon) m’a d’ailleurs appelé pour nous féliciter et me dire qu’il n’avait jamais rien vu de tel dans aucun autre magazine. Et qu’il fallait être gonflé pour publier ça.
Guido, quelle est pour vous la plus grande qualité de Babeth ?
GM : La fidélité et le respect.
Babeth, quelle est pour vous la plus grande qualité de Guido ?
BD : La loyauté, l’amitié et un immense talent.
Guido, que détestez vous le plus chez Babeth ?
GM : Ce n’est pas parce que je n’ai pas envie de répondre, mais il n y a rien qui me vienne à l’esprit.
Et vous, Babeth ?
BD : Rien, j’adore notre complicité.
GM : Quel monde idyllique ! Car depuis dix sept ans que je bosse pour ton magazine, tu ne m’as jamais rien censuré, tu adores ce que je fais, et ça ne va pas s’arrêter là… Ce genre de complicité n’existe plus de nos jours. On est dans un anachronisme absolu. Je ne pense pas qu’on puisse de nos jours – à part chez Numéro – développer une relation de très long terme comme il a pu en exister à la grande époque de la presse féminine, comme celle qui liait Irving Penn au Vogue US pendant trente ans. Il y a fait des chef-d’œuvres absolus, mais c’était il y a longtemps. On n’est plus dans cette même configuration de loyauté, de fidélité…
BD : Guido et moi, c’est avant tout une longue histoire d’amour. Je suis une vraie amoureuse des gens et de la vie. Ce qui me touche le plus chez toi, Guido, c’est ton irrévérence, ton recul, ta capacité à toujours te remettre en question et à te surpasser.
GM : Je ne veux pas me répéter, mais les relations de plus de quinze ans n’existent plus aujourd’hui dans la presse. Les choses bougent trop vite, les gens sont toujours à la recherche de nouveauté. La fidélité, l’intégrité sont des valeurs qui se perdent. Surtout dans – j’allais dire – « ton » milieu. Parce que ce n’est pas le mien.
Dans la mode, un résultat trimestriel à moins 10 % de ventes dans un gros conglomérat du luxe X ou Y – il y en a quatre ou cinq dans le monde – et ils changent de créateur. Il n y a plus de morale, il n y a plus d’amis. Et au final, il n y a plus de talent. Car le talent finit par être dilué par l’argent. Aujourd’hui, il y a trop de contingences matérielles, même en rédactionnel. Il n y a plus d’espace de liberté, c’est fini. Tout est boulonné, tout est cloisonné. Je me souviens d’une série de mode que j’avais faite pour The Face avec un squelette comme mannequin. Un vrai squelette avec une perruque. Et ils l’ont publiée. Ca a déclenché une polémique terrible dans le courrier des lecteurs des grands quotidiens britanniques, qui y voyaient une critique des mannequins anorexiques, et un jeu avec la mort. Il n y a que toi, Babeth, qui prenne encore ce genre risques. J’ai encore la liberté avec Babeth que je pouvais avoir dans un magazine comme The Face il y a quinze ans.
BD : « Il n’est point de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage », disait Périclès. Mais cette liberté t’oblige à l’excellence.
GM : Babeth a confiance en moi, j’ai confiance en elle, et cette confiance, pour moi, ne connaît pas de limites. Et ça, c’est fondamental. D’ailleurs, si je ne travaille pour pratiquement aucun autre magazine, c’est parce que je suis constamment censuré. Il ne faut pas oublier qu’il y a plein de séries que j’ai faites pour Babeth qui m’avaient été refusées par d’autres. Le rédactionnel est devenu de la publicité déguisée. Alors, moi je veux bien faire de la publicité – d’ailleurs, j’en fais beaucoup – mais je veux être payé en conséquence. En faisant ce livre, je célèbre dix sept ans de collaboration avec Numéro. Ce support m’offre une vitrine, une visibilité, certes, mais je ne vais commencer à faire la pute juste pour être dans tel ou tel autre magazine. J’ai passé l’âge, excusez-moi.
BD : On n’a peur de rien car les photos sont magnifiques.
GM : C’est aussi parce qu’on n’a plus rien à prouver, Babeth.
BD : C’est faux. Il faut toujours continuer à chercher, toujours continuer à prouver. En ce qui me concerne, je suis toujours en quête de nouvelles aventures et de nouveaux défis.
Arrêtez, on dirait un vieux couple.
GM : Le soir on fait du tricot, avec notre plaid et le chat sur les genoux.
BD : Au secours.
Propos recueillis par Philip Utz
Philip Utz est rédacteur en chef de Numéro, magazine de mode international fondé par Babeth Djian et édité par Paul-Emmanuel Reiffers. Sa ligne éditoriale est enrichie par de grandes signatures internationales, et fait de Numéro un magazine culte de la mode, de l’art et du design. Le magazine est décliné en plusieurs éditions internationales.
Mocafico Numéro
Publié par Steidl
145€