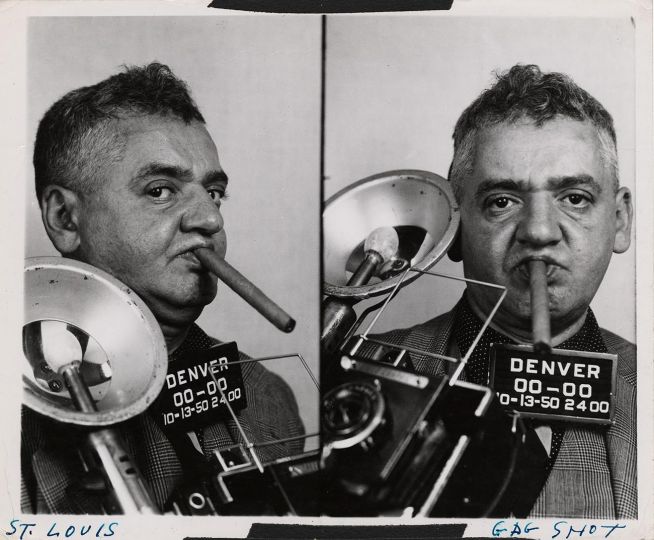Pour le Mois de la photo du Grand Paris, les Archives Nationales ont invité Mathieu Pernot à s’emparer du fonds de l’entreprise Lapie. Le fonds, acquis par les Archives en 1972, comprend entre autres des milliers de cartes postales de vues aériennes prises depuis les avions de l’entreprise dans toute la France métropolitaine pendant les années 1950 et 60. Le résultat de l’intervention de Mathieu Pernot est une double installation, visible jusqu’en septembre, sur les deux sites des Archives Nationales, à Pierrefitte-sur-Seine et à Paris. À Pierrefitte, il a créé Dorica Castra, une grande carte imaginaire en associant les paysages des cartes postales par analogie visuelle, comme un domino géant qui passe de montagne en vallée, de ponts en routes, de châteaux en rivières… À Paris, il en a choisies deux, des plages peuplées, qu’il a agrandies et disposées entre les somptueuses arcades de la cour de l’hôtel de Soubise.
Dans un entretien que l’on peut lire sur le site des Archives Nationales, Mathieu Pernot définit ainsi son travail : « Je suis photographe et je prends des images. Celles-ci peuvent provenir de mon expérience du monde réel tout comme de photographies déjà existantes dont je me saisis pour en proposer une nouvelle lecture. Photographier est un acte de re-présentation d’un réel déjà existant. Dans le cas où je travaille sur des images trouvées, on pourrait dire que je présente une nouvelle fois ces re-présentations. » Pour L’Œil de la Photographie, il revient sur cette expérience avec le fonds Lapie, sur son travail en général et ses projets.
Comment avez-vous travaillé ?
Quand les Archives Nationales m’ont contacté, je leur ai proposé un puzzle, comme un jeu d’enfant. Je ne voulais pas reproduire ce que j’avais fait pour Les Grands ensembles, ou Les Témoins (deux précédentes séries sur les barres de banlieue), cela m’intéressait de travailler sur l’idée d’une carte, d’un assemblage, de faire un projet un peu monumental. La carte postale est un objet assez frais, affectif, pour ma génération en tous cas. J’ai proposé l’idée sans avoir essayé. J’ai commencé avec les montagnes, ce qui était le plus facile, et j’ai vu qu’on pouvait le faire. Une étudiante en histoire de l’art m’a aidé. Pendant deux mois, trois jours par semaine, elle est allée dans les magasins choisir des cartes postales. Je lui avais donné des noms : montagne, littoral, fleuve, route, pont, des choses très identifiables que je pouvais monter en série. Elle a sorti huit cent cartes postales et j’en ai assemblées quatre cent dans une salle que les Archives m’avaient laissée pour que je puisse bâtir mon puzzle au sol. C’était assez jubilatoire. Le résultat ne ressemble pas à la carte de France. Je ne voulais pas reconstituer le territoire, je voulais en créer un. Sauf que c’est quand même un vrai portrait de la France. Tous les lieux sont documentés.
C’est une carte imaginaire, mais qui a un point de vue historique. Je voulais aussi qu’il y ait quelque chose qui circule : un livre objet que je fais avec les éditions Filigranes. C’est un livre jeu qui garde l’esprit de l’installation, sous forme de pochette dans laquelle il y a des affiches que l’on déplie et qui la reconstituent. Il y a un mode d’emploi avec toutes les règles du jeu. J’y explique le thème Dorica Castra (l’expression Dorica Castra provient d’un vers de Virgile, Énéide, chant 2, et signifie « les camps grecs ». Elle désigne également un principe d’association de syllabes dans la littérature enfantine : la dernière syllabe d’un mot devient la première du mot suivant), ce que j’ai appliqué à la photographie, les continuités visuelles. Le texte explique aussi comment on construit une œuvre et décrit le fonds Lapie. On essaie de le sortir pour les Rencontres d’Arles.
Et à Paris ?
À Paris c’est le Straca Carido, puisque c’est le principe inversé : ce ne sont pas plein de cartes postales, mais deux, montrées de chaque côté de la cour. Au début, il n’était pas question qu’il y ait quelque chose à l’hôtel de Soubise. J’ai insisté pour qu’on mette des images, des visuels forts qui fonctionnent dans ce lieu magnifique. J’ai proposé de faire exactement le contraire de Pierrefitte : une seule carte postale découpée, et installée entre les colonnes, comme un travelling. Une de chaque côté de la cour. Ce qui me plaisait, c’est que comme l’avion qui prenait les photos de ces plages passait assez bas, les gens le saluent : c’est accueillant, les gens sont contents, ils ont les pieds dans l’eau… C’est très rafraichissant. Et en plus la couleur du sable rappelle celle de la pierre du bâtiment.
C’est un travail qui tient plus de l’installation, alors artiste ou photographe ?
On me dit parfois que je suis artiste plus que photographe. Je pense que cela n’a pas d’importance. J’ai toujours dit que ce qui m’intéresse ce n’est pas de savoir à quel moment une photo était de l’art ou n’en était plus mais d’essayer de produire des pièces qui abolissent les frontières. Je suis toujours heureux quand je vois que mon travail sert à des historiens, à des sociologues ou des ethnographes, d’être invité dans un musée d’histoire pour montrer mes photos. Par exemple dernièrement, j’ai participé à une web radio avec des collégiens ; j’ai été invité à présenter mon travail sur les migrants à une association de lutte contre le racisme et les discriminations ; et celui sur les gitans à un groupement de financiers. À Pierrefitte, à l’occasion de cette exposition il y a eu un colloque qui réunissait des historiens, des chercheurs et des archivistes. Je parle de la même façon à tous ces interlocuteurs.
J’aime l’idée qu’un travail ait un discours propre, qui ne s’adresse pas à une catégorie particulière, l’art contemporain ou la photographie par exemple, qu’il produise des savoirs, des réactions. Je sais que la série Les Grands ensembles est montrée aux étudiants dans les écoles d’architecture, sur la question de la représentation. Peut-être que c’est la particularité de mon travail : je produis des objets très précis qui vont éventuellement raconter beaucoup de choses. Il me semble qu’il ne faut pas hésiter quand on a une expérience, une histoire dont on peut se saisir parce qu’on la comprend, parce qu’elle est liée à quelque chose qu’on connaît, surtout à l’heure de la mondialisation où tout le monde fait la même chose. J’aime bien quand une œuvre est un peu monstrueuse iconographiquement, qu’elle n’est pas toute propre. Michel Foucault est un bon exemple, il se saisit de sujets différents, l’enfermement, la sexualité ou la folie, et on ne sait plus s’il s’agit de philosophie ou d’histoire, c’est un monstre de la pensée et c’est très beau. Dans mon travail, cela peut partir dans tous les sens mais à la fin il y a une forme d’unité, une discussion, des rhizomes. C’est important pour moi qu’il y ait une vraie complexité, et que cela soit accessible. Je pense qu’une œuvre doit parler tout de suite et à tout le monde.
J’aime aussi les travaux qui s’inscrivent dans le temps. J’ai une assiduité, une fidélité. Il y a quelque chose de beau dans cette durée-là, liée au projet, aux rencontres : ce travail du temps et de la forme qu’il produit sur les gens… Comme avec les Gorgan, par exemple, cette famille de gitans que je suis depuis vingt ans : l’expérience que j’ai avec eux, le travail qu’on fait ensemble, personne d’autre ne pourra le refaire.
Ils sont le sujet de votre prochaine exposition…
Je prépare une grande exposition aux Rencontres d’Arles cet été, sur les Gorgan. J’ai fait ma toute première exposition en 1997 aux Rencontres d’Arles, elle s’appelait Tziganes. Vingt ans après, ce sera juste cette famille. Ce ne sont plus des gens désignés par leur appartenance à une communauté, ce sont les parents et leurs huit enfants. J’en fais dix constellations d’images, une par personne. J’ai récupéré leurs images d’archives d’avant que je ne les connaisse, et des photos qu’ils ont faites eux pendant les dix ans où je n’étais pas avec eux. Je montre mes premières photos en noir et blanc de 1995-97, mes photos en couleurs, les photomatons où il y a certains de ces enfants, trois des Hurleurs qui étaient ces enfants plus grands, la caravane en feu. L’ensemble constitue un récit : ce sont des panneaux biographiques avec la vie qui change, des morts, des naissances, des histoires différentes. En croisant les récits et en les regroupant individuellement, j’essaie de déconstruire le point de vue, de dire qu’il n’y a pas qu’une façon de les montrer. On retrouve des éléments de mon corpus démontés et remontés autrement. C’est vraiment une exposition importante pour moi parce que toute l’histoire a eu lieu à Arles : j’y ai fait mes études, ma première exposition, et eux habitent à Arles. Travailler vingt ans avec cette famille, tenir, avoir leur confiance, c’est fort. Pour moi c’est l’histoire de ces gens, mais aussi une histoire de la photographie, parce qu’il y a à la fois de la photographie documentaire classique en noir et blanc, des photomatons, des polaroids, de la photographie vernaculaire qui est leur pratique à eux, des photographies mises en scène… Je travaille sur un gros livre avec Xavier Barral pour l’occasion.
Et ensuite ?
L’année dernière, j’ai exposé au Mémorial de Rivesaltes, dans les nouveaux bâtiments de Rudy Ricciotti, ça a vraiment été une belle expérience. J’y ai projeté mon travail sur les migrants, ce qui était une façon de le montrer autrement. Ils m’ont demandé si je pouvais continuer à travailler avec des migrants venant de Calais qui étaient accueillis dans un lieu de Perpignan. Ce que j’ai fait : j’ai un projet avec un Érythréen, un couple de Somaliens, un Pakistanais et un Soudanais, réfugiés là-bas. Dans mon exposition au Jeu de Paume, en 2014, j’avais montré, entre autres, Les cahiers afghans : des cahiers d’écoliers sur lesquels les réfugiés écrivaient leur histoire. Cette fois-ci, je me suis rendu compte que l’Érythréen écrivait en tigrigna, une écriture syllabique, que le Pakistanais écrivait en pachtoune, le Soudanais en arabe classique : j’ai réalisé que ces écritures sont très différentes, très belles et relèvent toutes de cultures très anciennes, et qu’elles nous ont toujours intéressées nous les occidentaux, et que nous avons collectionné des parchemins qui sont au Louvre. Je me suis dit qu’il fallait continuer, qu’il ne fallait plus faire l’histoire des migrants – des gens que l’on considère comme des parias, qui ne sont que des victimes – qu’il fallait faire l’histoire des civilisations dont ces gens sont issus.
Propos recueillis par Anne-Claire Meffre
En avion au-dessus de…
Dialogues entre Mathieu Pernot et le fonds Lapie
Jusqu’au 19 septembre 2017
Archives Nationales
60, rue des Francs-Bourgeois
75003 Paris
et
59, rue Guynemer
93383 Pierrefitte-sur-Seine