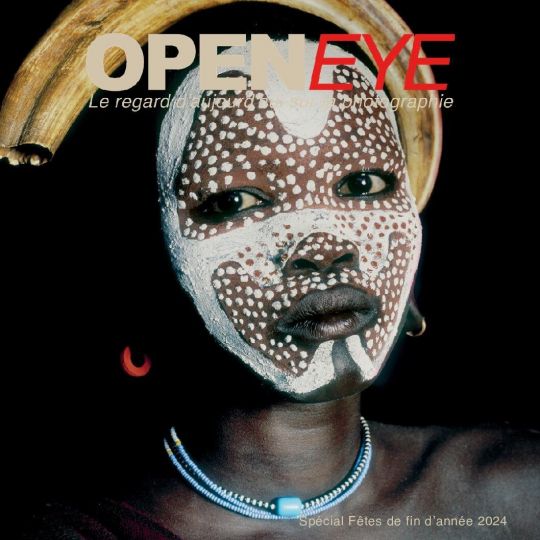J’aime voir la photographie résister : aux emportements technologiques, aux effets de mode, aux démons de l’oubli ou, plus égoïstement, à l’idée que je me fais de l’Amérique, du moins celle que la photographie m’en a transmise. Et, sur ces trois points, Marion Dubier-Clark m’offre généreusement une série de réponses conséquentes, je dirai même : rassurantes.
Son travail assure une première fidélité à un procédé photographique dont la disparition programmée vient, au final, d’être suspendue : celle du film Polaroid, qu’elle emploie avec constance et talent pour nous parler, justement, de l’Amérique. Ces petites images carrées, obtenues dans l’immédiateté de la prise de vue, dont l’obtention, quasi synchrone avec celle-ci, bluffait littéralement le public –et les artistes- , ils sont suffisamment nombreux, encore, à les aimer, pour que leur vie ait été rallongée. Dans les années 60 et 70, cette immédiateté-là changeait tout, comblait les impatiences inhérentes au medium photographique, délivrant l’image enregistrée d’un inévitable décalage entre prise de vue et développement.
Dans un marché photographique dominé, depuis une vingtaine d’années, par la soumission aux tirages en grand format, dont la précision quasi chirurgicale s’alimente aux adjuvants informatiques, ces petits bouts de papier colorés, au chromatisme acidulé, et parfois approximatif, ces fragments de réel qu’on entasse, une fois réunis, dans de petites boîtes en carton, voici qu’ils font tache dans le paysage de la production contemporaine. Et, par–dessus le marché (si l’on peut parler ainsi), ces petites images sont uniques ; un seul exemplaire d’entre elles assure leur pérennité, sauf à les multiplier au moment de la prise de vue.
Comme si la fragilité de l’unique redonnait à la photographie la magie qui était la sienne dans les années qui ont suivi son invention… Leur réalité matérielle (véritable patrimoine fragile que l’on se soucie, de plus en plus, de conserver) rend ces images encore plus touchantes. Qu’une photographe contemporaine comme Marion Dubier-Clark s’empare de cette fragilité pour accomplir son oeuvre, alors qu’elle pourrait assurer à ses prises de vue, grâce aux technologies existantes, une longévité et une distribution bien plus pérennes, paraît s’affirmer comme un paradoxe volontaire, un geste esthétique mûrement réfléchi. Enfin, Marion Dubier-Clark revivifie une esthétique dont, à une ou deux grandes exceptions près (je pense aux autoportraits du suisse Urs Lüthi), les grandes heures sont liées aux artistes et au territoire américain.
Et, en particulier, à la dernière grande série créative expérimentée au début des années 1970 par Walker Evans. Ses images, prises avec un Polaroid SX70, témoignent non seulement de son goût pour la couleur, enfin libérée des poncifs réalistes, mais surtout d’une liberté nouvelle qu’Evans prend devant la grande scène vernaculaire offerte à l’observateur par l’Amérique. C’est dans ce prolongement-là que Marion Dubier-Clark inscrit son travail actuel. Avec suffisamment d’intelligence pour signaler, et saluer, ses références. Mais également en s’inscrivant dans une scrutation ambitieuse des villes américaines traversées par les signes, les lettres, les clichés accumulés par la modernité urbaine, constamment changeante, quotidiennement renouvelée.
Les Polaroids de Marion Dubier-Clark retrouvent la liberté, la jubilation des grands déchiffreurs photographiques, devant l’infini chant / champ vernaculaire américain, l’acidité agaçante de ses couleurs, l’incroyable poésie lettriste de ses affiches et de ses murs. On croyait ces vertus-là usées jusqu’à la corde par la photographie coloriste américaine. Voici, belle nouvelle, que Marion Dubier-Clark nous prouve le contraire.
Gilles Mora
Polaroids from New York to New Orleans
Auto-publié par Marion Dubier-Clark