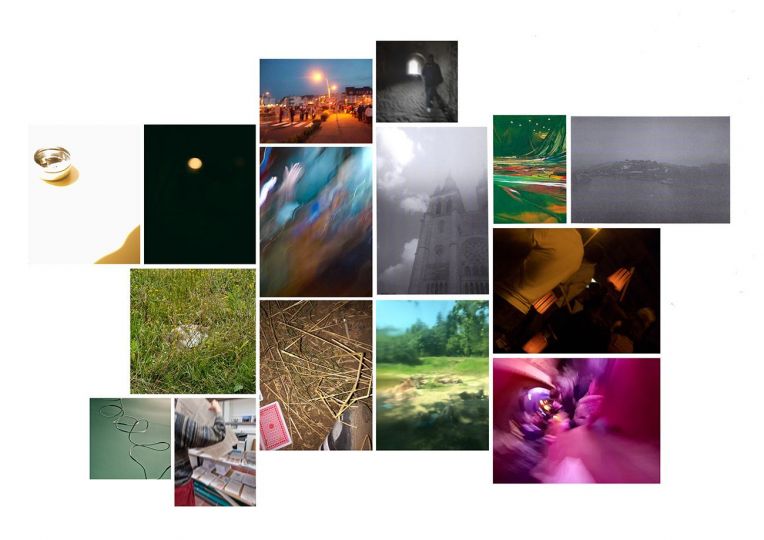Presque trente ans avant que le Président Obama n’échange une poignée de main avec Raul Castro au cœur de l’ancienne Havane, Manuello Paganelli est parti en voyage à Cuba avec ses appareils pour retrouver puis photographier des membres de sa famille, dont personne n’avait plus de nouvelles depuis 1953. Au fil du temps, il est retourné dans cette nation insulaire pas moins de soixante fois, pour y prendre environ 100 000 photos, d’après ses estimations. Il a récemment publié Cuba : Un voyage intime, album radical et pénétrant qui réunit ses meilleures images.
Mi-cubain, mi-italien, Paganelli voit au-delà des images désormais clichées de voitures anciennes et de femmes roulant des cigares, plus loin que l’iconographie du Che, des peintures écaillées et autres représentations “faciles” de Cuba. Son livre rappelle l’essai photographique classique d’Eugene Smith Spanish Village, paru en 1951 : la vie des rues, les regards méfiants, les ânes, les ombres longues et poétiques. Paganelli s’est entretenu avec L’Œil pour raconter ses premiers voyages à Cuba et les histoires qui se cachent derrière quelques-unes de ses photos.
Ce qui surprend le plus dans votre ouvrage, c’est le fait qu’il soit entièrement en noir et blanc. Nous sommes tellement habitués à voir la Havane en vert et bleu pastels. Qu’y avait-il derrière votre décision ?
Lors de mon premier voyage à Cuba, j’ai emporté dans mes bagages 200 pellicules – 125 en noir et blanc, 75 en couleurs. Dès que j’ai atterri, j’ai su comment je prendrais mes photos. Cuba m’est apparu comme un film noir, un film avec Humphrey Bogart. Je voyais tout en noir et blanc.
Pourquoi ?
C’était comme si j’avais remonté le temps jusqu’à avant ma naissance. Tout s’était arrêté en 1959. Les rues, les voitures, les boutiques, et même les maisons, dont la plupart n’avaient pas le téléphone et où les téléviseurs étaient en noir et blanc. C’était en 1989, mais tous les annuaires dataient de 1959. Tout était périmé, ou ressemblait à des archives. La couleur ne me semblait pas adéquate.
Pourquoi êtes vous parti à l’origine ?
Pendant mon enfance, on ne parlait pas beaucoup de la famille qui vivait à Cuba. Mais à la fin des années 1980, j’ai commencé à devenir curieux. Ou, plutôt que curieux, passionné à l’idée d’en apprendre plus sur eux, de les retrouver, et si possible, de les aider. La dernière fois qu’on avait entendu parler d’eux, c’était dans une lettre qui datait de 1953. Il y avait le nom d’une ville et quelques indices. Elle datait de trente-cinq ans, mais il fallait que j’essaie.
A quoi a ressemblé votre premier voyage ?
Je n’avais aucune idée de ce que j’allais trouver, parce que je ne connaissais personne qui y soit allé. Les gens l’oublient, mais c’était un territoire interdit à l’époque. Il y avait des Espagnols et des Sud-Américains, mais personne ne se promenait pour prendre des photos. J’étais presque toujours le premier touriste et définitivement le premier Américain qu’ils voyaient. Les autochtones me considéraient comme quelqu’un d’étrange.
Étaient-ils réceptifs à l’idée de se faire prendre en photo ?
Je suis parti là-bas en tant que touriste, et non en tant que journaliste, pour que mon accès ne soit pas contrôlé. Mais les Cubains restaient hésitants, sur leurs gardes, et je ne voulais pas qu’ils aient des ennuis. Quand je les approchais, ils regardaient autour pour vérifier qu’il n’y avait pas de flics, de voisins, ou d’agents infiltrés, mais il n’y a jamais eu de problème. Ils voulaient en savoir plus sur les États-Unis, ce que nous faisions, ce que nous pensions de Cuba. L’une des photos du livre, qui date de mon premier ou deuxième voyage, montre leurs sentiments mêlés : le type blanc est content d’être photographié mais le type avec le cigare est suspicieux. Il semble se dire : « Qui est ce type ? »
Vous promeniez-vous simplement dans les rues ? Aviez-vous une liste de ce que vous vouliez photographier ?
Je marchais, tout simplement. Je vois très vite les choses, et je capture ce que mes yeux me montrent. Je n’ai aucun sens de l’orientation – je me perds tout le temps – mais ça me permet de sortir des sentiers battus, de toujours découvrir des choses auxquelles je ne m’attends pas.
La photo du salon de coiffure est… envoûtante. Le séchoir à cheveux en métal brille mais les fauteuils sont en lambeaux.
C’était au début des années 1990. Quand je suis entré, la scène m’a immédiatement rappelé l’époque où j’étais enfant, quand ma mère et ma tante m’emmenaient au salon de beauté. Mais cette photo a été prise pendant la “Période Spéciale”, après le départ de Russes, quand le salon était vide. Personne ne pouvait s’offrir un tel luxe. Il n’y avait pas beaucoup d’argent à Cuba, les marchés et boutiques étaient vides. Avant le départ des Russes, les Cubains étaient plus à l’aise financièrement que la plupart des habitants d’Amérique centrale. Ils avaient un système de santé et d’éducation excellents. Les choses ont changé ensuite. Les Cubains ont fuit à Miami sur des bateaux de fortune, pas tant parce qu’ils ne supportaient pas le communisme, que parce qu’ils voulaient simplement une vie meilleure.
Vous avez fait un portrait de Gregorio Fuentes qui, selon vous, a inspiré Hemingway pour Le Vieil homme et la mer. Comment l’avez-vous découvert ?
Le serveur d’un restaurant m’a raconté que son oncle cuisinait parfois pour Hemingway, et il a évoqué Gregorio. Un ami m’a donc conduit jusqu’à Cojimar, le petit village de pêcheurs où on m’avait dit qu’il vivait. Agé de 95 ans à l’époque, il était très fragile, mais nous avons parlé pendant des heures. Il m’a dit qu’il avait rencontré Hemingway pour la première fois dans les années 1930 et nous a montré les lettres qu’Hemingway lui avait envoyées. J’étais très ému au moment de prendre la photo. J’ai pris deux pellicules mais n’en sont ressortis que quelques clichés, car j’avais des larmes plein les yeux.
Certaines photos du livre me font penser aux œuvres des grands photographes de Life – comme celles de Gordon Park dans les favelas de Rio, ou d’Eugene Smith pour Spanish Village. Qui sont les photographes qui vous ont influencés ?
En réalité, je suis autodidacte. Je projetais de faire des études de médecine, et la photographie est venue moi après l’université. J’ai lu un texte sur Ansel Adams. J’étais enthousiasmé par son œuvre mais je ne savais pas qui il était. J’ai obtenu son numéro par les renseignements, et je l’ai appelé. Nous avons été amis durant les deux dernières années de sa vie. C’est définitivement lui qui m’a le plus influencé.
Beaucoup d’ouvrages sur Cuba montrent des images classiques de Fords et de vieilles dames en train de fumer le cigare. Au contraire, vous nous faites entrer dans un enterrement, ou dans le lit d’une mère en train d’allaiter son enfant – des moments d’une grande intimité.
J’ai d’abord fait de la photo documentaire : il est donc important pour moi de saisir des moments d’authenticité dans la vie de tous les jours.
Au cours des 60 voyages que vous avez faits à Cuba, combien de photos avez-vous pris ?
Oh, mon Dieu. J’ai des classeurs entiers remplis de négatifs. Je dirais 100 000.
Comment êtes-vous passés de 100 000 à 115 pour ce livre ?
J’ai demandé de l’aide à Jim Colton, ancien directeur de la photographie de Newsweek qui a aussi été éditeur photo pour Sports Illustrated. Je l’ai rencontré à la fin des années 1980 et je n’aurais pas pu faire ce livre sans lui. En fait, c’est lui qui a choisi la photo de couverture.
Cette photo montre deux jeunes enfants se tenant dans les bras sur un petit ponton, tandis que les nuages s’amassent au loin.
La seule raison pour laquelle je suis allé à Cuba, c’était retrouver ma famille, ce que j’ai réussi lors de mon troisième ou quatrième voyage. Cette photo montre ma famille, mon sang. Ma nièce, qui a presque trente ans maintenant, protège son frère. J’aime cette image pour son symbolisme : on y voit une croix, et la fille regarde sur le côté, comme Marie, protégeant les habitants de Cuba. Je les ai vus sur le ponton avec leurs plus beaux vêtements, et je savais qu’une tempête s’annonçait. J’ai donc couru chercher mon Hasselblad. J’ai mis la pellicule pendant que je revenais vers le ponton. J’ai prix cinq ou six clichés sans trépied, et la pluie s’est mis à tomber en trombes.
Êtes-vous toujours en contact avec votre famille à Cuba ?
Bien sûr ! En fait, j’organise des voyages photos à Cuba et l’un de mes neveux, qui avait peut-être deux ou trois ans la première fois que je l’ai rencontré, est désormais mon bras droit sur le terrain.
Y’a t-il une image qui à elle seule représente le message global de votre ouvrage ?
Oui, la dernière du livre, un plan resserré sur des mains noires tenant une colombe blanche. Elle a été prise très tôt, lors de mon premier ou deuxième voyage. Je me souviens qu’il avait plu toute la nuit, une pluie terrible. On ne pouvait pas conduire à cause des routes qui n’étaient pas éclairées. Il y avait des puits gros comme des voitures. Nous avons donc passé la nuit dans une petite ville, La Florida. Au matin, je me suis réveillé au lever du soleil pour aller me promener au hasard. J’ai vu au loin deux Cubains noirs qui marchaient vers moi. L’un d’entre eux était torse nu. Je distinguais une tache d’un blanc éclatant qui a captivé mon regard. Il avait une colombe dans les mains.
Un de ces moments…
… Oui. Tellement de choses me sont venues à l’esprit. Je pensais au dessin de Picasso qui représente des mains et une colombe, et à ce que cet oiseau symbolise. Je me souviens m’être dit : « Qui décide de ce qu’est la liberté ? » Les gens à Cuba se voyaient comme libres mais ceux de Miami considéraient les choses autrement. Et puis, il y a un autre niveau de lecture : j’ai commencé à discuter avec cet homme qui m’a dit qu’il ne savait pas s’il allait la garder ou la manger. Une fois de plus, c’était la Période Spéciale, la nourriture se faisait rare. Vous savez, Picasso n’a jamais eu à se soucier de son prochain repas. Cette photo – et ce livre – essaient donc pour moi de montrer un aspect de Cuba que très peu de gens ont eu l’opportunité de voir, de révéler les idées fausses comme les vérités.
Propos recueillis par Bill Shapiro
Bill Shapiro est l’ancien rédacteur en chef du magazine Life ; @billshapiro sur Instagram
Manuello Paganelli dirige des ateliers photos à Cuba ; informations disponibles sur son site web. Plus de photos sur sa page Facebook.
Manuello Paganelli, Cuba : Un voyage intime, 1989-2016.
Publié par Daylight Books
60 $.