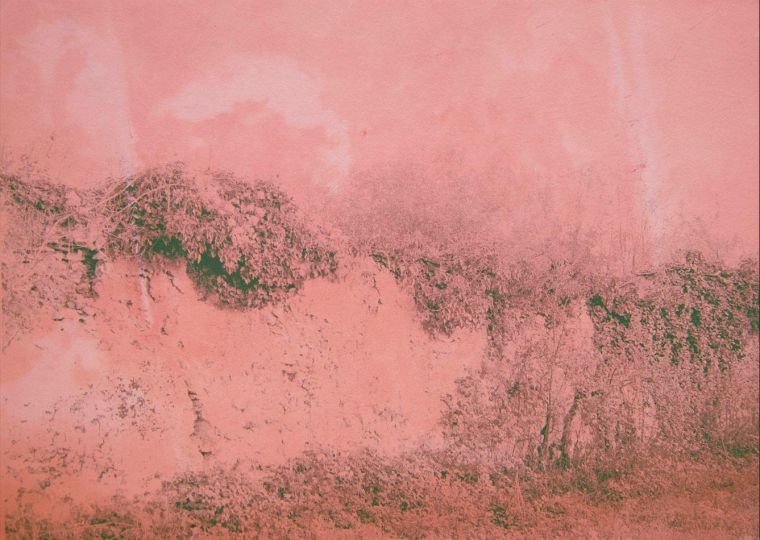On m’a diagnostiqué un cancer à la fin de l’année 2015. Je n’avais jamais compris avant cela que sept mots pouvaient tout changer. « Je suis désolé, Judith », m’a dit mon médecin, « c’est un cancer. » C’est un cliché de dire qu’on mesure le prix de la vie une fois que la mort nous rattrape, mais cela s’est avéré tout à fait vrai pour moi. Je me souviens avoir roulé sur Clyde Mountain pour rapporter le mot « cancer » à mes parents. Chaque arbre de l’allée semblait investi d’une force vitale. Les feuilles étaient vibrantes, irisées. Les eucalyptus gris dans les phares de ma voiture étaient comme la manifestation d’une intelligence antique, témoins de la courte existence des êtres humains. La menace de la mort nous rappelle que les gens sont précieux – nos plus vieux amis, nos enfants, nos amours, nos parents. Comment fera t-on pour supporter de les quitter ? Il est une vision du monde miraculeuse et singulière, qui ne naît qu’avec le diagnostique de maladie sérieuse.
L’intervalle entre le diagnostique et la chirurgie dure une éternité. Le chirurgien m’a montré un graphique : « Si le cancer rentre dans cette catégorie, vous vivrez ; dans celle-ci, vous mourrez. » Je me sentais comme le chat de Schrödinger, ni vivant ni mort. Les gens qui voient leur propre mort vivent dans deux mondes : l’un banal, l’autre miraculeux. Plus tard, lorsqu’on est venu à bout du cancer et que ma sentence a été levée, j’ai vu cet autre monde réduire jour après jour. J’avais beau m’accrocher à cette vision miraculeuse, elle s’effaçait, comme la certitude que j’allais mourir. Une chose persistait pourtant. Ma vision a changé : je sais qu’il existe un monde secret niché dans celui-ci. Je l’ai vu.
Des années auparavant, j’étais assise avec une amie qui était en train de mourir d’un cancer du foie. Pendant ses dernières semaines, Marilyn est devenu un être d’un autre ordre, extra lucide. Elle a vu le monde dans le monde, comme on raconte que les serpents voient les fantômes à travers leurs paupières transparentes. Et elle m’a dit : « N’attends pas – n’attends pas de mourir avant d’apprendre à voir. » Ses mots me sont revenus cette nuit là, sur les routes de montagne : « N’attends pas. » Étant une femme relativement mélodramatique – élevée au mysticisme chrétien et à la terreur de la mort – j’ai fait ce que la logique voulait : prendre un vol pour le désert. J’ignore ce que je m’attendais à y trouver. Peut-être Jean le Baptiste, perché sur un acacia avec des sauterelles, fuyant de Woomera à Coober Pedy… Mais l’envie de courir était irrépressible, donc j’ai couru.
A cette époque, j’avais déjà rendu plusieurs visites au peuple Warlpiri, à Lajamanu. L’artiste et l’ancien Wanta Jampijinpa est arrivé dans mon bureau de Canberra un jour de 2012, et il est resté trois ans. Il était venu avec l’ambition de faire connaître au peuple blanc (Kardiya) la culture Warlpiri, de faire naître chez eux le désir de « prendre soin de leur pays. » Mais beaucoup de gens l’ont considéré comme un gadget : un sujet anthropologique ou une curiosité de l’Histoire de l’Australie. Quel optimisme d’imaginer que la société blanche des villes, qui donne tant d’importance à la propriété et à la sécurité, pourrait se mettre au service des arbres… Mais Wanta voulait essayer. Lorsqu’il est retourné à Lajamanu en 2014, il avait l’impression d’avoir échoué à transmettre les valeurs Walpiri à qui que ce soit. Il avait tort. Quand mon monde s’est effondré, que tout s’est soudain mis à trembler, lorsque les arbres ont regardé, que les brins d’herbes sont devenus indiciblement précieux, que le désert m’a tendu ses bras brûlants, la seule destination à faire sens pour moi, c’était Lajamanu.
Les plus anciennes photos de ce livre ont été prises en 2013, à l’époque où je pensais encore que les Walpiri avaient besoin de mon aide pour promouvoir l’alphabétisation et les règles sanitaires, exprimer des façons positives d’aller vers une réconciliation, etc. Les dernières photos ont été prises en décembre 2015, lorsque je savais, sans l’ombre d’un doute, que j’étais une femme en train de se noyer et que les Walpiri étaient mon canot de sauvetage. Les anciens de Lajamanu, notamment Wanta Jampijinpa, Henry Jackamarra, et Jerry Jangala, ont été adorables avec moi. Ils m’ont donné un nom d’adoption et m’ont montré comment devenir une « policière » pour Jdbrille Waterhole. Ils semblaient sincèrement ravis de mon intérêt pour leur cosmologie, qu’ils ont illustrée avec des récits et des dessins, dont certains sont reproduits dans ce livre. La plus âgée des femmes m’a emmenée « chasser » des graines d’acacias et des pommes de terre. Ils m’ont raconté leurs alliances avec d’anciennes étoiles et montré le long de la Tanami Track les endroits où les lumières Min-Min avaient chassé les voyageurs. Les contes et les mystères prennent une importance nouvelle lorsqu’on sent sa vie en danger.
Lajamanu en 2016, c’est la rencontre de deux univers. Les anciens gèrent leurs statuts Facebook sur leurs iPhones, tout en parlant d’un ton neutre d’un paysage qui peut vous retenir ou vous tuer, selon votre odeur – là où vivent dans les cours d’eau les esprits des serpents, et où les morts marchent côte à côte avec les vivants. A Lajamanu, je me suis départie de ma peur de mourir, et plus important, de ma peur de vivre. Ce livre parle de magie. Pas la magie de la Kabbale, pas celle des théosophes, ni des prestidigitateurs, pas le « magick » de Crowley, avec un k, ni la magie New Age ou celle de la religion occidentale, mais celle qui décrit le monde caché dans notre monde, un monde que ne voient que les aborigènes les plus anciens, et les morts.
Ce livre n’est pas un livre de photojournalisme. Il n’essaie pas d’être objectif. Je voulais au contraire qu’il soit le plus subjectif possible. Ces photos, surtout les portraits, sont nées de l’amour que je porte à cette communauté, à la poésie de ces êtres souvent fragiles physiquement, mais auxquels la croyance inébranlable en la magie profonde du paysage confère une force que l’on voit rarement dans les villes. La culture Warlpiri est douce ; elle ne laisse aucune trace sur terre. L’histoire de l’Australie aborigène recoupe en grande partie celle de l’agriculture – « nettoyage » du pays avec des cultures de réapprovisionnement et cérémonies chantées pour rendre les arbres plus forts. Quand les Warlpiri se déplacent, ils se présentent au paysage. Ils s’excusent auprès de la campagne de casser les brindilles. Ils demandent aux cours d’eau la permission d’y puiser. Si l’humanité transcende un jour son égoïsme et sa nature meurtrière, ce sera grâce à des gens comme les Warlpiri.
C’est à Lajamanu que j’ai découvert la légende des serpents géants invisibles avec lesquels nous partageons le pays. Les contes des serpents-arc-en-ciel, qu’on appelle les Warnayarra, sous-tendent toutes les cultures aborigènes d’Australie. Ces extraterrestres primitifs ont jailli de météorites tombés sur des sites comme Wolfe Creek Crater. Ils vivent dans les cours d’eau, les rivières et les ruisseaux. Les arêtes et chaînes de montagnes sont les traces de leur passage. Dans la culture Warlpiri, les Warnayarra ont donné leur langue aux humains, et peuvent s’élever pour protéger leur pays en cas de grand besoin. On raconte que dans les années 1950, quand le Royaume Uni a lancé dix-huit bombes nucléaires et thermonucléaires sur Maralinga, en Australie du Sud, ce sont les serpents Warnayarra qui ont repoussé le nuage atomique jusqu’à la base militaire de Woomera, tuant tous les enfants de moins de cinq ans. La conscience du paysage est au cœur de ces Jukurrpa (légendes) sur les serpents Warnayarra. Mon voyage a débuté au centre du gouvernement anglophile d’Australie, Canberra, pour se terminer dans le Wolfe Creek Crater, lieu de naissance du serpent.
Puisque ce livre présente certaines visions et coutumes du peuple Warlpiri, j’ai ressenti le besoin de recevoir l’autorisation de leur doyen et homme de loi, Jerry Janagala, avant de le publier. En plusieurs endroits, au fil des pages, j’ai présenté des extraits d’un entretien enregistré avec lui le 27 juillet 2015 à 10h40. Je n’ai en aucun cas tenté de modifier son anglais très aborigène, mais j’ai traduit les termes Warlpiri qu’il a utilisés. Tout au long de l’entretien, Jerry se réfère à moi sous le nom de Nangala, mon prénom d’adoption Warlpiri. Un enregistrement et une transcription de l’intégralité de l’entretien sont disponibles pour ceux qui le souhaitent. Jerry était très enthousiaste à l’idée de ce livre. Il a suggéré que nous en fassions un autre dans le futur. Voici ses pensées sur la question : « On peut se contenter de parler juste comme ça, mais si tu fais un livre, c’est bien, je suis d’accord pour celui-ci. Mais ce livre il n’est pas pour que tout le monde… ne vienne voir que les Warlpiri ? Plus de yapa ? J’aimerais voir ça ! Rien que les Warlpiri ! »
C’est vrai – ce livre peut concerner la zone et son histoire, mais ce que je veux faire, c’est les Warlpiri de l’Ouest, du Sud, du Nord, de l’Est, et aussi Warnayaka Ngaliya, comme une façon d’apporter mon aide ici. Vous êtes d’accord avec celui-ci, oui… Mais je pense à autre chose, comme suivre la « piste de rêve », les légendes, le Corroboree, et toutes ces choses. Même le mariage, et la religion, qui font partie de ce livre-ci. Comme toutes les couches, oui, d’une certaine façon… parce que nous avons tissé des liens très forts, et que tout cela se mêle un peu dans ce livre.
Judith Crispin
Judith Crispin, The Lumen Seed
Publié par Daylights Books
45$