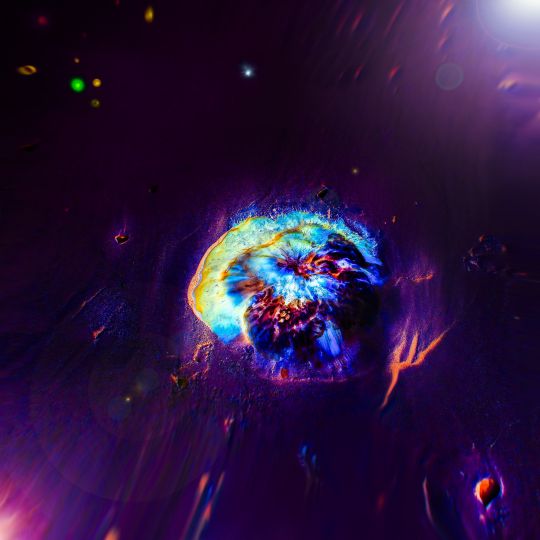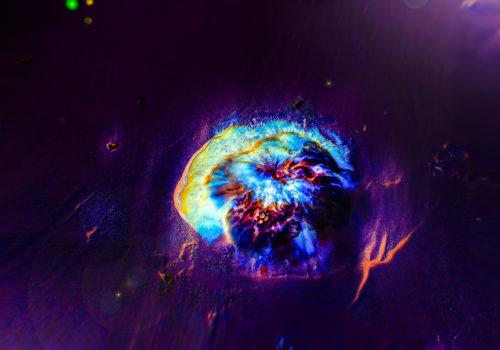L’Éthiopie est une véritable obsession pour Juan Manuel Castro Prieto qui y revient, à quatre reprises entre 2001 et 2006. Il y retrouve une mémoire ancestrale de l’humanité. Christian Caujolle a écrit la préface du catalogue :
La jeune femme est nue, couchée sur le dos, bras écartés sur le lit au drap imprimé de couleurs douces, entre brun et rouge. La couleur du drap dialogue avec le bleu vert tendre du mur et les motifs floraux s’accordent, entre terre et sang, entre pétale et latérite à la délicatesse dorée de la peau que caresse la lumière. Le corps abandonné de la jeune femme est légèrement flou, ce qui le rend encore plus doux, soyeux, à la fois léger et présent, et son regard fixe calmement l’objectif. Sur son ventre, parfaitement nettes, trois petites « poupées », faites de bois, de tissus et de plume sont pressées l’une contre l’autre. Un petit groupe aux yeux noirs, fixes, profonds sur le ventre de la femme-enfant. Souvenirs encore présents des jeux de la gamine ou objets rituels ? On ne sait trop. Mais, immédiatement, ces figurines m’ont fait penser aux poupées hopi des indiens d’Amérique du Nord, qui fascinèrent les surréalistes, tout particulièrement André Breton, et qui restent à la fois énigmatiques et envoûtantes, rustiques et sophistiquées, à la fois jouet et intermédiaire entre le monde des esprits et celui du quotidien terrestre.
Si j’ai, sans même réfléchir, pensé aux poupées hopi en découvrant cette photographie que Juan Manuel Castro Prieto a prise en Ethiopie, c’est qu’il m’a lui même guidé, alors que tout, à commencer par la distance et la culture sépare les deux lieux dont sont originaires les poupées évoquées, vers un territoire qui est le sien et, qui, finalement, n’est pas un lieu mais un état d’esprit. Ou, plus justement, un état du regard.
Un regard libre, qui sait passer avec fluidité et sans contrainte, avec une respiration élégante et évidente du noir et blanc à la couleur, du paysage au portrait, des paysages à l’architecture, pour un voyage irréel, étrange et poétique, enchanté au vrai sens du terme. Un voyage, ou plutôt un parcours, pour lequel les yeux semblent recueillir toutes les expériences des autres sens et nous entraîner dans cet univers des « étrangetés » qu’il a illustrées à d’autres reprises. Mais, aujourd’hui, ces bizarreries (qui sont celles de la perception) se sont concentrées en un seul lieu, un seul espace, une seule terre. Une terre d’élévation de la pensée, de l’esprit, des esprits. Une Ethiopie qui n’est ni celle de l’exotisme ni celle de la violence, une Ethiopie qui aurait conservé les raisons profondes qui firent venir là Rimbaud quand on parlait d’Abyssinie.
Le temps s’est suspendu, même si des détails nous disent aujourd’hui lorsque les néons nimbent de vert une façade devant laquelle se profile la silhouette imprécise et digne d’un personnage qui ignore le regard de deux garçonnets relégués dans un angle du cadre ou qu’une peinture envahit de ses couleurs gaies un mur aveugle. Le temps est étale quand des personnages passent, déjà effacés ou que des animaux à la fois fantomatiques et présents habitent seuls, des quartiers désertés. Dans une étendue surmontée par un ciel plombé deux personnes transportant des fagots deviennent végétales, comme des épineux qui marchent, elles finissent par devenir identiques aux tours en terre sèche entourées d’échafaudages piquants, sculptures fragiles, délicates et tout à la fois imposantes.
Dans ces espaces parfois difficiles à délimiter, évanescents souvent, des individus peuvent arpenter, comme s’ils marchaient sur des reflets, les nuances vertes jaunes et rouges du damier d’un carrelage. Puis, quand ils sortent à l’extérieur, ils peuvent devenir, en noir et blanc, dans une infinie variation de gris qui vibrent devenir d’incompréhensibles diables cornus dressés vers l’horizon. Murs de terre, parfois teintés de bleu sombre et soutachés de rouge. Le vent fait flotter un rideau jaune et la lumière laisse la pièce en suspension, en lévitation. C’est peut-être vers là que se dirige le chasseur à moitié nu, perché sur ses jambes sans fin et qui tient à la main l’oiseau mordoré qu’il rapporte.
Tout près, pourtant, c’est la ville, avec des immeubles en construction, un panneau publicitaire. Mais elle n’est pas crédible : elle est comme un décor. Chez le coiffeur, vêtu de rose fuschia, le client est emmailloté de vert acide et, dans la nature les hommes sont drapés de grandes étoffes dont les bleus, les verts et les violents aux tons sourds laissent deviner des corps sveltes, longilignes, dessinés. Il y a des portraits, des regards, des corps peints, des araignées qui semblent danser en se jetant des arbres comment le font les humains au bout d’une balancelle, des arbres, des feux, des objets, des dieux en bois yeux exorbités, des signes accumulés avec discrétion, du sang, des animaux, quelques oiseaux, des corps.
Le voyage pourrait être sans fin, tant il est irréel, sans limite, tellement pétri de cette poésie enracinée dans le réel que nous avons l’impression de reconnaître sans jamais avoir aucune certitude. On ne saurait parler ni de photographie de voyage, ni de journal de voyage, ni d’impressions, ni de description, ni de commentaire. De photographie certainement, dans la mesure où elle sait organiser cette tension permanente entre illusion et réel, fable et expérience.
Pourtant, de même que trois petites poupées posées sur le ventre de la jeune fille nous entraînent, pour peu que nous acceptions de les suivre, vers le monde des indiens hopi, c’est vers l’univers des voyelles porteuses chacune d’une couleur différente telles que les vit Rimbaud que nous guide ce bonheur sensuel :
A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu : voyelles,
Je dirai quelque jour vos naissances latentes :
A, noir corset velu des mouches éclatantes
Qui bombinent autour des puanteurs cruelles,
Golfes d’ombre ; E, candeurs des vapeurs et des tentes,
Lances des glaciers fiers, rois blancs, frissons d’ombelles ;
I, pourpres, sang craché, rire des lèvres belles
Dans la colère ou les ivresses pénitentes ;
U, cycles, vibrement divins des mers virides,
Paix des pâtis semés d’animaux, paix des rides
Que l’alchimie imprime aux grands fronts studieux ;
O, suprême Clairon plein des strideurs étranges,
Silences traversés des Mondes et des Anges :
– O l’Oméga, rayon violet de Ses Yeux !
Etiopía, Juan Manuel Castro Prieto
Jusqu’au 31 mars 2012