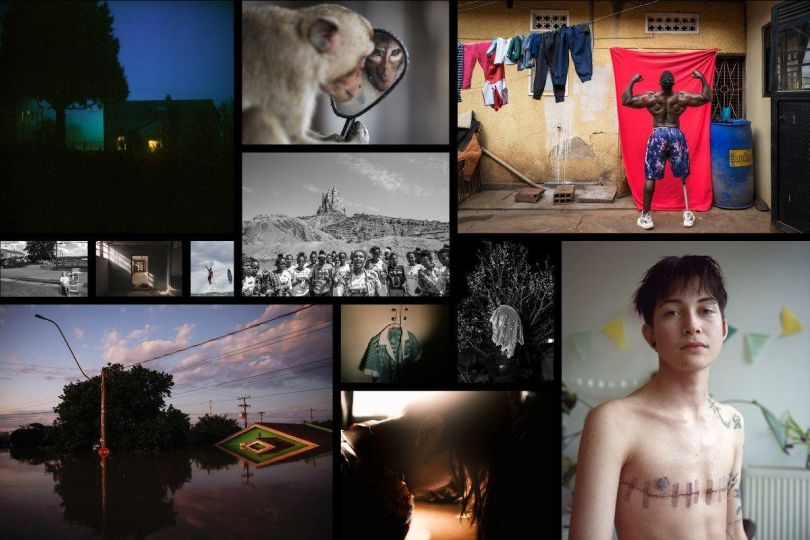Trente ans qu’il n’a pas exposé à Paris, le photographe ouvre les coulisses de sa série Exils. L’acclamation visuelle d’un homme « aux semelles de vent ».
C’est une photographie qui a failli n’être pas présentée au public – peut-être jamais. Elle doit sa présence à la persuasion victorieuse du commissaire de l’exposition, Clément Chéroux, qui a convaincu le photographe de l’ajouter à la sélection. On y voit une main – celle de Josef Koudelka – qui caresse de ses doigts les multiples jets d’eau d’un tuyau d’arrosage. L’image donne l’impression que la main distord la matière, qu’elle griffe la peau du monde pour y graver son empreinte. Et en même temps, nous savons que c’est de l’eau, que c’est un jet immédiat et que tout va disparaître après la photographie, tout va disparaître quand la main du photographe quittera le flot ou que sera fermée la vanne du tuyau d’arrosage.
C’est peut-être la meilleure image pour formuler le travail de Josef Koudelka : toute prise de l’homme n’est qu’éphémère. Si elle joue sur la matière, elle est aussi tentative impossible d’attraper le vide, le flou, l’insaisissable. Elle est tentative d’attraper la vie qui est aussi rapide et imprenable que ces jets d’eau qui s’échappent de tous les côtés de la main.
Main(s)
La main revient d’ailleurs plusieurs fois dans la série Exils. C’est notamment celle sur laquelle est accrochée au poignet une montre et qui constitue l’une de ses plus célèbres photographies. Elle ouvre l’exposition. La main tendue pour regarder l’heure et devant, l’immense place Vencelslas à Prague complètement vide. Nous sommes le 22 août 1968 et cette photographie témoigne d’une heure paradoxalement historique : les habitants de Prague devaient se retrouver ici pour une manifestation d’envergure afin de contester l’invasion russe, mais ce projet de manifestation était en fait un piège fomenté par des agents de Moscou et prévenus à temps, les Praguois ne viennent pas. Josef Koudelka enregistre cette absence, ce vide, et nous met sa montre sous les yeux pour nous prouver qu’il était là, lui, à cette heure précise du jour, guettant ce qu’il adviendrait : présence ou absence, piégés ou déjouant, histoire ou non-histoire.
Sans heure
Et justement, qu’il photographie cette heure – et qu’il accorde autant d’importance à ce cliché – révèle quelque chose à propos de lui-même. Koudelka se place en marge des apparentes grandes heures de l’Histoire, mais il est là quand personne ne vient. Au contraire des photojournalistes, il ne cherche pas à immortaliser des manifestations prévues, des démonstrations visibles par les témoins de la grande Histoire. S’il avait agi comme un photographe de presse classique, sans doute aurait-il tourné le dos à cet apparent “non- événement”, cette place vide où aucun manifestant n’est venu. Mais non. Koudelka y voit au contraire un événement passionnant. Une absence qui rend paradoxalement le peuple de Prague plus présent que jamais ; justement dans son refus, dans son intelligence d’avoir évité le piège, et le photographe, marginal, désormais dépositaire d’une heure qui compte dans l’histoire du pays et l’histoire du monde.
Gitans
Telle est la personnalité exceptionnelle de Josef Koudelka. Le photographe qui a rejoint assez tôt la prestigieuse agence de photographies Magnum s’est construit en marge – presque en opposition – au reste de la profession. Quand ses homologues répondent à des commandes, partent en reportage, lui refuse. Il ne photographie que pour lui, uniquement dans une quête personnelle, où il ne laisse aucune contrainte matérielle entraver sa démarche. Après avoir photographié les acteurs d’une troupe de théâtre quand il était encore en Tchécoslovaquie, Koudelka, en quittant son pays natal, va s’intéresser aux nomades. Il suit les Gitans à travers l’Europe. Il les observe dans leurs manifestations, leurs rituels. L’homme qui vient d’être déraciné, qui vient de se séparer de ses attaches les plus profondes, se passionne justement pour le peuple qui n’a pas de domicile fixe, qui se laisse conduire au vent « du jour au lendemain ».
Clochardisation
C’est aussi que ce peuple est séparé des autres. C’est le peuple de la marge, qui est tenu exclu de la communauté des sédentaires et qui doit vivre à ses frontières, dans l’amertume de cette séparation. Peut-être Koudelka se retrouve dans ces traits. Sans doute le photographe se reconnaît dans ce mode de vie qui n’accepte aucun port d’attache. Sa seule amarre, en fait, c’est la photographie. Pendant près de vingt ans, il va vivre sans domicile, sans adresse. Un sac de couchage en bandoulière, il dilue son existence dans l’acte même de saisir ce qui le saisit. Il vit en ascète. Il mange un peu de pain et bois un peu de lait. C’est tout. Il vit chez des amis et surtout, il dort en plein air, dans des champs, au bord des routes. Il vagabonde. Il « clochardise », refusant un confort qu’il estime une entrave à sa perception des êtres et des choses. Il est en exil pour toujours. Il le dit lui-même : « On ne revient jamais d’exil » (Josef Koudelka, La Fabrique d’Exils, Editions Xavier Barral, 2017).
Preuves
Ce mode de vie, qui a constitué la légende du photographe, est dévoilé par la preuve pour la première fois au public. Koudelka a accepté après une négociation de près de deux ans – selon l’aveu du commissaire de l’exposition Clément Chéroux – de montrer les coulisses de son travail. Ce sont principalement deux séries qui révèlent que ce mode de vie n’est pas un mythe. Sur l’une d’elle, il se prend en photo dans les lieux qu’il trouve pour dormir. Glissé dans son sac de couchage, sur un tapis de sol, il est tour à tour au beau milieu d’un désert, au pied d’une maison, sur un toit de New York, dans une ruelle abandonnée, sur le sol de l’appartement d’un ami, dans les locaux de son agence de photographie. Koudelka dort partout car il est l’amant du « nulle part », « le photographe aux semelles de vent », comme le dit joliment Clément Chéroux.
Matière à l’éternel
A ces preuves, s’ajoutent une série particulièrement émouvante. Neuf photographies des tapis de sol qui ont servi au photographe à passer la nuit. C’est un tissu posé sur de la moquette, un bout de carton sur l’herbe sèche d’un champ, un tapis ordinaire sur le plancher d’un appartement. Ce qui est frappant, c’est le vide suscité par la seule présence de cette couchette précaire. On imagine le photographe dessus au milieu d’un désert. C’est la célébration de son passage sur Terre aussi simplement que ça. Comme un Indien d’Amérique, Koudelka est un voyageur permanent, un vagabond qui puise dans l’instant présent matière à l’éternel. L’éternité, c’est l’immortalisation de l’instant par l’appareil photographique. Pour être photographe – « avoir des choses à dire » comme le formule Koudelka – peut-être lui faut-il aller à ce point dans la précarité ? Peut-être lui faut-il se faire de l’éphémère une religion pour capter aussi bien le décor dans lequel se meuvent les vies humaines ? « Si tu souffres plus que les autres, tu gagnes le droit de faire ces photos », écrit-il dans un de ses carnets en 1974.
D’où, aussi, le fond tragique qui baigne les photographies de Koudelka. Du noir et blanc où l’ombre dérobe toujours quelque chose de la lumière. « Les visages ne se donnent jamais complètement », note ainsi Clément Chéroux. Les lieux sont vagabonds, les êtres sont des passants. Souvent, ils ne parlent pas, n’échangent pas. Ils sont des séparés et peut-être et avant tout, des séparés d’eux-mêmes. C’est peut-être ce que nous murmurent les photographies de Koudelka. Elles mettent en scène l’homme dans sa nature la plus profonde : son errance. Le photographe souligne l’être humain en quête d’un itinéraire, jamais tranquille, parcourant le monde sans trêve sur son dilemme le plus intime : comment être présent, vivant et comment, tout en même temps, accepter le néant, la perte, la disparition. Comment être soi-même.
Fleur
Et dans l’exposition du Centre Pompidou, une photographie le dit si bien. Elle non plus Josef Koudelka ne voulait d’abord pas la montrer. On y voit une jeune femme assise à l’arrière du dos d’un cheval. Devant : un cavalier dans l’ombre avec un chapeau. On dirait tout à fait que ce cavalier est en train de dérober la jeune femme et l’emmener dans son pays à lui. On se dit que ce sont de jeunes époux, que c’est sa fiancée. Mais la jeune femme ne regarde pas devant. Elle se tourne vers nous, vers le photographe. Elle regarde en arrière. Regarde-t-elle son passé ? Pense-t-elle à sa jeunesse qui se termine déjà parce qu’elle est en train de devenir épouse et bientôt mère ? Elle a des yeux teintés d’incertitudes. Et le plus troublant dans cette photographie, c’est qu’en découpant les formes, on y devine une fleur.
Comme si la queue du cheval était une tige et la robe de la jeune femme des pétales.
En une célébration de l’éphémère, de la beauté de l’éphémère.
Jean-Baptiste Gauvin
Jean-Baptiste Gauvin est un journaliste, auteur et metteur en scène qui vit et travaille à Paris. Son travail apparaît notamment dans la revue d’art pointculture.
Josef Koudelka, La Fabrique d’Exils
Du 22 février au 22 mai 2017
Galerie de photographies, Forum -1
Centre Pompidou
Place Georges-Pompidou
75004 Paris
France
Catalogue publié par les Editions Xavier Barral.
https://www.centrepompidou.fr/
http://exb.fr/fr/le-catalogue/300-la-fabrique-d-exils-9782365111188.html