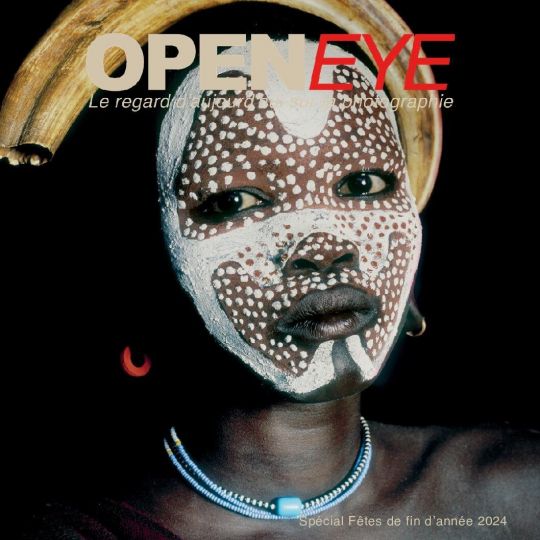La Galerie Esther Woerdehoff présente, jusqu’au 14 mars 2014, deux séries du photographe Jacques Pugin : Les cavaliers du diable et Sacred Site. L’exposition est composée de deux parties, deux points de vue sur un même thème, l’Afrique : tout d’abord un travail en noir et blanc sur les vestiges de la guerre, ensuite des photographies lumineuses en couleur des traces d’une culture ancestrale mais vivante.
On sait que, dès la Première Guerre mondiale, la photographie aérienne joua un rôle important. Outil de renseignement, enregistrement de la forme de tranchées en lacis à décrypter ensuite à des fins stratégiques, une cartographie inédite, héritière des expérimentations de Nadar s’envolant en ballon, balbutiait une fascinante histoire du point de vue, le “vu du ciel”. Il perdure, sous des formes utilitaires ou décoratives. La guerre, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, changeait de dimension, en impliquant simultanément davantage de pays qui allaient vivre le sacrifice d’une génération de jeunes gens et en faisant surgir dans le moindre village un monument aux morts attestant de la saignée. Elle s’accompagnait aussi d’une modalité alors inédite de la “photographie appliquée”. Sur ces topographies, l’homme est absent. Elles serviront pourtant à le détruire parce qu’elles ont aidé des généraux à déterminer avec une précision plus “chirurgicale”, comme le disent ceux qui veulent faire croire aux guerres “propres”, où il fallait frapper en priorité, quel champ il fallait noyer de bombes, quel boyau il fallait gazer, à l’assaut de quel tumulus il était préférable d’envoyer des gamins se faire étriper. Photographies, stratégie, tactique.
On redécouvre aujourd’hui, un siècle plus tard, ces images qui sont devenues à la fois des documents et des graphismes. Qu’est-ce que je vois sur une photographie ?
Presque un siècle après Verdun, c’est au Darfour, au cœur de l’Afrique, que les Janjawids, les “cavaliers du diable”, ont fait disparaître 300 000 êtres humains, hommes, femmes, enfants, pendant que la communauté internationale pétrie de bons sentiments officiels se bouchait les yeux et les oreilles. Entre temps, à l’occasion du second conflit mondial et en raison d’une conception de la guerre qui se voulait plus “scientifique” dans ses critères de destruction de l’homme, le terme de génocide est apparu. “Solution finale”. Le statut et les fonctions de la photographie avaient, eux, déjà changé. On était au début du temps du doute face à ce que l’on considère comme “l’âge d’or” du reportage, celui du témoignage visuel par enregistrement codifié de moments, de faits, d’événements, massivement relayé et publié par la presse. On savait déjà que bien des images du premier conflit mondial étaient des photomontages et avaient été utilisées à des fins de propagande et non de connaissance.
Le doute sur la fonction de ces images — est-ce qu’une photographie peut informer, et sur quoi, de quoi ? — n’a, depuis, fait que s’accélérer avec le déclin prévisible d’une presse ignorant que la télévision avait pris le relais pour dire, plus efficacement, ce qui se passait sur le terrain. Et, de toute façon, les photographes, les journalistes, les cameramen aussi, arrivaient toujours après que les viols aient eu lieu, après que les villages aient été incendiés, après que l’horreur ait été perpétrée. Restaient parfois des cadavres. Mais, s’ils sont pour certains photogéniques, les cadavres, en photographie, sont bien souvent équivalents, d’un conflit à l’autre, d’un continent à l’autre, d’une désespérance à une autre. Litanie funèbre qui ne dit rien, empêtrée qu’elle est dans le “réalisme” apparent de la photographie. L’enfer étant toujours pavé de bonnes intentions, la pratique journalistique de la photographie, encore nourrie des illusions des exceptionnels moments de la chronique de la guerre du Vietnam touche ses limites. Naïfs ou retors, sincères ou désespérément accrochés à une volonté de survie, des professionnels tentent encore, en vain, de survivre. Il leur manque l’humilité d’aller revoir Los desastres de la guerra de Goya. Ils n’ont pas, à temps, franchi le pas vers le documentaire radical débarrassé d’illusions ou vers l’acceptation de leur inévitable subjectivité. Hélas.
Entre temps, le monde a radicalement changé. Les images et leur statut également. Et leur nature s’est diversifiée, est devenue plus complexe. Tout comme leur utilisation. Nous sommes passés du temps de la photographie, d’un vingtième siècle dont l’image argentique a constitué l’essentiel de la mémoire visuelle, à une autre ère, celle de l’image. La photographie tenait le monde à distance — question fondamentale de sa pertinence, de sa “justesse” — et tentait vraisemblablement, dans une forme de délire dominateur, de substituer au réel l’intégralité de sa représentation en images. En faisant semblant de le “reproduire fidèlement” et de l’enregistrer, elle le rendait irréel. Elle le rendait d’autant plus inaccessible que l’expérience première du monde, qui fut physique, transitait d’abord et de plus en plus par sa transcription. Au temps de l’image, cette dernière n’est plus extérieure mais structurelle. Et, comme elle est devenue majoritairement virtuelle, comparable aux flux financiers et boursiers, elle détermine largement la vision première. Une vision devenue illisible de par l’énormité de la masse de clichés produits et mis en circulation. Flots en perpétuel changement, en enrichissement aussi rapide que les destructions immédiates qui les accompagnent, crue indéchiffrable qui nous renvoie à ce statut d’ “analphabète” de l’image que prévoyait déjà Walter Benjamin.
Aujourd’hui, au temps des représentations majoritairement virtuelles et instrumentales, l’univers est sous contrôle d’outils de mise en forme. Caméras de surveillance — la collecte du son n’est pas en reste —, délire paranoïaque sécuritaire que ne font qu’aggraver les menaces terroristes bien réelles, l’œil n’est plus seulement dans la tombe mais juché sur l’orbite — tiens, comme celle de l’œil — des satellites. Surveiller, surveiller tout, en disant que c’est pour savoir, dans un délire de pouvoir. Relire Michel Foucault.
Les satellites enregistrent, transmettent, permettent de conserver un temps, d’accumuler des données codées, des combinaisons de chiffres. Elles sont ensuite recolorées, dans la grande tradition américaine de la Nasa, pour proposer des visions séduisantes du monde. Tout aussi peu dénuées de “vérité” que la photographie analogique sur laquelle nous avons fondé des croyances en train de s’écrouler. Nous regardons comme de simples images des agencements de formes que les scientifiques qui ont voulu les générer dans leur processus de recherche savent interpréter. Interpréter, pas croire. Savons-nous ce qu’elles signifient ? Comme jadis, comme avant, c’est leur mise en contexte, leur usage qui déterminera leur fonction, qui leur permettra, ou non, de faire sens.
Qu’est-ce que je vois ? Et quand je vois, qu’est-ce que je sais ? Je vois des formes et je ne sais rien d’autre que ce que je porte en moi dans l’effort de re-connaissance de ces formes que j’effectue. Parce que la photographie n’informe pas, je projette en elle, vers elle, ma propre connaissance, effective ou ayant été transmise par des images préexistantes. Je décrypte aussi, si j’ai été éduqué à cela, le contexte dans lequel elles me sont proposées, présentées, afin que je perçoive l’intention de celui qui me les donne à voir.
Les caméras embarquées sur les satellites balayent, inlassablement, la surface du globe — des autres planètes également — et tentent de ne rien laisser échapper à cet enregistrement obsessionnel. Elles ont donc conservé trace des villages brûlés au Darfour entre 2003 et 2006. Ce n’était pas parce qu’elles cherchaient cela, simplement parce qu’elles “voient” tout. En résultent des images en couleur, mises en couleur, réalistes ou pas. Sur l’une d’entre elles, des maisons brûlent, feu immense surplombé de fumée noire ; sur d’autres, dans des étendues presque désertiques, beiges, des points, noirs, un peu de rouge. D’autres, interprétatives, laissent penser qu’il y a des arbres. Des marques écarlates, posées par des analystes, désignent les habitations détruites. Je n’en sais pas davantage que cette organisation abstraite des teintes. Voir n’est toujours pas savoir.
A quoi pourraient bien servir ces images ? Jacques Pugin leur a trouvé une fonction : à poser une question. A poser les questions précédentes, à les mettre en forme en tout cas. Il a ôté la couleur, a retrouvé le noir et blanc dont le graphisme nous éloigne des représentations figuratives et nous renvoie implicitement aux débuts de la photographie et à sa tradition. Pour s’en rapprocher encore, il a choisi de les inverser, de retourner aux origines, au négatif, à ce qui, dans d’autres temps, était fondateur en photographie : une empreinte, une matrice rendue possible par la lumière se confrontant aux volumes du réel pour le mettre à plat. Le re-présenter.
Ce que je vois, ce ne sont toujours que des formes. Ce pourrait être des incisions au stylet sur une plaque noire pour faire surgir dans une organisation de lignes la blancheur de la matière sous jacente. Goya aussi incisa des plaques, d’acier. Pour graver, en noir sur le blanc du papier, les désastres de la guerre.
Jacques Pugin s’approprie des formes existantes, créées par d’autres, produites par des machines. Attitude contemporaine s’il en est. Il les interprète pour nous proposer d’autres images, les siennes, qui disent sans hausser le ton : comment, aujourd’hui, peut-on représenter la guerre ?
LIVRE
Les cavaliers du diable
Jacques Pugin
Le livre, de format 30 x 30 cm de 64 pages, a été édité à 300 exemplaires dont 20 de tête numérotés et signés, dans un coffret accompagné d’un tirage original de format 30 x 30 cm.
69 € et 350 € pour l’édition de tête.
http://editions-jacquespugin.com
http://jacquespugin.ch/livrescatalogues.html
http://jacquespugin.ch/les-cavaliers-du-diable.html
EXPOSITION
Les cavaliers du diable et Sacred Site
Jacques Pugin
Jusqu’au 14 mars 2015
Galerie Esther Woerdehoff
36, rue Falguière
75015 Paris