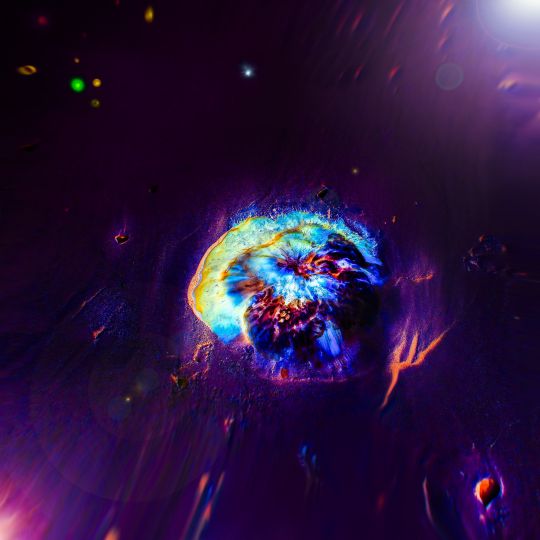Un homme ou une femme est convoqué par un photographe pour une séance de portraits d’un genre particulier. Ils se mettent en condition affective pour pleurer, non de joie, mais de douleur. Telle est l’origine des photographies bouleversantes et belles de Jacques Camborde. Une telle démarche puise dans un fonds anthropologique.
L’usage social des larmes connait maintes destinations et illustre bien le caractère conventionnel des mimiques ou des manifestations corporelles. Celles-ci sont les éléments d’un langage. Dans notre ouvrage Les passions ordinaires. Une anthropologie des émotions, je me suis attaché à une balade anthropologique à travers cette diversité humaine. Leur aisance à être versées dans certaines situations participe de la facilité avec laquelle on s’en détache une fois la cérémonie achevée. Klineberg cite les Indiens Huicholes du Mexique qui pleurent à volonté à différents moments du rituel funéraire, mais retrouvent ensuite leur entrain coutumier. W. La Barre décrit une Indienne Kiowa lors des funérailles de son frère qu’elle n’a pas vu depuis des années. Elle émet des cris désespérés, s’arrache les cheveux, s’écorche les joues, et tente même de sauter dans la tombe, opportunément retenue par ses proches. Elle vit les émotions requises par les circonstances. Plus tard, éloignée du cimetière, elle retrouve sa vivacité habituelle. Dans certains contextes sociaux les larmes sont émises à volonté, notamment lors de rites de salutations. Man rapporte ainsi une observation faites dans les iles Adaman : « Des parents, après une absence de quelques semaines ou de quelques mois, témoignent leur joie de se retrouver en s’asseyant les bras autour du cou l’un de l’autre, pleurant et hurlant de telle sorte d’un étranger pourrait croire qu’il leur est arrivé quelque grand malheur; et, en fait, on ne peut déceler aucune différence entre leurs démonstrations de joie dans ces occasions et celles de leur douleur à la mort d’un des leurs ». Les larmes ne sont pas l’indice d’une souffrance, mais elles sont associées de manières obligatoires à un rite de bienvenue pour saluer l’arrivée d’un étranger ou le retour d’un membre de la communauté. Clastres décrit chez les Indiens Guayaki les salutations larmoyantes qui accompagnent les retrouvailles avec un chasseur. Deux femmes, l’une âgée, l’autre plus jeune, entourent le nouveau venu Ces manifestations témoignent d’une affectivité collective, elles marquent la solidarité du groupe, l’émotion devant un retour ou une visite qui ajoute au lien social. Insérées au sein d’une procédure rituelle de salutation, les larmes ne relèvent en aucun cas d’une signification univoque, seules les circonstances où elles apparaissent en donnent la signification. Radcliffe-Brown ayant observé à plusieurs reprises ces sortes de salutation demanda à des indigènes de les reproduire « à froid », et aussitôt « deux ou trois d’entre eux s’assirent et pleurèrent immédiatement de vrais larmes à sa demande ». Klineberg cite un Maori de sa connaissance capable de pleurer à volonté. Le même homme regrettait l’éducation occidentale reçue désormais par les jeunes Maoris en Nouvelle-Zélande leur faisait perdre cette faculté qu’ils retrouvaient difficilement lors des cérémonies traditionnelles. Les larmes sont tributaires du symbolisme d’une société.
Dans le domaine religieux les larmes accompagnent l’ascèse du moine en marche vers l’hêsychia (le repos). Chez les Pères du désert l’abondance des larmes relève de l’ascèse. La désolation sur l’étendue des péchés commis de son vivant est un devoir. « On racontait de l’Abba Arsène « que toute sa vie durant, il mit un linge sur sa poitrine à cause des larmes qui coulaient sans cesse de ses yeux ». Isaac le Syrien loue le don des larmes : « Tant que tu as des doigts, signe toi dans la prière, avant la venue de la mort. Tant que tu as des yeux, emplis les de larmes, jusqu’au moment où la cendre les recouvrira ». La passion des larmes amène Jean le Solitaire à une subtile distinction entre différentes variétés de larmes : celles du physique, celles du psychique et celles du spirituel. Les pleurs nés du corps viennent des pensées tournées vers la pauvreté, les souffrances passées, les soucis journaliers. Ceux du psychique se nourrissent de la crainte du Jugement, de la conscience des péchés, de la bonté de Dieu, de la mort et de l’au-delà qui s’annonce. Quant aux pleurs du spirituel ils viennent du sentiment de la majesté de Dieu, de la stupeur devant l’étendue de sa sagesse, de l’admiration devant la gloire du monde futur, etc. Ce sont plutôt des larmes de joie. Mais d’autres pleurs spirituels coulent aussi à la pensée de l’ingratitude des hommes, de leur oubli de Dieu.
Ce goût des larmes se rencontre lors de l’antiquité chrétienne, comme dans des formes plus tardives à partir du XIe siècle, jusqu’au courant du XIXe siècle. L’abondance de larmes traduit alors le repentir de l’homme de foi à la recherche du salut, son sentiment aigu de l’imperfection de sa condition terrestre, elle ajoute à la ferveur de sa prière. Au XVIIIe siècle, de manière plus profane, les larmes participent d’un pathétique de la vie mondaine, elles sont parfois voluptueuses et recherchées. En 1728, par exemple, Prévost écrit : « Si les pleurs et les soupirs ne peuvent porter le nom de plaisirs, il est vrai néanmoins qu’ils ont une douceur infini pour une personne mortellement affligée. Tous les moments que je donnais à ma douleur m’étaient si chers que pour les prolonger, je ne prenais aucun sommeil ». On goûte alors la douce mélancolie des larmes, il n’y a aucune honte à les verser.
Même dans une situation psychologique associée à la peine, les pleurs peuvent traduire une détresse personnelle ou un simple désagrément chez quelqu’un qui a « les pleurs faciles », une manière de susciter la pitié ou d’exercer une pression afin de désamorcer la colère d’un partenaire, de montrer sa sincérité, de séduire en affichant une fragilité, un appel à être consolé. La nature des larmes est également multiple, on peut verser une larme ou pleurer à chaudes larmes, etc. On peut aussi pleurer de joie ou de soulagement. Et, bien entendu, les larmes ne sont pas dissociées d’une attitude corporelle, de mimiques spécifiques, d’un jeu de regard, etc. Elles ne sont que les signes inscrits dans une symbolique corporelle, et non une nature irréductible.
Dans l’histoire de la photographie, les visages en larmes des modèles viennent d’abord de scènes douloureuses saisies dans un contexte de guerre, de séismes, de deuils. Les clichés saisissent le vif de l’événement en pleine douleur, quand les individus relâchent les contraintes quotidiennes de la présentation de soi qui impliquent en principe de ne pas embarrasser les autres, sauf s’ils sont très proches. Si la joie se partage, comme le rire ou le sourire, le chagrin est intime. Un effacement des émotions pénibles régit le lien social. Les larmes d’aujourd’hui sont essentiellement le privilège de l’enfance, on ne voit guère d’adultes pleurer et s’ils ne peuvent se retenir, on ne les tolère qu’un moment. La convention du sourire lors des séances de photographies amicales ou familiales tient dans la célébration affichée du quotidien et du lien avec les autres.
D’où l’insolite de la démarche de Jacques Camborde. Prendre le vif du visage meurtri d’hommes ou de femmes qui ne sont pas en souffrance et dont il requiert la posture des larmes. A froid, dans une situation indifférente, sous le regard de l’artiste qui attend leur bonne volonté, ils expriment les mimiques du chagrin et pleurent. Ils se mettent en condition, quasiment sous le modèle de Stanislavski ou Lee Strasberg à l’Actors Studio : susciter en soi une émotion fabriquée de toute pièce en mobilisant des souvenirs douloureux afin que les larmes coulent. Jacques Camborde demande à ses modèles une présentation théâtrale dont le résultat est bouleversant. Le visage est sans doute une anamorphose de l’individu. Mais il n’existe aucune position idéale pour en redresser la forme et établir en une figure simple et cohérente la cartographie d’une histoire ou d’un avenir attendu, ni davantage le relevé sans équivoque d’un caractère. Le visage s’abime dans le rire ou les larmes, c’est-à-dire dans les excès; simultanément ils en donnent une version inédite et révélatrice. Il se tord, se défait, se défigure. Il cesse d’être visage. Si le rire annule le personnage social que chacun s’évertue à être, démoli la face qu’il est toujours nécessaire de tenir lors des interactions sociales; les pleurs en révèlent la nudité, la fragilité. L’homme ou la femme qui pleure se dépouille de ses défenses sociales; il/elle retrouve le visage éperdu de l’enfance blessée.
D’où le vertige qui se dégage de ces portraits qui nous touchent au cœur car ils dévoilent des hommes et des femmes démunis, mis à nu, avec le sentiment que flotte sur les visages quelque chose d’une âme meurtrie.
David Le Breton