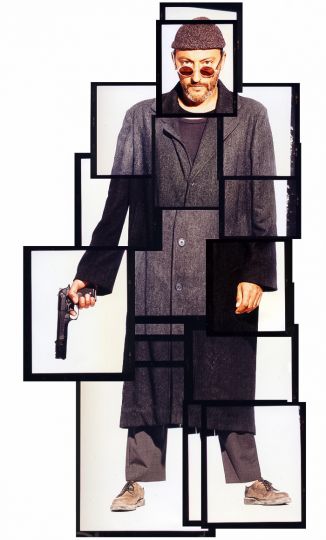Le photographe Jean Gaumy a été installé à l’Academie des Beaux-Arts ce Mercredi 10 octobre 2018. Il y rejoint Yann Arthus-Bertrand, Sebastião Salgado et Bruno Barbey. Vous trouverez ci-dessous le discours de Jean Gaumy ainsi que le discours de réception officielle de Paul Andreu qui était absent de la cérémonie, on devait apprendre qu’il était décédé le soir même.
Chères consoeurs, chers confrères, Mesdames, Messieurs,
Paul Andreu,
Paul Andreu, je vous remercie très sincèrement pour le discours riche, dense et bienveillant que vous venez de prononcer.
La reconnaissance que vous et l’ensemble de vos confrères m’accordez aujourd’hui me touche et m’intimide profondément.
J’ai bien conscience qu’à travers moi, à la suite de Lucien Clergue, Yann Arthus-Bertrand, Sébastiao Salgado et Bruno Barbey, c’est surtout de la reconnaissance de la photographie qu’il s’agit. Aussi, à l’honneur que vous me faites s’ajoute la responsabilité de devoir rester légitime, face à vous, face à tous mes confrères photographes, qu’ils soient académiciens ou non.
Vous avez décidé que je sois parmi vous, j’ai accepté de l’être. A moi d’assurer que ces choix demeurent pertinents.
Plus tard, lorsque j’aurai passé l’âge d’être immortel, une autre ou un autre, me succéderont sur ce siège que j’inaugure.
J’espère que j’aurai réussi à leur laisser quelques traces du bien fondé de votre choix pour le discours de succession qu’ils auront alors à prononcer à leur tour.
En attendant, je reprends vos mots Paul Andreu, ils m’ont marqué lorsque vous et vos confrères me proposiez de rejoindre vos rangs. Ils m’ont rassuré même. Vous disiez :
« Nous ne sommes pas ici parce que nous serions prétendument parmi les meilleurs au sein des disciplines
que nous représentons ; nous ne sommes pas ici pour nous pousser du col et nous placer en exemples ; (sans doute avons-nous quand même quelques qualités, ajoutiez-vous prudemment, mais…) mais nous sommes surtout ici parce que nous nous devons d’être au service de… »
Et en effet, c’est cette profonde motivation – être au service de – que j’ai découvert il y a deux ans dans votre assemblée lorsque je constatais, assez épaté je dois dire, que derrière les habits d’académiciens, les conventions et les cérémonies telles que celle que nous vivons ensemble aujourd’hui, j’avais affaire à une compagnie éclairée, très compétente dans ses champs d’expertise, très au fait de l’histoire des arts et de la société actuelle, très curieuse du monde et de son avenir et surtout, que n’envahissent nulle doctrine sclérosante, nulle certitude absolue.
Des convictions, oui. Opposées parfois. Tant mieux. Des doutes salutaires aussi. Voilà qui me rassurait.
Me voici maintenant devant vous dans cette position assez rare de ne succéder à personne.
Une étrange situation.
Aucun prédécesseur ? Pourtant !
Pourtant, moi, je me sens accompagné de toute une troupe invisible de photographes désormais disparus qui auraient pu, depuis presque deux siècles, recevoir en leur temps cet honneur que vous m’accordez – au point même que moi, je suis tenté de m’effacer devant eux pour les laisser passer.
La photographie aura bientôt 180 ans.
Elle est, bien sûr, très jeune, comparativement à l’histoire de bien des autres disciplines artistiques qui composent l’Académie des Beaux Arts, mais voilà seulement 12 ans que sa présence a été acceptée comme art à part entière dans cette assemblée grâce à notre ancien Secrétaire perpétuel, Monsieur Arnaud d’Hauterives, malheureusement décédé en 2016.
Il est vrai que, semblable à celle du cinéma, la nature très technologique de ce nouvel art pouvait être déroutante. Elle l’est encore.
Elle l’est du fait de la fulgurante évolution actuelle des technologies qui la nourrissent et qui en facilitent extraordinairement la pratique.
Les nouvelles facilités, ouvertes à tous par le numérique, rendent l’exercice de leur discipline encore plus exigeant pour ceux dont c’est la vocation et le métier.
Nous voici désormais face à nous-mêmes, tenus de viser encore plus rigoureusement quelques- unes des cibles essentielles que la photographie a toujours pointées : donner du sens, s’impliquer, avoir un point de vue.
Qu’ont fait d’autre les quatre photographes que je vais évoquer ? Jacques-Henri Lartigue, Marc Riboud, Gilles Caron et Claude Raymond Dityvon ?
Ce sont eux dont je me sens le successeur. Ils m’ont marqué. J’ai d’eux des photographies qui persistent sur mon horizon intérieur et qui répondent en moi au moindre appel. C’est en très grande partie à eux que je dois de m’être consacré à la photographie.
Chacun d’eux aurait pu se trouver ici, à ma place, sous cette coupole.
Jacques LARTIGUE.
Jacques Lartigue, j’aurais pu évoquer les photographes des tout débuts, ceux qui vous précédaient : Hippolyte BAYARD, NADAR, Gustave Le GRAY, Henri Le SECQ, Charles NÈGRE et tant d’autres encore.
Mais pour moi, c’est vous, Jacques LARTIGUE, que je place très arbitrairement dans mon choix des débuts de la photographie.
Vous êtes le premier de ma généalogie.
Je ne vais pas retracer tout votre parcours mais comme pour vos trois confrères, je m’en tiendrai seulement à un ou deux des aspects qui me semblent significatifs.
Sachez, d’abord, que vous êtes à mes yeux le trait d’union qui me relie naturellement à la photographie telle que la pratiquait en amateur, à la même époque, ma propre famille.
Mais vous Jacques, vous, votre incroyable façon de jouer à la photographie dès l’âge de 7 ans a été exceptionnelle.
Il est vrai que les conditions qui y ont mené l’ont été tout autant.
Vous êtes né en 1894 au sein d’une riche famille de la bourgeoisie éclairée. Votre père Henri qui était homme d’affaire, banquier, directeur de journaux, était aussi un bon photographe amateur.
Il vous a initié très jeune à la photographie et vous intégriez très vite ses conseils.
Vous aviez 7 ans.
Votre père vous a transmis l’impératif catégorique de ne jamais être complaisant avec vos désarrois, et de toujours tenter d’être, ou du moins de paraître heureux. Vous aviez, nous le savons, quelques prédispositions. C’était votre nature d’être heureux. Mais, cette injonction au bonheur ravivait l’angoisse que des enfants très sensibles, comme vous, peuvent ressentir parfois face au temps, face à la perte. Vous redoutiez vraiment de perdre les instants de bonheur auxquels vous vous accrochiez compulsivement. Vous tentiez coûte que coûte de ne pas les oublier, de vous en souvenir, d’en garder la trace.
Vous tentiez…
Vous n’y parveniez pas toujours et, de votre propre aveu, vous en êtes tombé malade. Vraiment malade.
Alors, votre père a eu une intuition géniale. En 1901, lorsque vous aviez 7 ans, à Noël, il vous a offert votre premier appareil photographique – une chambre en bois 13 x 18.
« Avec mon appareil, avez-vous écrit dans les carnets que vous teniez déjà avec l’aide de votre mère, avec mon appareil, les instants ne seront pas perdus, je vais pouvoir tout photographier. Tout ! »
L’appareil photographique est devenu pour vous l’objet magique qui permettait enfin de satisfaire votre grand désir, votre « mission » même : ne pas perdre les instants « heureux ».
Ils ne l’ont pas été, nous en sommes témoins. Vous en avez fait 135 albums durant les 92 années de votre existence.
Ces albums, vous les avez composés au rythme de votre vie et, plus que de photographie, c’est vraiment d’un récit qu’il s’agit : le récit de votre vie « rêvée ».
Vous avez écrit un journal de presque 10 000 pages. Vous avez réalisé des dizaines de milliers de négatifs
Au final, vous nous avez transmis des traces merveilleuses d’une époque qui elle, malheureusement, ne l’était pas toujours.
C’est John Szarkowski, conservateur au Musée des Arts Modernes de New York – le MOMA qui vous a découvert dans les années 60…
Bien en avance sur la France il affirmait, lui, que la photographie était un art, et c’est au MOMA, en 1963, qu’il vous a donné de faire votre première exposition.
Ce fut une révélation.
A ses yeux « vous étiez LE « primitif » de la photographie, un enfant de génie qui dès 1900 en avait connu d’instinct les règles »
« On s’est aperçu un jour, disait-il, on s’est aperçu que ce que les grands maîtres avaient découvert à force de recherches sophistiquées, un enfant, lui, l’avait su intuitivement, autour de 1900 »
Marc RIBOUD.
Marc RIBOUD, nous nous sommes connus en 1976, vous aviez 56 ans, j’en avais 28.
Vous êtes né bien après Jacques Lartigue. En 1923.
Pour vous aussi, Marc, l’enfance a été déterminante. Vous étiez issu d’une famille très aisée de la grande bourgeoisie lyonnaise. Le cinquième de sept enfants. Vous étiez timide parait-il, timide et solitaire.
Et, pour tout arranger, quasi mutique.
Bien plus tard – devenu quand même un peu plus loquace – vous rappeliez ce souvenir de l’époque où vous étiez adolescent :
Mon père, avez-vous dit, mon père a eu cette phrase décisive : « Marc si tu ne sais pas parler, tu sauras peut être regarder… » et il vous a donné son appareil photographique.
Il avait 7 enfants mais c’est à vous qu’il l’a donné.
Vous aviez 14 ans.
Pour ma part je vous ai connu bien différent ; plutôt sûr de vous, Président de l’agence photographique internationale Magnum. Et le timide en l’occurrence, c’était moi. C’est peut-être d’ailleurs ce qui m’a valu votre sympathie lorsque nous nous sommes rencontrés en 1976 à Milan.
C’est en grande partie grâce à vous que j’ai pu rejoindre un an plus tard Magnum, cette étonnante coopérative photographique à laquelle vous, vous participiez depuis 1953 sous les regards bienveillants de Robert Capa et Henri Cartier-Bresson. Vous avez été de cette génération qui a suivi immédiatement celle des fondateurs de l’agence Magnum en 1947 : Robert Capa, Henri Cartier-Bresson mais aussi David Seymour et Georges Rodger dont je connaissais bien les travaux. Je connaissais les vôtres aussi, bien sûr. C’est simple, comme les autres, votre studio c’était la planète. Toute la planète. Ou presque…
Vous étiez voyageur, flâneur même. Vous n’étiez pas à proprement parler un photojournaliste mais un photographe « concerné », un photographe très attentif à l’histoire du monde. Vous l’avez maintes fois prouvé.
Vous étiez surtout d’une époque où l’on ne s’inquiétait pas exagérément d’être présent dans les musées ou les collections. Entre photographes, vous parliez d’abord de ce que vous découvriez là où vous alliez.
Vous parliez d’humanité. Vous ne parliez pas forcément d’art même si…
D’ailleurs, étiez-vous un artiste ?
Vous l’étiez, bien sûr, mais vous ne vouliez pas en entendre parler.
A cette question, plutôt que de vous dire « artiste », ce mot si fatigué, vous répondiez avec détermination, vous avez toujours répondu : « Je suis photographe ». Photographe, témoin, journaliste, auteur,
artiste aussi, bien sûr… mais pas seulement.
Je le sais, vous n’aimiez pas ceux qui se prenaient trop au sérieux sur ce point.
Vous avez côtoyé la mort à 20 ans, en 1943 et 1944, lors de vos années de maquis, durant les combats dans le Vercors. Vous n’en avez pas souvent parlé.
Lors des combats, vous avez échappé au pire devant les forces allemandes. Vous avez du vous cacher seul, isolé des semaines durant dans les montagnes et les forêts. Énorme solitude, écrasante… disiez-vous.
Votre famille, elle, vous croyait mort.
L’expérience rejaillit alors. Forcément ! Il y a toujours quelque chose de sa propre histoire qui émerge à travers les photographies que nous faisons. Pour vous, bien sûr, ce fut le cas. De très nombreuses fois.
Dans les années 60 par exemple, en1962 très exactement, vous étiez en Algérie pour photographier son indépendance toute proche.
« C’est en électron libre, écrit à cette occasion la philosophe Seloua Luste Boulbina, c’est en électron libre et en homme timide et solitaire que Marc Riboud voyagea en Algérie, dans des circonstances exceptionnelles.
Formé très précocement aux maquis du Vercors, pouvait-il quelques années plus tard, être impressionné par les nouveaux maquisards ? … On sent bien dans les photos qu’il prit la proximité, la connaissance immédiate qu’il avait des sujets et des scènes qu’il immortalisait. Il n’avait aucune connaissance particulière de la situation et ce n’est pas intellectuellement qu’il captait ce qu’il observait et qu’il sentait ; c’est immédiatement, …dans l’instant de voir, dans l’intuition de ce qui se passait.
Marc Riboud n’est pas partisan dans un procès à charge ou à décharge, continue-t-elle : son travail n’est pas militant. Pour lui, montrer n’est pas prouver : c’est archiver, documenter… Mettre l’instant au service du futur. (1)
C’est cette même position Marc que vous adoptiez lorsqu’en 1957 vous entamiez pour des années tout un cycle incessant d’allers – retours en Chine. La Chine mais aussi l’Inde, l’Extrême Orient, le Viet- Nam : Nord ET Sud, le Moyen Orient : Israël ET la Palestine…
Vous observiez l’évolution d’une situation, d’un pays. Vous en preniez le temps.
Vous parliez aussi d’instinct, d’instinct décisif. Comme tous ceux de votre envergure vous aviez cet instinct et justement vous disiez : « Si on pense trop à la forme on risque de tomber dans le beau, dans le bien fait alors que la photographie c’est l’instinct, c’est l’instant. L’instantané ».
Gilles CARON.
J’étais encore à l’université de Rouen lorsque j’ai découvert en 1970 qui était Gilles Caron.
J’allais avoir 22 ans, il en avait 30. Je commençais à peine à photographier alors que lui, avait déjà trois années d’expérience, trois années seulement, et en si peu de temps, il venait de marquer au fer rouge la photographie de reportage qui, d’ailleurs, commençait vraiment à lui peser.
Lui aussi avait indéniablement cet instinct essentiel pour le moment décisif et un sens inné de l’événement dans l’Histoire. Ses images étaient immédiates, limpides, sans artifice, ni pathos.
En 1967, avec « la guerre des 6 jours », le conflit entre l’état d’Israël et l’Égypte, il vit sa première expérience photographique sur un champ de guerre. Le reportage inouï qu’il en fait sera publié sur toute la planète.
Son nom fait alors très vite le tour des rédactions mondiales et entrainera du coup la réussite de la toute jeune agence photographique Gamma.
Quelques mois plus tard, en novembre, en novembre 67, c’est le Viet Nam.
Là, il est le seul à photographier la prise de la colline de Dak-To, l’une des batailles les plus terribles du conflit.
Puis ce sera la famine au Biafra, le génocide, les journées historiques de Mai 68, les émeutes en Irlande du Nord de 1969, la répression des manifestations anti soviétiques lors du premier anniversaire de l’invasion de la Tchécoslovaquie.
Ses photographies ont donné corps et image, dans le monde entier, à tous ces événements.
En fait, Gilles, vous êtes partout…
Et souvent le premier.
Don McCullin, l’un de vos amis, l’un des très grands photographes de guerre du XXème siècle, le savait.
« Dès qu’un conflit éclatait quelque part dans le monde, disait-il, il fallait que j’y aille le plus vite possible de peur de trouver Gilles déjà sur place… »
En janvier 1970, vous partez au Tchad avec Robert Pledge et Raymond Depardon qui d’ailleurs plus tard, allaient devenir mes amis et m’ont beaucoup aidé lors de mes débuts. Ensemble vous êtes allés rejoindre la rébellion Toubou contre le pouvoir central de Fort Lamy mais au terme d’un accrochage qui aurait pu très, très mal tourner vous êtes faits prisonniers durant plusieurs semaines.
À peine de retour, Gilles, vous insistez, vous allez au Cambodge.
Avant de partir, sans doute ébranlé par votre aventure au Tchad, vous dites à Robert Pledge : « Je vais au Cambodge mais ce sera la dernière fois que j’irai sur un conflit. Je resterai à Phnom Penh, je n’en sortirai pas, je ne prendrai aucun risque ».
Vous n’êtes pas resté à Pnom Penh
Vous n’êtes jamais revenu. Vous disparaissez le 5 avril 1970 dans une zone contrôlée par les Khmers rouges sur la route qui menait à Saïgon.
Trois années… Trois années fulgurantes.
Mais qu’est ce qui pouvait bien vous pousser à être un photographe de cette sorte ?
Vous avez vécu la guerre d’Algérie. Vingt-huit mois de service militaire où la situation que vous découvrez vous révolte. Vous êtes même emprisonné pour « refus de partir en opération ». Expérience fondatrice !
Expérience fondatrice d’une sensibilité politique et sociale à vif, d’une détermination silencieuse, d’une sourde colère, d’un « conflit intérieur » comme l’a si bien nommé des années plus tard votre fille Marjolaine.
En trois années vous êtes devenu sans en avoir tout à fait conscience, l’un des plus grands photojournalistes de votre époque, mais vous, avec beaucoup de lucidité, vous vous posiez déjà de sérieuses questions sur le sens de vos interventions. Vous doutiez, vous ne souhaitiez plus photographier de cette façon. Vous l’aviez écrit de Saïgon à votre compagne Marianne.
Quel photographe seriez-vous devenu après cette décision ?
Le projet de Caron, écrit Michel Poivert, était celui de raconter autrement l’actualité, d’intégrer autrement ses propres sentiments sur l’humanité à la sténographie visuelle du photojournalisme…
Cette tentative de trouver vers la fin des années 60 un nouveau lien entre réalité et subjectivité ressemble aujourd’hui à un avant courrier de la photographie d’auteur qui allait être la marque de la décennie suivante. (2)
C’est justement lors de cette décennie suivante, celle des années 70 que je me suis passionné pour la photographie au point d’en faire ma vie.
Tout est allé très vite et c’est durant cette période, en 1971, que j’ai fait la connaissance de Claude Raymond -Dityvon.
Claude Raymond-Dityvon, ce sont vos photographies et celles de Gilles Caron, qui m’ont déterminé.
A cette époque, en France, vous participiez à cet essor naissant de la photographie d’auteur que justement pressentait Gilles Caron.
Mais, ce n’est pas de cela dont je veux parler, c’est de votre rapport aux images des grands réalisateurs de cinéma que vous aimiez alors : Murnau, Carl Dreyer, Jean Vigo, Bergman, Antonioni.
C’est de la maîtrise que vous avez manifesté dès vos débuts, tout imprégné visuellement que vous étiez par leurs films.
Vous veniez d’une famille très modeste établie à La Rochelle.
« Non pas prolétaire, disiez-vous, mais carrément sous-prolétaire ».
Vous êtes venu vivre à Paris en 1962, vous aviez alors 25 ans.
Vous pratiquiez le métier de charpentier et de peintre en bâtiment et … vous alliez plusieurs fois par semaine à la Cinémathèque.
Christiane, qui travaillait dans le milieu de la mode et qui allait être votre compagne a très vite compris
qu’à travers le cinéma c’était surtout le cadre, l’image, la photographie, qui vous attirait. C’est elle qui vous a offert votre premier boitier photographique. Vous avez été immédiatement dans le bain.
Vous étiez totalement prédisposé pour la photographie. Pour vous c’était naturel.
Sans y prendre garde vous aviez déjà presque tout appris sur le grand écran. Vos maitres étaient cinéastes.
Vous étiez photographe.
Si j’évoque cette relation au cinéma, c’est parce qu’avec vous nous sommes quelques-uns à avoir en commun cette même influence sur nos images photographiques.
A l’époque, et ne m’en tenant qu’au seul cinéma documentaire, je pourrais évoquer des cinéastes comme
Robert Flaherty, Fréderic Wiseman, Pierre Perrault, Richard Leacock, Chris Marker et surtout, Jean Rouch.
Chris Marker, Jean Rouch… En voilà deux justement qui auraient pu rejoindre cette assemblée. Tous deux étaient cinéastes, photographes et bien plus encore. Ils étaient des pionniers en la matière.
La photographie et le cinéma documentaire étaient pour eux – comme ce le sera pour moi – la merveilleuse capacité d’inscrire dans l’image la trace de l’éphémère : ce qui n’a lieu qu’une seule fois et ne se reproduira jamais plus sous la même forme.
C’est du rapport au temps qu’il s’agit là ; de la puissance des images pour appréhender le temps.
Avec vous, Claude Raymond-Dityvon, ce sont les premiers sujets que vous avez abordés qui m’ont marqués :
vos photographies sociales noir et blanc sur les mines de charbon, sur les bidonvilles de la Courneuve, sur la vie paysanne, sur le chalutier « Antioche » de La Rochelle.
Je vous ai rencontré au moment où la politique et les marchés magnifiaient de plus en plus le « voir », le paraître, le fantasme. Il revenait alors (et il revient encore) à la photographie, au sein de l’art en général, la responsabilité de réinjecter une dose salutaire de réel et de poésie.
Vous, vous le faisiez.
Durant cette même époque, alors que Gilles Caron venait de lancer l’agence Gamma, vous alliez bientôt créer l’agence VIVA avec quelques autres photographes parmi lesquels Richard Kalvar et Guy Le Querrec dont j’allais d’ailleurs découvrir plus tard les travaux et avec lesquels vous faisiez une équipe très marquante.
Avec eux, vous prôniez l’émergence d’un humanisme revivifié ; vous prôniez un nouvel éclairage sur des classes sociales, sur des gens et des modes de vie souvent considérés sans intérêt par les journaux de cette époque.
Cependant, Claude, il est arrivé un moment où vous n’avez plus voulu vous cantonner à cette seule expression de la réalité sociale. Vous commenciez à vous y sentir enfermé.
Alors vous avez poussé le bouchon jusqu’à ne plus vous intéresser qu’aux temps sans intérêt,
au silence, au « rien ».Vous attendiez le moment creux, l’instant où rien, apparemment, ne se passait mais où tout se jouait. Vous étiez une sorte de précurseur à la façon d’Antonioni mais, de l’aveu même de Louis Skorecki et Serge Daney qui vous admiraient et vous soutenaient au sein du journal « Libération » vous en êtes devenu, je les cite, l’inconnu le plus célèbre de la photographie de la fin du XXème siècle.
Ce n’est plus le cas. Vous ré-émergez d’un court purgatoire et ce n’est que justice. Pour ma part, moi, je ne vous avais jamais oublié.
A 70 ans, je suis l’enfant d’une époque donnée où une certaine harmonie s’imposait alors par le seul fait de l’uniformité des technologies. Le numérique est venu redistribuer toutes les cartes. Il a déclenché depuis quelques dizaines d’années, en art comme dans bien d’autres domaines, une incroyable agitation moléculaire, un vrai magma en fusion avec ses diamants et ses scories.
Nous y sommes encore.
De nouvelles formes d’expression émergent, de nouvelles voies s’ouvrent.
Pour ma part, imprégné par toute une culture d’époque, une histoire, une sensibilité, j’ai toujours procédé en photographie par approximations successives (une expression qu’aimait beaucoup Jean Rouch).
Depuis mes débuts, c’est d’instinct qu’il s’agit. C’est ce que je photographie qui me mène à découvrir ce que je cherche et que je ne sais pas toujours.
C’est un acte très immersif et solitaire.
Pourtant, je suis de ces photographes qui aiment saisir le monde de très près, au contact même, au milieu des gens, mais paradoxalement, parce que l’exercice l’impose ou parce que c’est ma nature, je me retrouve toujours un peu en retrait. Ni tout à fait distant, ni tout à fait avec. Solidaire souvent, mais jamais vraiment totalement avec les autres…
Tout seul ensemble…
Tout seul ensemble comme bien d’autres photographes, bien d’autres artistes.
C’est une étrange solitude. Très particulière.
Heureusement Michelle, mon épouse, notre fille Marie, son compagnon, ses enfants et quelques amis aussi, sont là. Ce sont eux qui m’ancrent dans la vie.
Depuis quelques années, en partie grâce à Michelle, j’ai développé en parallèle une autre approche photographique bien plus contemplative. Il n’y a pas de hasard, Michelle qui s’est toujours passionnée pour les arts s’est mise à son tour, il y a une quinzaine d’années, à réaliser ses photographies.
J’observais ses recherches. Nous partagions, nous partageons encore, et c’est un peu à travers son regard que s’est constituée, que s’est reconstituée ma photographie.
Je l’en remercie.
Violette. Gaston. Mes petits-enfants. Juste un mot.
Ici, vous l’avez entendu, bien plus que d’honneurs ou de reconnaissance, c’est d’abord de transmission qu’il s’agit. Cela vous concerne.
Quand je vous vois, je me demande bien sûr, quel monde nous allons vous laisser mais aussi, et surtout, quels enfants nous allons laisser au monde.
Avec Michelle, votre grand-mère, nous avons transmis à votre mère, Marie, ce que maintenant vous recevez d’elle et de votre père et qui vous construit en grande partie.
Très bientôt, ce sera à vous de poursuivre cette longue chaine.
C’est exactement ce qui se joue ici – transmettre, partager l’expérience, préserver ce lien précieux qui existe entre les générations. L’adapter bien sûr, le rénover. Le rompre aussi parfois pour que puisse émerger « autre chose », quelque chose d’imprévisible, qui féconde, qui transforme.
Ces ruptures-là sont rares finalement. Elles sont naturelles, imprévisibles et certainement pas aussi programmables et rentables que le souhaiteraient certains courants de l’art contemporain – parfois très cyniques – qui ont souvent bien plus à voir avec la finance mondiale qu’avec l’art.
Suis-je bien légitime pour parler de cela ici ?
En attendant, au nom des photographes que j’ai évoqués, comme au nom de très nombreux autres confrères, je profite de ce moment où la parole m’est donnée publiquement pour dire mon attachement plus particulier à la photographie dite « humaniste ».
Celle à hauteur d’homme, celle qui, aussi adaptée, forte et novatrice qu’elle est actuellement, se trouve souvent injustement réduite soit au seul courant « humaniste » des années 1950, soit à une sorte de photographie compassionnelle un peu mièvre et qui, partant de là, en vient à être considérée par certains comme hors sujet, « ringarde » même.
C’est pourtant de liens humains, de société et d’implication personnelle dont il s’agit.
La photographie « humaniste » est lucide, critique, très porteuse de sens, d’utopie : de tout ce qui n’a pas de prix.
D’autres sensibilités, d’autres courants existent bien sûr. Heureusement !
Il en est tant désormais qui émergent, se fraient un passage, tracent des pistes, crèvent aussi parfois, comme des bulles. L’Académie doit y être très attentive. Elle doit les aider. C’est une de ses raisons d’être. Mais il s’agit alors de les repérer et de savoir les choisir.
Sur quels critères ?
C’est sans doute et en toute discipline ce qu’il y a de plus délicat à déterminer actuellement.
Tant de critères justement. Tant de postures aussi… voire d’impostures.
Aussi, pour conclure, je vous reprends à nouveau Paul. Vous dites souvent que les questions les plus importantes sont celles qui n’ont pas de réponses claires. Vous avez raison, nous y sommes : il n’y a pas de réponses claires mais il nous faut cependant répondre.
Pour le coup, en photographie, les présences et les expériences respectives des photographes dont je viens de parler auraient été très précieuses au sein de l’Académie des Beaux-Arts tant pour la maitrise, le talent et les valeurs qu’ils représentaient que pour tout ce qu’ils avaient su garder de leurs enfances, de leurs intuitions.
Leurs enthousiasmes, leurs doutes, leur lucidité et bien sûr leurs regards construits de tout cela.
Finalement, ils ont été qui ils devaient être.
« Los de qui cau », dit la belle langue Occitane : « Ceux qui sont ce qu’il faut qu’ils soient » Ils l’ont été.
Je les en remercie.
(1)
Seloua Luste Boulbina.
« Algérie Indépendance ». Éditions le bec en l’air. (Page 155)
« C’est en électron libre et en homme timide et solitaire que Marc Riboud voyagea en Algérie, dans des circonstances exceptionnelles.
Formé très précocement aux maquis du Vercors, le photographe pouvait-il, quelques années plus tard, être impressionné par les nouveaux maquisards ?
…..
On sent bien, dans les photos qu’il prit en Algérie, la proximité immédiate du reporter avec les sujets et les scènes qu’il immortalise.
Il n’a aucune connaissance particulière de la situation. Ce n’est pas intellectuellement, en effet, qu’il capte ce qu’il observe et qu’il sent ; c’est immédiatement, sans réflexion ni analyse, dans l’instant de voir, dans l’intuition de ce qui se passe….
Il n’est pas partisan dans un procès à charge ou à décharge : son travail n’est pas militant… Pour lui, montrer n’est pas prouver : c’est archiver…
Archiver, c’est mettre l’instant au service du futur. »
(2)
Michel Poivert
Gilles Caron. « Le conflit intérieur ». Editions Photosynthèses. (Page 372)
Le projet de Caron était celui de raconter autrement l’actualité, d’intégrer autrement ses propres sentiments sur l’humanité à la sténographie visuelle du photojournalisme.
Cette tentative de trouver une fréquence nouvelle entre l’extérieur et l’intériorité ressemble aujourd’hui à un avant courrier de la photographie d’auteur qui sera la marque de la décennie suivante.
Académie des Beaux-Arts – Institut de France
23, quai de Conti
75006 Paris
www.academie-des-beaux-arts.fr
Installation de Monsieur Jean Gaumy à l’Académie des beaux-arts
Discours de Monsieur Paul Andreu membre de la section d’architecture
Mercredi 10 octobre 2018
Pour écrire ce texte, celui du discours de votre réception officielle, aujourd’hui, à l’Académie des Beaux-Arts, j’ai gardé sous les yeux deux livres. Deux grands ouvrages. Tous les deux édités avec le même ami, Xavier Barral, dans une collaboration parfaite, qui vous vaudront deux fois le prix Nadar.
Pleine mer, c’est le titre du premier. Sur sa couverture, deux hommes sur le pont d’un bateau, celui du centre est la seule verticale dans l’image que l’eau traverse, oblique, d’une hachure grise. Sur la couverture du second, n’apparaissent ni le titre, D’après Nature, ni le nom de l’auteur, mais seulement, dans un gris général, un graphisme abstrait de lignes et de taches.
Je les ai parcourus à plusieurs reprises. Pour autant je ne les connais pas vraiment. Ils ont trop à me dire. Ils sont ouverts sur la table où j’écris. De temps en temps, de l’un ou l’autre, je tourne une page ; je réactive une surprise.
Pleine mer a été publié en 2001. Il rassemble un travail, qui s’est échelonné sur quatorze ans. Entre 1984 et 1998, vous avez embarqué quatre fois à bord des derniers chalutiers à pont ouvert, vous avez photographié ; les hommes dans l’espace restreint, inconfortable, des bateaux ; la mer et les oiseaux, toujours en mouvement ; les poissons arrachés au calme de la profondeur, morts ou agonisant. Un journal de bord précis, des cartes incompréhensibles à qui n’est pas marin, accompagnent les images. C’est un livre dense, sombre, tout entier pris dans l’immobilité des répétitions incessantes du déchainement des éléments, de l’épuisement des hommes, de la mort des poissons. Un livre beau, un livre bouleversant.
L’homme est absent dans D’après nature, le ciel aussi, presque toujours. Pas d’animaux, sauf erreur de ma part, sinon un cheval à la pose très énigmatique. Est-il mort, seulement assoupi, quoi qu’il en soit c’est très étrangement. Restent végétaux et minéraux, minéraux surtout. Rien qui exprime un changement perceptible. Le mouvement ne manque pas pourtant, mais il est tantôt figé dans le temps géologique, tantôt effacé dans celui de la prise de vue.
J’aimerais bien m’en tenir là, parler d’une image ou d’une autre, en allant au petit bonheur d’un livre à l’autre, en retrouvant dans ma mémoire des poèmes ou des musiques, en m’égarant comme Le sous-préfet aux champs. Le devoir me l’interdit, celui que j’ai vis-à-vis de vous, celui aussi que j’ai vis-à-vis de vos amis rassemblés ici. Ces deux livres sont importants mais quand bien
Ce sont, à bien des égards, deux livres opposés, mais, aucun doute, ils sont du même photographe, la densité des gris le dit, je crois, ainsi que la parcimonie des blancs. Le même photographe, fidèle à lui-même, à ses idées, à sa recherche, qui évolue, et dont la mélancolie, que le mouvement de la mer exaltait, ne disparaît pas, mais s’enfouit dans les plis des montagnes et le chaos des pierres.
même ils diraient tout de vous comme artiste, il serait malséant et injuste de ne pas évoquer tout le chemin dont ils ne sont que des jalons.
Vous avez fait bien d’autres choses. Vous avez fait des reportages, certains très longs, très engagés, sur des sujets dans lesquels peu d’autres s’étaient lancés, vous avez fait des films, des documentaires prolongeant souvent vos photographies, dont l’un surtout libère le mouvement. Vous avez aussi bon nombre de projets en cours ou en tête. Voyons un peu tout cela.
En évoquant d’abord le cadre professionnel dans lequel se sont déroulés vos travaux, celui des agences. L’agence Viva d’abord pendant un temps très court. En 1973, avec le parrainage de Raymond Depardon vous rejoignez l’agence française Gamma. En 1977 enfin, remarqué par Marc Riboud et Bruno Barbey, vous rejoignez l’agence Magnum, dont vous faites toujours partie. Comme d’autres alors, dans cette période où il existe une demande exigeante pour des reportages de toutes sortes, vous parcourez le monde. Dans combien de pays vous êtes-vous rendu ? Des dizaines, pourquoi compter ? Chaque fois cela aura été avec la même détermination de choisir vos sujets, d’aller au fond des choses, de ne pas chercher la confirmation d’une opinion déjà faite, ni même de répondre à une question trop précise, mais de donner à réfléchir. Vous partez sans autre intention que de regarder, de noter pour vous mais surtout pour les autres. On dit que vous
avez « un regard », je comprends que cela veut dire à la fois de la patience et une grande promptitude, que vous faites confiance aux formes et aux lignes sans les rechercher comme des ornements.
Et puis s’il a pu vous arriver d’aller là où on vous appelait, très vite vous n’êtes plus allé que là où vous décidiez vous-même, librement, d’aller vous interroger.
Vous irez plusieurs fois en Iran, vous y ferez des images qui témoignent de la sympathie que vous avez toujours pour ceux qui souffrent, et d’autres, une surtout, qui détournent l’intention de ceux qui vous ont autorisé à les faire.
Vous irez à Tchernobyl qui vous bouleversera. L’image d’un étang près de Tchernobyl le dit sans grandiloquence, sans désespoir.
De la misère physique des brancards de Lourdes à celle des corps privés même de vêtements dans la cour d’un hôpital psychiatrique au Honduras, vous ne tentez pas de tirer des témoignages provoquants mais simplement de dire en termes simples, avec une rigueur respectueuse de la beauté : voilà, regardez. Car bien sûr la beauté n’a jamais été de trop quand elle n’est pas consciente d’elle-même.
Je reviens un moment à ces deux livres ouverts sur ma table. J’en tourne les pages à nouveau. S’ils jalonnent si bien votre travail, c’est sans doute parce qu’allant au plus intime de vous, ils nous montrent la constance et l’honnêteté de votre engagement.
Le premier surtout. Pleine mer. Quatre voyages semblables, à bord des mêmes chalutiers, les derniers de leur type. Vous connaissez la mer, vous avez déjà embarqué. Qu’est ce vous cherchez ? Sans doute à retenir quelque chose qui disparaît ou, simplement, qui se transforme. Peut-être aussi à côtoyer ceux qui subissent le déchaînement de la mer, à éprouver vous-même physiquement la dureté de la mer. Vous n’êtes pas un de ces marins intrépides et indestructibles qui se rient des vents et des vagues, qui les convoquent pour les dominer. Vous avez le mal de mer, vous êtes malade. Pour l’être aussi à la seule pensée de me trouver sur l’eau, je mesure votre détermination. Plus que votre détermination, votre acharnement ; le 24 avril 1984, vous écrivez dans votre journal de bord :
….beau temps sur toute la France. Pas de chance, je déteste les tempêtes de ciel bleu. J’attends du temps pourri, des nuages anthracite…
Plus loin : Je ne veux que la pluie, le vent et la mer rageuse.
Vous photographiez quand la lumière bascule, quand tout est éphémère,- ce sont vos mots – quand l’eau
est partout, sature l’air, rend le sol dangereusement glissant, détrempe votre matériel.
Mais quoi ? Des paysages, fabuleux ou terrifiants, d’eaux et de ciels, traversés d’éclairs. Non. Vous n’évoquez pas William Blake ou Arthur Rimbaud, pas même Victor Hugo et ses héroïques Travailleurs de la mer. Vous photographiez avant tout ces personnes, ces marins aux visages marqués, creusés, impassibles le plus souvent. Vous les montrez, stables dans le mouvement général, triant ou éviscérant des poissons debout sur du pont, devant des établis, aussi calmes qu’ils le seraient à terre, et puis, entre deux tâches, fumant appuyés sur une paroi, mangeant, parlant, se couchant dans des « espaces de vie » cabossés à l’intérieur bruyant du bateau. Des héros ? Vous ne cherchez pas à nous le faire croire. Des gens, des gens avares de mots, solidaires en mer, qui, rendus à terre, se sépareront sans rien dire.
Comment vit-on dans l’enfermement, dans le confinement d’un travail ici, ailleurs dans celui d’une condamnation ou d’une maladie, ou encore dans celui d’une mission de sécurité nationale, voilà le sujet que vous n’avez pas cessé d’aborder. Dans ce livre, mais, avant lui, dans vos reportages sur les prisons et les hôpitaux et, plus récemment, quand vous avez passé quatre longs mois, au sein de la mer cette fois, dans un sous-marin nucléaire.
Vous le faites en mettant en œuvre des moyens techniques, des appareils, dont j’ignore tout. Je ne me hasarderai pas à décrire ou à commenter l’usage que vous en faites. Comme tous les photographes, vous vous les êtes appropriés, de cela je suis certain, assez pour qu’ils servent fidèlement vos désirs sans vous contraindre. Nous en sommes tous là, en ces temps de progrès techniques incessants et de modes tapageuses, à les utiliser, ces moyens nouveaux, sans en refuser aucun, mais en nous défiant de tous, conscients que ces outils serviteurs sont toujours prêts à s’imposer en maîtres. Vous n’hésitez pas à rechercher ce que le téléphone portable peut vous apporter. Mais, pour autant que je sache, vous êtes fidèle au noir et blanc. Question de génération, dites-vous dans une interview. Je n’en suis pas si sûr, pour ne pas apprécier beaucoup moi-même l’usage immature et débridé de la lumière et des couleurs. Mais laissons cela. Mon incompétence autant que ma faiblesse à défendre mes convictions éclaterait trop vite.
Je n’ai rien dit encore de vos films. Mon embarras est grand pour en parler. Peut-être parce qu’ils ne se tiennent pas docilement sur ma table pour me laisser les interroger. Je les ressens comme un prolongement de vos photographies. Vous me répondez que j’ai tort, qu’ils sont un complément, une cour de récréation parallèle.
Dans une interview je lis qu’à l’origine il y a votre désir de capter le réel, que vous avez d’abord enregistré des sons, que la photographie est venue ensuite, qui très vite vous a plu. Qui vous a pris. Les films ont suivi. Ils sont venus comme l’écho d’une vérité plus profonde.
Quand on vous interroge sur ce qui vous a préparé à prendre le chemin que vous parcourez, vous parlez très vite du cinéma. Celui d’abord qui, dans l’enfance, vous entraîne, vous plonge, pour toujours, dans le monde de l’image. Les films de Flaherty, Nanouk l’Esquimau, L’homme d’Aran. La grande aventure de Sucksdorff. Napoléon, de Gance. Et puis bien d’autres, des films de science- fiction. Prémonitoire, Vingt mille lieues sous les mers…
C’est en 1983 que vous passez le pas. Vincent Pinel et Christian Zarifian, qui dirigent l’Unité Cinéma de la Maison de la culture du Havre, vous incitent à retourner dans ces ateliers, vers ces ouvrières surtout, que vous aviez photographiées en 1972, mais cette fois pour faire un film. Vous acceptez. C’est en couleurs que vous travaillez, mais en restant fidèle à votre habitude de vous tenir proche de votre sujet, à trois mètres, à cinq mètres de ces ouvrières, ces « filetières », que vous retrouvez, vous dites quelques mots avec elles, rien ne les distrait vraiment quand elles découpent les harengs en quatre coups de couteau rapides, toujours les mêmes, mais quand elles se préparent au travail ou le quittent, elles ne retiennent ni leurs petits sourires ni leurs brefs regards à l’objectif, leurs mots, leurs plaisanteries. Alors s’établit entre vous la familiarité, la résonance que vous recherchez, une empathie fondamentale.
Jean-Jacques, et Marcel, prêtre, tournés respectivement en 87 et 94, continueront dans la même direction mais en s’attachant chacun à une personne. Une personne, pas un personnage.
Rien de scénarisé non plus dans ces deux films.
Jean-Jacques, c’est l’ « idiot du village ». Vous le filmez pendant deux ans, vous saisissez sur son visage la succession sans fin des sourires et des grimaces, de l’abandon heureux et de l’inquiétude insurmontable, vous le regardez, vous l’écoutez, vous rendez compte de ce qu’était, de ce qu’est peut-être encore, un village, un lieu où les plus démunis ont une place. Votre film lui fait une place ; le rend utile et, sans doute aussi, nécessaire.
Marcel est le prêtre qui était le Préfet de discipline dans l’Institut Saint-Eugène où vous étiez élève à Aurillac. Vous le retrouvez et vous commencez à le filmez dans sa vie de prêtre d’une paroisse d’Auvergne. Il est fatigué mais toujours ferme dans ses pensées.
Un jour il vous appelle, vous demande de venir le voir, à Aurillac, il y est revenu. Il est à l’hôpital. Vous arriverez trop tard, il est mort quelques heures avant. Vous filmez son enterrement, le cercueil que l’on charge dans le corbillard, la foule qui s’ébranle pour le suivre. Le film s’arrête sur la photographie, en noir et blanc, de son visage grave, creusé, apaisé. Cette photo, et le film tout entier, sont le « tombeau » que, sans l’avoir prévu, vous lui édifiez.
Dans celui qui est à ce jour votre dernier film, Sous-marin, vous revenez aux thèmes auxquels vous vous êtes attaché si souvent, celui de l’enfermement et celui de la mer. Vous embarquez sur un sous-marin nucléaire. Vous vivrez en la filmant la vie de l’équipage qui effectue une mission de quatre mois dont l’essentiel se passera dans le silence et le secret des profondeurs. Les équipages sont préparés pour de telles missions, pas vous. Dans le sous-marin, l’espace est compté, c’est le moins qu’on puisse dire, vous avez dû avoir du mal à trouver pour filmer un lieu où vous disposiez de cette distance, ailleurs si intime, de trois mètres cinquante ! La vie est très strictement organisée, monotone. De tout cela vous tirez parti parce qu’à nouveau ce sont les personnes que vous regardez avec empathie. Le commentaire – vous ne l’avez pas confié à « une voix », c’est vous que l’on entend – donne les informations nécessaires sans pathos ni emphase, laisse la place aux dialogues de l’équipage.
Il m’a semblé que vous étiez sorti éprouvé de ces quatre mois de navigation jusqu’au cercle polaire et retour et que vous avez repris sans déplaisir la série de paysages que vous aviez entamée avant votre départ.
Vous m’avez bien dit, j’en suis sûr, que les films étaient pour vous, « un complément, la cour de récréation parallèle ». En êtes-vous vraiment certain ? En tout cas vous voilà Peintre officiel de la Marine. Victoire de la photographie et du film sur la peinture ? Ou simple reconnaissance de ce que la division en sections de l’art a perdu de son évidence ?
Je reviens à vous, et à la photographie. Alain Bergala a beaucoup écrit sur votre travail, avec une connaissance profonde de ses moments et de sa continuité. Je le cite plutôt que de le paraphraser. Il écrit dans l’introduction du livre 128 de la collection Photo poche qui vous est consacré :
Que ce soit dans une prison, sur un chalutier, dans un hôpital psychiatrique, dans une vallée du Piémont italien, Jean Gaumy est avant tout un homme aux prises avec l’énigme ; un étonnement un peu buté et enfantin : c’est ça un cheval, c’est ça un homme enfermé par les autres hommes, c’est ça un fou, c’est ça un thon !
Et plus loin :
Cette part d’enfance qu’il y a dans ses photos est soigneusement protégée derrière des sujets rares, et vient contre toute attente du cinéma.
Plus loin encore :
Les images fortes du réel emportent toujours une part secrète qui vient nous parler en sourdine, sous la surface des choses captées.
Il me faudrait citer le texte entier… En découpant ainsi ces phrases dans lesquelles je vous trouve et qui me touchent, je le trahis sans doute un peu. L’auteur me le pardonnera j’espère.
Ces phrases me touchent par leur justesse à votre égard, mais aussi par ce qu’elles ont de général ; les secrets de l’enfance, ravissements ou terreurs, bonheurs ou tristesses, décident du désir initial d’un artiste, et le ravivant constamment, accompagnent toute sa vie.
Vous n’aimez pas trop ce mot d’artiste. Trop galvaudé à vos yeux, mondain, menteur. Eh bien vous devriez changer. C’est un mot magnifique, vous le savez, et ceux qui s’en servent avec une pitoyable suffisance n’arrivent pas à l’amoindrir.
Un artiste est quelqu’un qui a la folie de croire qu’il peut, après tant d’autres, avec tant d’autres, apporter quelque chose de neuf au monde – une création – et qu’il la donnera en partage. Être un artiste, c’est un désir sans fin, un espoir jamais satisfait, jamais comblé. Ce n’est pas un état établi dont on pourrait se vanter. Vous le dites bien dans vos interviews ; il ne faut pas faire le malin.
C’est le photographe, c’est l’homme, c’est l’artiste, que nous accueillons aujourd’hui, sans faire, nous non plus, les malins, dans cette ancienne académie des Beaux-Arts, ouverte aujourd’hui au cinéma et à la photographie, bientôt à d’autres arts, même si elle doit, pardon de glisser ici une opinion toute personnelle, renoncer pour le faire à la rigidité des sections.
Prenez cette cérémonie d’aujourd’hui comme une reconnaissance de votre travail de création, mais surtout comme une invitation à détourner désormais une part de votre énergie au service de la création en général.
Nous ne sommes pas, nous ne voulons pas être, une tribu à l’habillement étrange, miraculeusement préservée. Pas davantage un club d’anciens combattants, des gardiens du temple, ou un institut d’évaluation ou de prévision. Seulement un groupe de personnes dont l’expérience et l’engagement doivent aider à ce que la création reste libre, à ce que les créateurs, tous, mais surtout les plus jeunes, soient eux-mêmes libres, reconnus, correctement rémunérés.
Cher Jean Gaumy, que j’ai appris à mieux connaître en préparant ce discours, je ne doute pas que vous nous aiderez, vous qui avez tant interrogé l’enfermement sous toutes ses formes, dans notre effort permanent à le combattre et répondre à notre mission.
Ils doivent vous sembler bien loin ces moments que fixent les photographies que vous avez retrouvées et précieusement conservées. Certaines datent de 1880, ce sont vos arrière- grands- parents qui les ont prises, chaque génération a poursuivi, les plus récentes sont celles prises par votre mère, votre père, vos tantes et vos oncles. Tous aimaient faire des photos. C’est bien peut- être là l’origine du chemin d’imprévus que vous avez parcouru, qui passe aujourd’hui par ce lieu où nous sommes rassemblés et qui vous réserve encore, nous n’en doutons pas, bien de nouvelles découvertes.