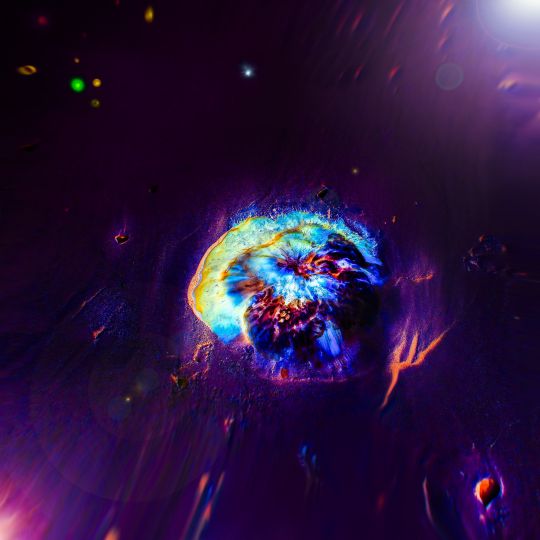Il s’appelle Diego Goldberg.
Il est argentin. Il est l’un des plus formidables photo journalistes et photographes de sa génération.
Il est l’un des très rares a avoir été accepté dans l’intimité de François Mitterrand. Il a aussi ce regard implacable sur la photographie aujourd’hui.
Cette édition lui est dédiée.
Jean-Jacques Naudet
Diego Goldberg par Eliane Laffont
Je connais Diego depuis plus de 30 ans. Depuis ses débuts en tant que correspondant en Amérique latine pour l’agence de photo française Sygma, puis en tant que photographe personnel de Sygma à Paris et plus tard, alors que j’étais directeur de Sygma aux États-Unis, travaillant avec moi à New York.
Je voudrais souligner plusieurs aspects de son travail et de sa personnalité:
a. En tant que photographe, j’ai toujours admiré son sens aigu de la composition – strict, parfaitement équilibré, toujours un moyen de livrer un point de vue particulier – et le développement d’un style personnel et reconnaissable, quelque chose d’assez inhabituel.
b. En tant que photojournaliste, il a toujours eu une compréhension profonde des problèmes qu’il devait traiter, où qu’il se trouve dans le monde. Il a toujours été intéressé par le «théâtre de la politique» et par les nombreuses histoires qu’il a couvertes dans différents pays, il a essayé de développer précisément cet angle. Ce qui est probablement son travail le plus connu, la campagne et la présidence de François Mitterrand en est un exemple clair: il obtint un accès privilégié au personnage et, de ce point de vue privilégié, développa un portrait durable de l’une des importantes personnalités politiques du monde politique du siècle dernier.
c. Ses intérêts multiples l’ont amené à d’autres activités connexes dans notre domaine. Éducative, dans de nombreux ateliers et spécialement dans les Masterclasses du World Press Photo; membre respecté du jury des plus importants concours photo, dont dernièrement en tant que président du jury du World Press Photo et également comme éditeur pendant ses six années de travail à la direction de la photographie pour Clarin, le journal argentin.
Toutes ces activités et expériences ont fait de Diego une personnalité unique dans la communauté photographique internationale. Après Clarin, il a repris sa carrière en travaillant sur des projets à long terme, en prenant du recul par rapport aux urgences et aux contraintes de la presse. Son dernier projet, « Chasing the Dream », entrepris pour les Nations Unies est un bon exemple de cette nouvelle direction. Complexe, magnifiquement photographié, couvrant une histoire complète, il montre également son engagement à utiliser la photographie comme outil pour communiquer et comprendre les problèmes du jour.
Eliane Laffont
Diego Goldberg – 1970’s
Il y a quelque temps, pour la première fois depuis près de 45 ans en tant que photojournaliste, j’ai pu enfin voir tout ce que j’avais fait et vécu lorsque tout mon travail, stocké en France, m’a été rendu. Certaines images m’ ont également prouvé de manière irréfutable que la mémoire nous joue des tours: souvent, les choses ne se sont pas passées comme je m’en souvenais. En revisitant le travail, j’ai trouvé de nombreuses images importantes qui n’avais jamais été sélectionnées ni utilisées: ce fut une expérience exaltante de pouvoir réaliser moi-même le montage du travail le plus intéressant que j’avais réalisé.
En même temps, cela m’a obligé à repenser ce qui est arrivé à notre profession en cette période de changements tectoniques avec la disparition de la plupart des agences de photographie emblématiques du passé, Internet, la numérisation et un appareil photo dans chaque poche: la «fin du monde “tel que nous le connaissions.
La première chose à mentionner est que ces agences photo (Sygma, Gamma, SIPA, Black Star, Contact, etc.) étaient des entreprises américaines / européennes. Les photographes américains et européens se nourrissant principalement de la presse occidentale. Un groupe d’hommes et de femmes triés sur le volet et talentueux qui parcouraient le monde, débarquant quelques jours sur des terres étrangères comme des anthropologues sur Mars. Et ensuite vers le prochain arrêt. Les projets de livre «Day in the Life» dans différents pays nous ont réunis la plupart pendant quelques jours, ce qui prouve à quel point nous étions peu nombreux.
Terres étrangères signifie cultures étrangères et il aurait été impossible de comprendre et donc de décrire ou de documenter les réalités différentes et riches que les photographes locaux connaissaient mieux que quiconque, spécialement pendant les quelques jours de commandes.
Ce n’est pas une critique: je ne fais qu’énoncer des faits et tenter d’éclairer un moment très important du développement du photojournalisme qui a eu une telle influence dans le monde entier. Mais la réalité est que c’est un phénomène américain / européen qui a fourni des histoires aux médias occidentaux.
Je viens d’un pays du tiers monde et cela m’a fait prendre conscience que le reste du monde vivait dans un univers parallèle: divers et très riche. Il y avait des milliers de journaux et de magazines et des milliers de photographes dans le monde salariés ou free lance. Et donc le photojournalisme était bien plus que quelques privilégiés et leur travail parfois extraordinaire.
Il est indéniable que tout le travail réalisé par ces photographes «inconnus» n’était pas toujours de grande qualité: la plupart de ce qu’on attendais d’eux dans les différentes salles de rédaction n’était qu’une confirmation visuelle de l’existence réelle du texte décrit. Comme je l’ai souvent dit, ils étaient les archivistes des événements couverts, pour donner l’ illustration nécessaire pour une mise en page des plus attrayantes. Très rarement, ils ont fourni un point de vue complémentaire et personnel à l’histoire pour enrichir son contenu.
En 1996, en pleine crise (photographique) personnelle , j’ai accepté le poste de directeur de la photographie de Clarin, un journal argentin dont le tirage était le plus important dans tous les pays hispanophones. Après six ans de collaboration avec plus de 50 photographes (salariés et pigistes ), il m’est apparu que quelque chose dont on discutait rarement lorsqu’on abordait les problèmes auxquels le photojournalisme est confronté aujourd’hui est le rôle de l’éditeur photo.
La presse écrite est en proie à des rendements décroissants, à un lectorat réduit, au passage au Web, etc. Le revers de la médaille est que, dans le monde numérique, il y a plus d’espace avec un coût supplémentaire négligeable pour une utilisation intelligente de la photographie. Et voici le maillon le plus faible de la chaîne: des monteurs d’images créatifs, audacieux et prenant des risques qui peuvent faire progresser l’utilisation du travail que beaucoup de photographes sont plus que jamais capables de produire.
C’est une grave erreur de croire que la seule tâche des éditeurs d’images est de choisir des images. Ils sont les gardiens et il leur incombe de promouvoir, élever, attribuer et utiliser de bonnes photographies. Tout n’est pas sombre, il existe de nombreux exemples qui méritent d’être suivis et je n’en citerai qu’un: le New York Times. Ils ont adopté de tout cœur le Web, exploité la myriade de possibilités offertes par le monde numérique et utilisé la photographie de manière créative, en développant un langage qui enrichit la tâche journalistique à accomplir. Et en cela, évidemment, le travail de leurs éditeurs d’images est essentiel.
Un appareil photo dans toutes les poches. C’est une réalité nouvelle et extraordinaire: jamais autant de personnes n’ont produit autant d’images. On m’a souvent demandé s’il s’agissait d’un danger pour l’avenir du photojournalisme. Tout le monde peut prendre une photo avec les outils modernes disponibles, mais cela ne signifie pas qu’ils peuvent interpréter le monde, développer un point de vue personnel ou maîtriser la langue. En ce sens, je cite toujours l’exemple de l’avènement de l’alphabétisation. Tout le monde sait lire et écrire, très peu sont écrivains ou journalistes.
Chaque jour, d’innombrables images sont utilisées dans toutes sortes de publications dans le monde entier. Le fardeau d’utiliser notre expertise, notre talent et nos connaissances pour raconter les histoires que nous jugeons pertinentes pour la communauté nos incombe, photographes et éditeurs d’images. C’est un combat qui vaut la peine d’être combattu.
Les années 1970 ont été la décennie d’apprentissage. Je viens d’un monde éloigné du photojournalisme avec mes études, d’abord en physique, puis en architecture. La photographie n’était qu’un passe-temps que je pratiquais pendant mon temps libre. Ce qui était en croissance au cours de cette période (60), c’était mon intérêt pour le monde entier, le besoin de voir, de voir par moi-même et de raconter des histoires.
Et puis et l’épiphanie. Au cours de ma dernière année d’études d’architecture, j’ai soudainement compris que j’avais peu de talent pour exercer ce métier. Vivant en Argentine, mes contacts avec le monde se faisaient par le biais de magazines et du travail de photographes que j’admirais. Bientôt, ce fut le rêve que j’ai commencé à chasser.
Je n’ai jamais travaillé dans la presse locale, qui était assez vivante à l’époque, avec de nombreux journaux et magazines, mais mes espoirs se situaient ailleurs. Je me suis directement adressé à des correspondants étrangers et j’ai eu des missions d’un jour de temps en temps. J’ai établi un contact avec Camera Press, l’agence photo britannique, et commencé à voyager et à couvrir des événements dans différents pays d’Amérique latine.
Puis, en 1974, la nouvelle agence Sygma, après avoir vu certains de mes travaux dans des magazines européens, m’a donné la possibilité de travailler en tant que correspondants dans les pays d’Amérique latine. Et ainsi a commencé ce long voyage….
En 1976, une frustration énorme: la plupart des pays d’Amérique du Sud étaient dotés de dictatures militaires et ce qui se passait n’était pas visible: des milliers de personnes ont disparu, ont été tuées ou torturées. Une réalité incroyable que je n’ai pas pu documenter en tant que photographe. Hubert Henrotte, responsable de Sygma, a eu connaissance de ces réflexions et il m’a proposé de rejoindre l’équipe de photographes parisiens.
C’est ainsi qu’a commencé un nouveau chapitre: changer de pays, former une famille (voir La flèche du temps) et accumuler des expériences.
Diego Goldberg