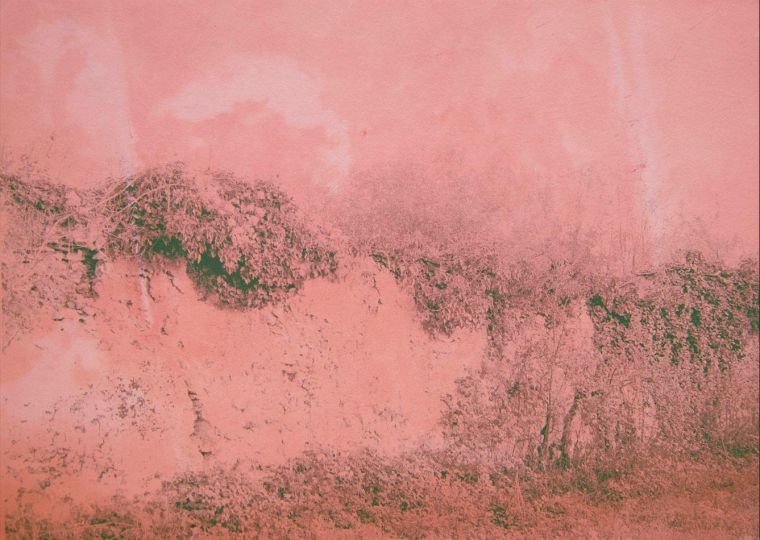Son nom : Bertrand Cardon. Il est photographe. Enfermé chez lui ces dernières semaines, il a ouvert ses archives. Et là, il a retrouvé de merveilleuses images d’un grande dame de la photographie de mode : Deborah Turbeville avec qui, durant 35 ans il partagea une profonde amitié ! Il raconte :
C’est un jour de mai, en 1981, déjà période historique, que Rénate Gallois-Monbrun m’appelle pour me demander si j’accepterais d’assister l’une de ses photographes représentée par elle et venant à Paris pour réaliser un sujet pour Vogue US. Je travaillais déjà en free-lance pour Rénate et ses photographes, Eva Séréni, Sarah Moon, Deidi Von Schwaven, et autres..
Bien sûr, c’était mon vrai métier de l’époque, d’assurer la production, la régie, la lumière, les repérages et la responsabilité de la réussite du shooting jusqu’à la sortie des films au labo. ( Hommage, en passant, à Georges d’Iconolab , dans le Marais, qui faisait des merveilles)
J’y étais habitué. Nul stress pour moi qui avait travaillé en studio à « Clic-Clac» rue Daguerre ( Aujourd’hui Daguerre studios ) comme grouillot au début, puis studio manager quand je les ai quittés.
Plein de souvenirs de plateaux avec Helmut Newton, André Carrara, Peter Lindberg, même une session en studio avec Horst qui était déjà très âgé. Et puis toute une semaine en cyclo avec Dick Avedon pour les collections ( j’ai oublié l’année).
Quelles meilleures expériences sur le tas pour un très jeune passionné d’image photographique comme moi dans ces années 70-90.
Ces rencontres m’apportaient, m’enseignaient plus par leur créativité artistique, leur univers singulier reposant sur une histoire de l’Art qui me manquait, que sur la technique, qui souvent leur manquait.
Ainsi a démarré ma complicité avec ce premier shooting avec Déborah à Paris. Puis huit années de collaboration étroite. Une vraie amitié aussi. Nous n’avions presque plus besoin de parler. Je connaissais son univers, elle savait que je le connaissais et le partageais.
Nous avions cette relation privilégiée, hors mode de représentation face aux médias et donneurs d’ordres.
Je me souviens que souvent, lors de voyages en Europe, à travers les palaces réservés par le groupe Condé Nast, Déborah me disait :
Bertrand, tu ne dis rien..On se tire manger tous les deux dans un boui-boui du cru. Car toute cette représentation permanente de son image lui pesait. Tous ces faux-semblants étaient loin de l’intéret qu’elle portait à ses créations et ce pourquoi elle était là.
Tout cet univers de la mode , des rédactions prestigieuses, pourtant qui l’ont fait naître en tant que photographe et artiste, auxquels elle a collaboré aussi comme rédactrice ont fini par la lasser en tant qu’échanges humains.
Son achat de sa maison au Mexique a été une bouffée d’oxygène pour elle, un retour aussi artistique à la simplicité des choses et des êtres.
30 années après notre collaboration des années 80, nous conversions toujours, échangions toujours. J’étais allé la visiter à New-York. Elle m’avait emmené dîner Downtown dans un petit restaurant où Woody Allen avait l’habitude de venir jouer de la clarinette.
Nous avions cette relation qui dépasse la notoriété, cette complicité pour la passion de l’image. En fait, une amitié complice dans laquelle nous nous retrouvions.
Dans nos voyages, nous parlions plus de cinéma, de peinture, d’histoires triviales que de photographie.
J’ai le souvenir de Déborah qui paraissait froide, distante, fantomatique dans ses tenues pour beaucoup de personnes. Mais qui dans l’intimité avait encore la spontanéïté de l’enfance et le sens de l’humour.
Je me souviens de ce soir là, au Danieli à Venise, où elle m’a appelé dans ma chambre pour me dire : Ce dîner avec toute l’équipe de Vogue US me gonfle, on part ensemble, on les laisse, on ne dit rien et on va dans les ruelles de Venise trouver un bar d’ouvriers pour y manger des calamars à l’encre.
Nous l’avons fait. Elle était comme une enfant ayant fauté bien volontairement. On s’est bien amusés, en pensant à la rédactrice de Vogue qui devait se dire : On a perdu Déborah pour le shooting de demain.
Une autre fois au Château de Vaux le Vicomte, toujours pour vogue US, La limousine de Vogue attendait Déborah rue Delambre, à l’Hôtel Lenox. Je devais les y rejoindre et filer vers le lieu de shooting. Arrivés, répérages faits, Coiffures et maquillages lancés, la rédactrice, un peu stressée demande à Déborah : Mais où sont vos valises de caméras ? Déborah vient me voir et me dit – Oh, Bertrand, je les ai oubliées à l’Hotel – Heureusement que j’avais toujours sur moi mon vieux Nikkormat avec un 50mm 1:8.
C’est un peu aussi l’histoire d’Helmut Newton à Clic-Clac, rue Daguerre, arrivé un jour des annees 80 sur le plateau prêt à shooter, toute l’équipe de Vogue en attente fébrile, avec juste un KODAK INSTAMATIC autour du cou. Rédactrice toute verte..!
Toutes ces histoires et anecdotes me ravissent car finalement, ce n’est pas moi, ni le support technique qui font l’image finale. C’est vraiment l’univers artistique, créatif, intérieur de l’auteur. La réalisation y participe seulement.
Et puis en 1987 sur une commande du magazine Globe ( enfant chéri culturel de F Mittérand) Déborah Turbeville, sollicitée pour réaliser un reportage mode sur la jeune génération de chanteurs d’opéra au Palais Garnier avec sa signature m’appelle au matin du deuxième jour de shooting en me disant : «Oh, Bertrand, dis leur que j’ai le dos bloqué et ne peux venir. Fais les images à ma place. En fait je ne le sens pas, ce sujet n’est pas pour moi.» Malaise..le matin du 2ème jour au Palais Garnier. J’appelle le directeur artistique du magazine. Que fait-on ? Il accepte que je continue les images du reportage. Toute l’équipe prête et les artistes d’opéra ne sont pas des gens faciles. La boule au ventre, mais porté par l’ambiance, je me lance dans d’autres images du deuxième jour. Avec le film et émulsion culte du travail de Déborah : la 3M 1200 Iso. Le résultat sera validé par la rédaction pour publication. Mais avec la signature attendue : Déborah Turbeville.
Déborah insistera pour co-signer cette série ensemble. Elle sera vraiment la seule personne de mon parcours qui m’aura vraiment encouragé à la quitter pour développer mon propre langage.
Je lui garde une éternelle reconnaissance et amitié pour cela.
Bertrand Cardon