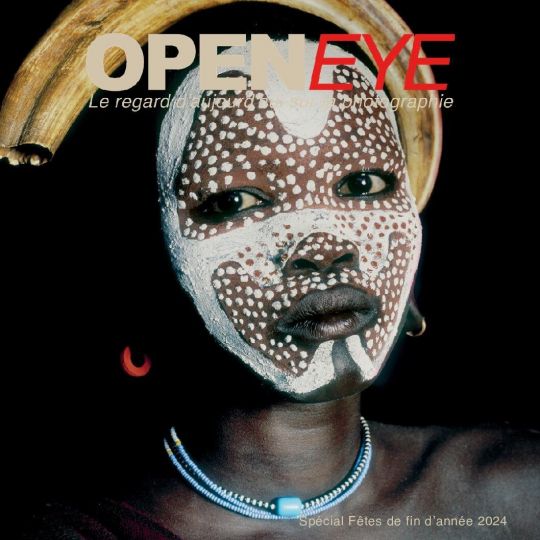Au début du XIXe siècle, au Canada, des pensionnats d’enfants amérindiens ont été créés pour éradiquer la culture des Premières Nations, et cela par tous les moyens. Les résidents de ces institutions répressives étaient punis quand ils parlaient leur langue maternelle ou pratiquaient leurs traditions, régulièrement agressés sexuellement et physiquement et, dans certains cas extrêmes, soumis à des expérimentations médicales et à des stérilisations. Le dernier pensionnat a été fermé en 1996. Après près de deux siècles de tels traitements, des générations de Premières Nations du Canada ont perdu leur identité et leurs langues. « En bref, ces écoles avaient l’intention de blanchir ou d’assimiler de force des enfants amérindiens qui avaient été arrachés à leurs réserves. En plus de cela, il y a eu des abus physiques et sexuels generalisés », explique la photographe Daniella Zalcman qui vient de publier chez FotoEvidence une série de portraits à double exposition qui explorent le traumatisme de quelques-uns des 80 000 survivants.
Malgré la généralisation massive de ces pratiques barbares, ce chapitre a été complètement effacé des livres d’histoire. « Ce système scolaire existait également aux États-Unis. Que nous n’ayons pas pu raconter cette histoire terrible me semblait un énorme échec des gouvernements nord-américains, des systèmes éducatifs et des medias », poursuit Zalcman. « Je me suis enfui 27 fois. Mais la GRC nous a toujours retrouvés. Quand je suis sorti, je me suis tourné vers l’alcool. Je buvais pour effacer ce qui m’était arrivé, pour neutraliser ma colère, pour faire face à ma douleur, pour oublier. C’était facile de finir en prison parce que j’y avais déjà été », explique Marcel Ellery, un ancien élève du pensionnat indien Marieval de 1987 à 1990.
Sans vraiment reconnaître la gravité de la situation, le gouvernement canadien a publié ses premières excuses officielles en 2008. « Au Canada, ce qui m’a le plus frappé, c’est que le taux de VIH parmi les populations indigènes est l’un des plus élevés au monde et que le taux d’infection continue de croître à une vitesse élevée. Quand j’ai lu des revues médicales et des articles avant mon arrivée, je n’ai trouvé aucune explication. Ensuite, je me suis rendu compte que tous les amérindiens du Canada vivant avec le VIH auquel je parlais était allé à un pensionnat et que presque rien n’avait été écrit à ce propos », poursuit Zalcman. « J’ai été violée à l’école. C’était un vieil homme, le concierge. Je ne l’ai dit à personne depuis des décennies, parce que je pensais que les gens me jugeraient. La seule personne à qui je l’ai jamais raconté était ma mère [qui était allée à la pension de Muskowekwan]. Elle m’a juste répondu, « C’est comme ça que j’ai été élevée moi aussi », raconte Seraphine Kay, résidente du pensionnat indien Qu’Appelle de 1974 à 1975.
« La double exposition ajoute un niveau supplémentaire à l’histoire que je raconte », explique Zalcman. « C’est une histoire qui parle du passé et de la mémoire et pour moi, une série de portraits ne suffirait pas à la raconter. J’ai créé des expositions multiples en combinant des portraits et des sites liés aux expériences des anciens élèves. » Les témoignages qui accompagnent chaque portrait aident aussi à plonger plus profondément dans le vortex complexe du traumatisme. Etant donné que le gouvernement canadien a récemment créé la Commission “Truth and Reconciliation” qui vise à éduquer les enfants sur ce qui s’est passé dans les pensionnats, la documentation de Zalcman pourrait constituer un important matériel pédagogique. « Beaucoup d’enfants apprennent mieux avec des outils visuels et comprennent mieux les histoires individuelles qu’une histoire sèche et généralisée », dit-elle. Et exposé comme il l’est à la Galerie Anastasia à New York, jusqu’au 15 janvier, son travail démontre les possibilities du langage documentaire. « Est-ce que mon travail de double exposition est du reportage ? Peut-être pas. Est-ce du journalisme ? Je le pense. De plus en plus de gens sont d’accord avec moi pour élargir la définition du reportage. Ce n’est pas du tout du photojournalisme, mais c’est une narration, qui possède une force incroyable.»
Laurence Cornet
Laurence Cornet est journaliste spécialisée en photographie et commissaire d’expositions indépendante basée à New York.
Daniella Zalcman, Signs of your Identity
Publié par FotoEvidence
55 $
Http://fotoevidence.com/book/25/hard-copy
Http://www.anastasia-photo.com/daniella-zalcman-signs-of-your-identity