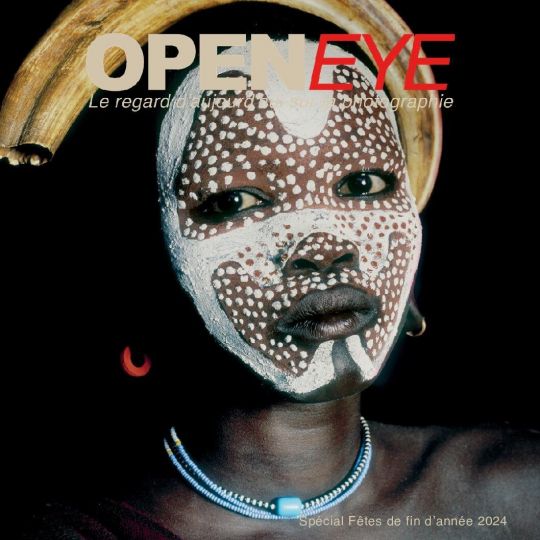Par Alison Stieven-Taylor
Pour ceux d’entre nous qui travaillent dans le journalisme, le mythe du photojournaliste chevalier qui se précipite vers un conflit avec zèle est bien établi. Le célèbre commentaire de Robert Capa sur le fait que les photographes doivent se rapprocher de l’action pour prendre la meilleure photo fait partie du folklore de l’industrie. Don McCullin a parlé de la poussée d’adrénaline de la guerre, assimilée à la toxicomanie. Les fantasmes de Tim Page pendant la guerre du Vietnam ont été immortalisés dans la culture pop, le personnage de Dennis Hopper dans le film Apocalypse Now est inspiré du photographe britannique. Pourtant, bien que certains soient célèbres honorés, la grande majorité des photojournalistes de conflit travaillent en arrière-plan, s’engageant à couvrir certains des moments les plus sombres de la planète, à témoigner de l’histoire, en grande partie invisible pour le monde extérieur. La gloire et l’argent ne les motivent pas. En fait, il est plus difficile que jamais de joindre les deux bouts. Alors, qu’est-ce qui pousse un individu vers le front ou à documenter les profondeurs de la misère humaine?
Cet axe de recherche est au cœur du nouveau livre de Lauren Walsh, Conversations on Conflict Photography, dans lequel le conflit est défini comme une guerre et une crise, des inégalités sociales, des catastrophes naturelles et des urgences humanitaires. Richement illustré de 110 photographies couleur et N & B, le livre de 376 pages est divisé en trois catégories: derrière l’objectif, dans la salle de redaction et au-delà. Un essai écrit par Walsh précède chaque section, suivi d’une série d’entretiens.
Dans Conversations, le lecteur trouve un équilibre parfait entre articulation académique – Walsh enseigne à New York, à la New School et à la New York University, où elle dirige le laboratoire de photojournalisme de la Gallatin School – ainsi que des révélations personnelles. Cette combinaison fonde le livre sur la rigueur académique tout en offrant une lecture perspicace et engageante. Le livre commence par une conversation entre Walsh et un de ses étudiants qui se demandait pourquoi on devrait s’attendre à ce qu’il réagisse à la souffrance d’un autre, en particulier lorsque la photo l’avait mis mal à l’aise. Walsh a vu dans ce commentaire «la genèse d’une recherche visant à mieux comprendre la valeur de la photographie de conflit aujourd’hui, en particulier du fait qu’elle est perçue par ses créateurs et ses distributeurs».
Derrière l’objectif
La première section, intitulée «Derrière l’objectif », présente des entretiens avec des femmes et des hommes qui ont risqué leur vie pour témoigner, dans le but de révéler leurs intentions. Walsh a mené des entretiens de 2014 à 2018 avec les photojournalistes Andrea Bruce, Marcus Bleasdale, Susan Meiselas, Shahidul Alam, Ron Haviv, Spencer Platt, Eman Helal, Benjamin Lowy, Nina Berman, Alexander Joe, Laurent Van der Stockt et Newsha Tavakolian.
Dans les révélations de ce qui pousse quelqu’un à abandonner le confort d’une vie largement privilégiée pour mettre en lumière les injustices, il en résulte une plus grande compréhension et un respect bien mérité, mais souvent absent. Le photojournalisme est toujours, après plus d’un siècle, un élément crucial dans les reportages, le cousin pauvre du journalisme spécialisé, ce dont témoigne Maryanne Golon, rédactrice en chef adjointe et directrice de la photographie au Washington Post. L’absence apparente de valeur de la photographie dans la chaîne d’information est évidente dans les réductions globales, voire l’élimination totale, des services de photographie en personnel dans les organes de presse des États-Unis. Des reporters armés de téléphones portables sont censés prendre des photos pour illustrer leurs histoires. L’importance de la compétence photographique, non pas en tant que technique, mais en tant que moyen de vision, est souvent perdue dans un monde où chaque personne munie d’un appareil photo est soi-disant un photographe. Le travail de Walsh jette un pont nécessaire entre cette hypothèse et la réalité de ce que signifie être photojournaliste.
Il est important de noter que ce livre dresse un portrait du photojournalisme qui humanise et élève la profession, en donnant un aperçu de la façon dont ces photographes pensent, de la profondeur des recherches qu’ils entreprennent avant d’appuyer sur le déclencheur, de leur empathie pour ceux qu’ils photographient, de leurs frustrations et du bilan personnel de leur travail. Beaucoup révèlent qu’ils souffrent du syndrome de stress post-traumatique (TSPT), certains luttant avec ces démons bien avant que le TSPT ne soit reconnu par l’industrie.
Au travers de questions inspirées par ses propres observations sur le photojournalisme et les changements sismiques de l’industrie, elle déplace habilement la discussion au-delà des critiques du photojournalisme en tant que produit de l’information afin de présenter un récit très personnel. Les photographes sont rarement crédités pour leur érudition, mais ces entretiens témoignent d’une connaissance approfondie de la politique, de l’humanité et du monde, sans parler de l’histoire de l’art et du rôle du visuel dans la communication des grands problèmes de société. Ces professionnels n’acceptent pas aveuglément la capacité de la photographie à provoquer des changements, mais reconnaissent que, grâce aux images, il est possible d’éduquer et de motiver le public, d’interroger les puissants et de nous aider, en tant que spectateurs, à communiquer avec notre propre humanité.
Voix des pratiquants
L’intention de Walsh est de permettre au lecteur d’entendre les voix des photojournalistes, leurs « expériences personnelles, anecdotes, frustrations, espoirs et croyances ». Elle observe que « les spectateurs ne sont pas des réceptacles passifs, et que le spectateur conscient de la dynamique derrière l’objectif » peut prendre des décisions plus éclairées en réponse aux photographies qu’il/elle voit. »En tant qu’éducatrice en journalisme, j’invite mes étudiants à réfléchir aux raisons pour lesquelles le photographe prend une photo ou une série de photos en particulier, quelle est leur motivation pour couvrir l’histoire. Je leur demande également de prendre en compte les médias et les processus de prise de décision qui permettent de publier une image particulière. Les entretiens dans Conversations avec les photojournalistes et leurs commanditaires contribuent à répondre à ces questions et apportent une transparence importante dans le processus à un moment où la confiance du public envers les médias est précaire.
Les conversations impliquent également des entretiens avec des éditeurs photos et des personnes jouant un rôle crucial dans les organisations humanitaires, ces dernières devenant un canal de financement de plus en plus important pour les photojournalistes. La juxtaposition des édits professionnels du photojournalisme avec les motivations idiosyncratiques du praticien donne une nouvelle image de l’industrie. À travers des interviews et des essais, Walsh déplace le récit de la superficialité du photojournaliste en tant que héros fanfaron, ou voyeur opportuniste, à une personne qui sent profondément et qui s’engage à raconter l’histoire, peu importe le coût personnel.
Walsh a une vaste gamme de questions lors de ses entretiens, son style engageant et organique, permettant à ses sujets de parler librement, de partager des idées et des anecdotes personnelles sans se perdre dans l’abstraction; la marque d’un intervieweur qualifié qui laisse la latitude de conversation, mais peut également apporter la concentration. Elle aborde certains des problèmes majeurs auxquels le photojournalisme est confronté depuis ses débuts: les notions de vérité, d’objectivité, d’équilibre et d’éthique de photographier des personnes qui souffrent. Cependant, Walsh ne cherche pas de réponses définitives sur ces points, s’assurant que le livre ne se transforme pas en posture théorique. Les photojournalistes eux-mêmes se lancent dans une discussion sur les pratiques professionnelles, la tension entre le plaidoyer et le reportage, la reconnaissance du fait que subjectivité ne signifie pas inexactitude, et que le cadrage d’une photo est un acte d’omission, autant qu’un processus d’ inclusion.
Il existe également un débat animé sur la valeur des médias sociaux, certains photojournalistes embrassant les avantages et d’autres moins. Il existe un sentiment général d’optimisme quant au fait que les photographies peuvent influer sur le changement et il existe des preuves à l’appui du fait que les images ont incité à agir, mais le manque de réaction de certaines histoires, tant des médias que du public, est également frustrant. Pourtant, comme le fait remarquer le photojournaliste de conflit, Ron Haviv, même si vous déplacer le sentiment général, » d’un centimètre, vous avez déjà fait une différence importante ».
Le livre vient avec la reconnaissance du fait qu’historiquement, les occidentaux ont produit de manière disproportionnée le photojournalisme, en particulier la photographie de conflit. À son tour, les écrits sur ce photojournalisme se sont généralement concentrés sur ces chiffres. Walsh vise à atténuer ce déséquilibre, notamment par des entretiens avec des femmes et des personnes d’origine non occidentale. Ce travail ne se veut pas une encyclopédie du photojournalisme et Walsh reconnaît que les personnes interrogées «ne représentent qu’une petite fraction des nombreux excellents praticiens» qui peuplent le terrain. Elle reconnaît également que «l’industrie a encore beaucoup de travail à faire pour niveler les règles du genre et de la race».
Les photographes
La discussion franche d’Andrea Bruce sur sa frustration de travailler en Irak pour le Washington Post a donné le ton aux interviews. Elle explique que de nombreuses photographies sur les conséquences des attentats-suicides n’ont jamais été publiées, malgré l’importance de l’histoire. À cette époque, ces incidents étaient quotidiens et tuaient civils et soldats. Agressée par la réaction apathique à son travail, Bruce a changé d’orientation, puisant dans son éducation en histoire de l’art pour créer ce que l’on pourrait décrire comme des images de belles souffrances. La photo du bébé mort de froid dans un camp de réfugiés en Afghanistan fait écho à celle de Madonna and Child (voir ci-dessous).
Selon Bruce, «après la publication de cette photo, la réaction a été énorme et ne ressemble à aucune des réactions vis-à-vis d’autres photos que j’ai prise. Les personnes déplacées à Kaboul ont reçu beaucoup d’attention et d’aide après la publication de la photo. C’était formidable, et cela donne l’impression que vous agissez comme il convient. »Bruce se sent énormément responsable de couvrir ces histoires importantes, et parle ouvertement des conséquences négatives de la mort et de la destruction. Elle raconte également ce qui se passe lorsque le public se déchaîne, affirmant que ses photographies empiétent sur le chagrin de quelqu’un et qu’elle n’a pas le droit d’être présente à ce moment-là.
Les lecteurs ont peu de sens de ce qui se passe dans les coulisses et dont la propre culpabilité, voire le sentiment d’impuissance alimente l’émotion, peuvent facilement appliquer les étiquettes de «voyeur» et d’ «opportuniste». Les témoignages introspectifs honnêtes de Bruce permettent de mieux comprendre pourquoi ces histoires sont importantes et comment elle travaille avec ses sujets.
Marcus Bleasdale parle du plaidoyer et de sa position sur les reportages équilibrés, soulignant que son travail consiste à faire une déclaration claire; il ne tergiverse pas. Il est également conscient de la nécessité de «d’amener les gens a voir la beauté du lieu et de l’histoire. Sans quoi, ils n’apprendront rien. »M. Bleasdale est largement médiatisé sur les réseaux sociaux et révèle que si les images esthétiques produisent davantage de « likes » », ce sont les images percutantes qui suscitent souvent un débat animé qui aboutit à des centaines de commentaires.
Le photojournaliste américain Spencer Platt parle de son étonnement que certains « trouvent ce travail romantique … Vous allez dans des endroits (comme l’Irak) et c’est un travail lent ». C’est brutal, c’est difficile, c’est effrayant. » la discussion devient plus personnelle. Il raconte comment il s’est senti après avoir couvert la fusillade de Sandy Hook Elementary School à Newtown en 2012.« Je pense à ces enfants, à leurs familles, et à la façon dont j’ai été envoyé là-bas pour couvrir cette histoire, mais aussi comment je voulais l’éviter. Je ne voulais pas y aller. Vous ne voulez simplement pas faire partie de la race humaine à ce moment là. Mais on m’a demandé d’y aller et je devais partir. »C’est une histoire qui le hante toujours.
Nina Berman révèle qu’elle préfère le terme de «photographe documentaire» plutôt que de photojournaliste, ce dernier étant trop enveloppé dans le personnage mythologique endurci associé à la profession. Berman partage ses frustrations avec les médias qui n’ont pas réussi à publier des histoires, des images qu’ils ont commandées puis les ont trouvés trop difficiles. Elle veut réveiller les gens et pense que les médias «se rendent complices en créant un auditoire ignorant en leur donnant à voir constamment des conneries sur des vedettes ou des« informations utiles »» conçues pour alimenter notre société de consommation et nous occuper avec les plus insignifiantes.
En plus des voix américaines et européennes du livre, Conversations propose une interview de Shahidul Alam, célèbre photojournaliste et activiste bangladais. Après avoir été emprisonné pour avoir pris la parole en public contre le gouvernement en 2018, Alam était l’un des journalistes nommés TIME Personne de l’année, dans le numéro qui mettait l’accent sur les menaces à la liberté de la presse. Alam est l’une des personnes les plus éloquentes que j’ai eu le plaisir de rencontrer. Je l’ai interviewé à plusieurs reprises et j’ai lu son entretien avec plaisir. Répondant au commentaire de l’étudiant de Walsh, Alam fait observer que le point de vue du jeune homme est important car le rôle de la photographie est «d’ouvrir un débat … La relation entre un lecteur et une image photographique n’est pas statique. Ça change. C’est complexe. Cela dépend de la compréhension de l’histoire. »Selon Alam, les médias ont échoué dans leur rôle d’éducation du public, de défense des intérêts commerciaux et de politique. L’étudiant de Walsh est le produit d’une société où la pensée critique n’est pas encouragée.
Alexander Joe, un photographe zimbabwéen qui couvre les conflits depuis plus de 30 ans, parle du pouvoir d’éducation de la photographie, mais met également en garde contre le désir des médias d’obtenir une valeur choquante. Il explique que les rédacteurs en chef veulent souvent des stéréotypes lorsqu’ils relatent des histoires sur la famine, des images d’enfants aux membres squelettiques et le ventre distendu. En couvrant les famines qui ont ravagé les pays africains, la démarche de Joe consiste à montrer ces enfants «d’une manière digne qui éduque toujours le monde sur ce qui se passe… Un beau portrait peut vous parler de la douleur». Mais il admet également que c’est facile se faire prendre dans la machine multimédia. Se souvenant d’un moment en Somalie où il travaillait pour l’AFP, Joe a déclaré qu’il s’était rendu compte qu’il «nourrissait le système» et ne pensait pas aux gens… cela m’a rendu furieux contre moi-même. Je me suis retourné et je suis parti. Je devais me vider la tête, me rappeler pourquoi j’étais là-bas et rentrer. Ensuite, j’ai pu documenter avec un œil compatissant.
Eman Helal, une photographe égyptienne qui a couvert le printemps arabe de 2011, est investie dans un travail qui responsabilise les femmes dans son pays. Elle parle ouvertement des préjugés des médias égyptiens, des difficultés à être prises au sérieux pour les femmes journalistes et de l’influence de la propagande gouvernementale sur la manière dont les informations sont rapportées. Son honnêteté est rafraîchissante, en particulier pour ce qui est de savoir si la photographie peut influer sur le changement. En parlant de photographier dans un camp de réfugiés syriens, elle déclare: «Je prends des photos de ces personnes, puis je pars, et rien ne change pour les réfugiés. Parfois, vous vous sentez si petit, vous êtes impuissant ou votre travail n’aide pas. Mais en même temps, vous devez essayer de documenter ce qui s’est passé. »C’est cet engagement à témoigner qui constitue le thème central de toutes les interviews.
La photographe iranienne Newsha Tavakolian travaille dans des reportages sur des photographies plus conceptuelles, créées dans le cadre de questions sociales. Tavakolian observe, en réponse au commentaire de Walsh, que la plupart des personnes qui choisissent de ne pas regarder d’images graphiques sont privilégiées et qu’il incombe aux photographes de trouver un moyen de communiquer visuellement des récits de conflit et de souffrance qui ne découragent pas le spectateur. Elle admet que c’est une ligne de démarcation fine entre documenter la réalité pour les générations futures et encourager les personnes du présent à agir.
Tavakolian est actuellement plus investi dans une approche créative du documentaire, mais cela ne signifie pas manipulation ou fabrication, un point que beaucoup de personnes interrogées dans le livre ont du mal à faire valoir. La salissure des fausses nouvelles et la facilité avec laquelle les images peuvent être modifiées aujourd’hui ont miné le secteur ces dernières années. Les photojournalistes de Conversations peuvent utiliser des techniques de narration innovantes, mais ils sont essentiellement des photographes documentaires intéressés à capturer l’histoire, et non à la fabriquer.
La capacité de la photographie à induire un changement est également un concept auquel se heurtent toutes les personnes interrogées, et l’industrie en général, mais il ya un optimisme perspicace dans ce livre selon lequel un changement est possible; une perspective qui est peut-être nécessaire face à certaines des plus grandes crises de l’humanité.
Dans la salle de presse et au-delà
Dans l’essai introduisant cette section, Walsh aborde des idées sur la médiatisation de l’information, ainsi que sur des questions de littératie visuelle, de pensée critique et les médias en tant que gardiens de l’information à l’ère des médias sociaux. Elle aborde également l’impact des impératifs commerciaux sur le type de photographie publiée et les conséquences potentielles de la saturation de l’image.
Cette section présente des entretiens avec Santiago Lyon, ancien vice-président et directeur de la photographie chez Associated Press (2003-2016); Maryanne Golon du Washington Post; Aidan Sullivan, ancien éditeur de photos, ancien vice-président de Photo Missions pour Getty Images et actuellement fondateur et PDG de Verbatim, une agence commerciale représentant les photojournalistes; et Marion Mertens, editrice numérique principale de Paris Match, l’une des plus anciennes publications de photojournalisme au monde.
Ces entretiens sont tout aussi éclairants, car ils fournissent des informations importantes sur la manière dont les images sont introduites dans le journal ou le magazine, ainsi que sur le type de décisions prises par les rédacteurs en matière de sélection de photographies. Santiago Lyon, qui a commencé sa carrière comme photojournaliste, fait une observation intéressante en distinguant le rôle de l’éditeur de photo de celui du photographe:
«L’un des grands défis auxquels les photographes sont confrontés est l’attachement émotionnel qu’ils ont à leur image. Ils vivent et respirent ce qu’ils recouvrent, le sentent et le resentent, et souffrent parfois pour obtenir des images. L’une des choses que j’ai remarquée, c’est que si les photographes ont besoin de ce genre de passion pour pouvoir travailler, le montage doit être plus clinique. »
Marion Mertens suggère que le monde saturé d’images dans lequel nous vivons présente des avantages, car le public est de plus en plus acculturé aux histoires racontées en grande partie par des images, avec des mots fournissant un contexte. «Je crois vraiment que vous devez montrer aux gens de ne pas oublier que cela se produit», a-t-elle déclaré à propos de la crise syrienne et de la fonctionnalité en ligne de Paris Match, axée sur des images d’enfants en détresse. « Ils ressemblent à tous les enfants – mais ils sont en pleine guerre … Les images bouleversent le spectateur, car vous voyez des quartiers totalement détruits et des enfants entre eux, essayant de survivre. » Mertens s’est engagé à rappeler au public de la crise syrienne, même si la couverture semble parfois répétitive, il peut être plus facile d’adopter une position dans un magazine que dans un quotidien. Même si Mertens a déclaré: « Il est crucial que les médias n’abandonnent pas les situations de crise », mais elle admet que les nouvelles dures « perdent constamment du terrain face aux informations sur le divertissement ».
Plaidoyer et aide
Dans cette dernière section, Walsh s’entretient avec des représentants de Médecins sans frontières / MSF, de Human Rights Watch (HRW) et de l’UNICEF. Les organisations non gouvernementales telles que MSF et HRW, ainsi que les divers fonds des Nations Unies, tels que l’UNICEF, deviennent de plus en plus des sources de revenus importantes pour les photojournalistes. Mais travailler pour ces organisations peut être un sujet controversé qui soulève des préoccupations concernant l’éthique, la représentation, la politique et le droit des individus à leur image.
La photographie a été utilisée pour faire connaître les violations du droit humanitaire et des droits de l’homme depuis ses débuts. Dans l’essai de cette section, Walsh reconnaît « l’influence croissante de ces agences sur la scène politique mondiale » et l’importance de comprendre le rôle de la photographie dans la représentation des questions humanitaires. Walsh divise la discussion sur la représentation en quatre débats clés: le timing et l’urgence; les stéréotypes; relations de pouvoir coloniales; et consentement et dignité.
Dans les entretiens, elle pose des questions sur la motivation des organisations humanitaires à fournir des images aux médias, les conditions d’engagement dans le travail avec les photojournalistes, l’importance de documenter les crimes de guerre et les violations des droits humains et la fonction de la photographie en tant que document juridique. Il existe également une discussion franche sur la manière dont certaines images, telles que celle d’un enfant affamé, qui semble impuissante et qui tient dans l’appareil photo, ont évolué pour devenir des clichés, mais elles sont encore utilisées parce que les collecteurs de fonds pensent qu’elles sont efficaces. Cette section, comme celles qui la précèdent, fournit des pistes de réflexion.
Alors, qui est le public des conversations? Grâce au style d’interview informel de Walsh, le livre est très attrayant. Ceux qui travaillent dans le journalisme, les photographes et les étudiants trouveront les idées fascinantes, la sélection des personnes interviewées permettant aux voix nouvelles et établies de se faire entendre. Je crois qu’un large public bénéficiera également d’une meilleure compréhension des intentions des photojournalistes qui couvrent les conflits et du processus décisionnel lié à la publication d’images.
Je trouve les Conversations extrêmement satisfaisantes. Dans ce livre, Walsh élève avec succès le photojournalisme à sa juste place en tant qu’outil essentiel pour documenter l’histoire et transmettre des histoires importantes au public. Ce que l’individu fait avec les informations obtenues en visionnant des images de conflits est peut-être l’étape la plus importante après la prise et la publication de la photo. Si Conversations on Conflict Photography laisse au lecteur une seule question, c’est la suivante: armés de connaissances sur les crises auxquelles l’humanité est confrontée, que ferez-vous?
Alison Stieven-Taylor
Publié par: Bloomsbury Visual Arts
Disponible sur Amazon.com
ISBN: 9781350049178
34,99 USD / 24,95 USD
376 pages
110 images couleur et N & B