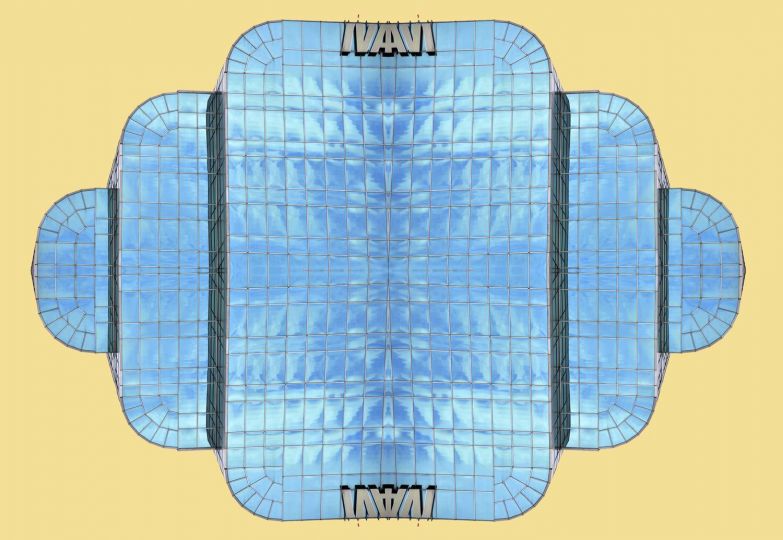Les Nuits Fauves
Si créer des catégories n’a pas toujours eu trop de sens, dans notre période historique, cela a encore moins de sens. Pour s’approcher de Les Nuits Fauves de Carolina Lopez, il faut se libérer de tout préjudice artistique et social. Son travail c’est un travail qui demande une immersion totale dans un monde qui, pour moi, représente une découverte. J’ai été complètement impressionnée la première fois que j’ai vu ces photographies dans la maison milanaise de l’artiste, entre une conversation et un thé. Je me suis rendu compte, en fait, que je ne connaissais rien de ce monde. J’ai été frappée, au début, par des couleurs fortes, exaspérées, par des corps si habillés. De quoi s’agit-il? D’un reportage? D’une recherche sociale? D’un portrait? Quoi importe? Ce qui compte c’est le résultat et tout ce qui reste dans les yeux après l’immersion dans ces photos si pleines de couleurs. La couleur utilisée est très souvent plate, puissante, excessive, même vulgaire, parfois.
Où sommes-nous? À Budapest, à Prague, à Milan, à Paris, à Los Angeles. Les images ne sont pas accompagnées par des didascalies, ce n’est pas tellement important de les situer géographiquement. Chaque photo part d’une attraction plus ou moins fatale. Carolina participe à plusieurs fêtes, elle y est invitée, elle se laisse inviter. Elle arrive avec ses appareils photo, elle se glisse dans des tissus humains qu’elle aime où elle se sent parfaitement à l’aise. Burlesque, strip-tease, bonne humeur peut-être simulée, tristesse présumée. Chacune de ses images émet une dimension exaspérée, grotesque, bruyante. C’est comme si ces photos pleines de détails, de stimules, arrivent même à nous communiquer le bruit assourdissant de ces endroits.
Il serait une erreur de considérer Carolina comme une simple observatrice. Carolina photographie d’égal à égal, comme protagoniste de ces fêtes. À cet égard, son travail est particulier, insolite.
Son comportement rappelle plus celui de Nan Goldin plutôt que celui de Martin Parr.
C’est un regard, qui vient de l’intérieur, un regard profondément impliqué. C’est une ’”anti-reporter”. Elle l’était également à Istanbul quand elle photographiait la partie derrière des femmes. Certainement, en ce cas-là, elle n’appartenait pas à ce monde-là mais son intérêt n’était absolument pas un intérêt documentaire. Et ensuite à Berlin, où elle y vit pendant un an et demi en fréquentant avec passion la vie nocturne.
Dans chaque endroit, elle est différente et, pour certains aspects, elle est reconnaissable. Plus raffinée à Paris, lourde dans les pays de l’Europe de l’Est, “à la mode” à Milan, où Carolina s’ introduit dans des fêtes du monde de la mode. Carolina aime ces dimensions qui, pour certains aspects, rappellent les fêtes de Trimalcion, racontées il y a deux-mille ans, par Petronio dans son œuvre Satyricon, ainsi que la décadence des mœurs, qui a été transformée en images dans les films de Federico Fellini, de Pier Paolo Pasolini. C’est le monde du trop, avec les mêmes couleurs exaspérées, mutatis mutandis, du travail photographique de Lopez. Son témoignage c’est celui d’une société apparemment sans douleur en paraphrasant le philosophe Byung Chul Han. On y trouve un monde où la souffrance est assoupie, anesthésiée pour faire semblant qu’elle n’existe pas. Un monde narcissique de personnes refaites, masquées, qui n’acceptent pas la mort dans un contexte où la mort est, cependant, bien dominante dans une dimension d’érotisme égotiste. “J’observe des ambiances très superficielles, dominées par le consumérisme que je vais justement saper par ma façon personnelle de voir. Je crée des visions fragmentées et bien rapprochées entre elles».
Certaines images représentent l’extérieur, elles sont réalisées surtout à Las Vegas, où les personnes, en particulier les femmes, marchent presque nues dans la rue avec leurs corps complètement glabres. Personne ne se tourne pour les regarder, il y a la même simplicité qu’on trouve dans le regard de Carolina, qui appartient à ce monde-là.
Son travail ressent fortement de sa formation. Déjà en Colombie, son pays d’origine, elle étudie de la peinture, ensuite elle arrive en Italie, à Florence, où elle continue ses études à l’Académie des Beaux Arts. Elle travaille avec et sur des couleurs fortes, qui la ramènent à sa culture primitive; elle réalise des portraits, des paysages. Elle commence, donc, à étudier de la photographie près de ‘’Santa Reparata International School’’.
Le moyen est secondaire par rapport au but mais c’est comme si Lopez avait métabolisé toutes ses expériences du passé pour joindre à cette série d’ouvrages si forts et, en quelque sorte, même courageux, qui dans certaines images, la voient aussi protagoniste.
Dans chacune de ses photos on retrouve sa culture latino-américaine, sa personnalité marquée, qui la rendent différente en fonction de l’ambiance où elle se trouve à opérer. À cet égard, son travail est unique, particulier. C’est le point de vue qui est différent. Carolina c’est une observatrice d’ images, une femme curieuse qui s’introduit dans des milieux différents.
Les protagonistes de la plupart de ses photos sont des femmes, dont, dans plusieurs cas, le visage n’est pas représenté ou bien, s’il est représenté, il n’est pas reconnaissable. Ses évasions ce sont des évasions dans la nuit, des évasions existentielles.
Comme déjà écrit, elle fait des observations provenant de l’intérieur d’elle-même mais, en même temps, nous avons l’impression de nous trouver devant des biopsies sociales, des petits carottages, à la recherche des détails qui arrivent à représenter une unité. Dans beaucoup de ces photos nous pouvons saisir le punctum, en citant Roland Barthes, qui perce notre imagination, notre regard en capturant notre attention et en influençant notre lecture: la bretelle d’ un corsage, le détail d’ un body, la fantaisie d’ une robe impossible.
Il est intéressant d’entendre parler Carolina au sujet de sa modalité opérative: «Si je suis au courant d’ un événement qui m’ intéresse, j’essaye de me mettre en contact avec les organisateurs et je leur demande de me laisser prendre des photos. On ne m’a jamais dit que non. En général, dans ce monde-là, tous sont contents de jouer, de se faire prendre. À la limite, si cela les dérange, on me le dit et moi, je ne prends pas de photos. Beaucoup de participants sont amis ou bien ils le deviennent dans le temps, des autres sont des professionnels de la nuit. Les femmes aiment être photographiées par moi parce qu’elles aiment ma manière de regarder le féminin et de le traduire en image. Pour elles, je suis rassurante, je ne suis pas une voyeuse. Quelques-unes se proposent spontanément devant mon objectif». Le dialogue, la conversation précèdent chaque photo. Carolina ne veut rien voler.
Elle est attirée par les mises, les survêtements, les gants, les collants, qui la reconduisent à d’autres dimensions, parfois picturales, parfois à celles du monde sado-maso de Robert Mapplethorpe, artiste très aimé. Elle revient également à l’art ancien japonais, à une sorte d’érotisme du monde flottant. Là aussi, les corps flottent sans trouver forcément un sens à leurs actions. Souvent, comme déjà écrit, le rappel c’est vers des dimensions grotesques du Burlesque, une pratique qui trouve ses origines dans l’ Angleterre du dix-neuvième siècle et qui, maintenant, s’affirme dans notre société caractérisée par des excès, des selfies, des narcissismes de toutes sortes. C’est l’envie d’étonner et Lopez aime se laisser étonner.
Ce sont surtout les femmes jeunes qui sont photographiées, mais il y a aussi des femmes usées par le temps dont le maquillage est presque toujours exagéré. Les références sexuelles ne se comptent même pas. Très peu d’hommes, quelques transsexuels. Ce qui est charmant c’est la naturalité par laquelle l’artiste colombienne aborde les différentes situations. Chez elle, il n’y a jamais aucun jugement d’origine morale, même quand elle aborde les situations les plus lourdes. Il n’ y a aucune intention caricaturale à la quelle ce monde pourrait se prêter.
Je voudrais mieux comprendre ces lieux que je ne connais pas et que je vois dans ces images. Pourquoi les gens fréquentent-ils ces lieux ? Est-ce qu’ils s’amusent ? Tout cela me semble très loin. C’est la première fois que j’écris sur des images pareilles. La raison est beaucoup plus profonde par rapport à ce qu’ on peut l’imaginer. Les gens y viennent parce qu’ils sont attirés par la mode, par des personnages, qui organisent ces fêtes, probablement pour les raconter, pour prendre un selfie.
Choderlos de Laclos avec ses ‘’relations dangereuses ‘’ du dix-huitième siècle n’est pas tellement loin. La seule différence c’est que là, l’ambiance, au moins apparemment, est plus démocratique. Être dans ces endroits c’est une épreuve d’existence dans un monde auquel nombreux y aspirent même au risque d’apparaître ridicules. Mais quoi importe?
Dans une photo sont représentées des fesses dignes de la publicité des bas des années quatre-vingts. Pas d’ opérations Photoshop, tout est naturel, aussi parce que le sujet c’est une mineure dont son travail consiste à passer des soirées entières sur un carré pour se laisser regarder et photographier. C’est une lapine..ça me fait pleurer. Quelle mélancolie. Et encore, ces photos montrent le local milanais homosexuel où les lesbiennes et les gays sont beaux comme tout. Nous sommes en train de quitter les stéréotypes détestables d’il y a quelques années. La sexualité est liquide, elle aussi est flottante. Et alors, nous avons encore besoin de définir les genres? Justement comme dans l’art.
Angela Madesani