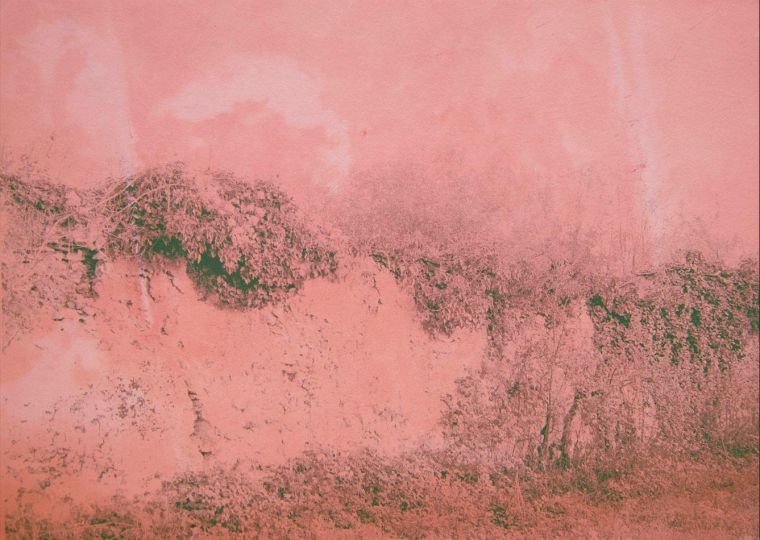Le 1er décembre Gabriel Bauret a donné pour Caméra au Centro Italiano per la Fotografia de Turin une formidable conférence sur Robert Doisneau. En voici une transcription écrite faite par lui !
Aujourd’hui Robert Doisneau
Cette exposition n’est pas une rétrospective ; elle n’embrasse pas la totalité de l’œuvre – la quantité de négatifs conservés, 450.000, donne la mesure de l’étendue de la production –, mais participe d’un désir de mettre l’accent sur des moments jugés « décisifs » – la période choisie se déploie entre les années 1930 et le début des années 1960 – ; un peu comme l’ami de Robert Doisneau, Henri Cartier-Bresson, parlait d’« instants décisifs ». Et même si certaines des images exposées sont associées à des travaux de commande, c’est avant tout la recherche personnelle qui est ici mise en avant. Libre témoin des événements de la rue, peintre du paysage urbain de l’après-guerre, Doisneau fait ses gammes en se rapprochant progressivement des gens ; il les apprivoise. L’exposition raconte cette progression qui amènera le photographe à arranger la réalité, si bien que les images mises en scène et les instantanés pris sur le vif tendent à se confondre : Doisneau est à la fois pêcheur à la ligne et orchestrateur du monde qui l’entoure. Il est aussi en quête de bonheur. Il ne cherche pas à délivrer un message, mais d’abord témoigner du plaisir qu’il a à partager des moments heureux, drôles, légers, au milieu de ses contemporains avec lesquels il se sent bien et en confiance. “Le monde que j’essayais de montrer était un monde où je me serais senti bien, où les gens seraient aimables, où je trouverais la tendresse que je souhaite recevoir. Mes photos étaient comme une preuve que ce monde peut exister.” (Propos recueillis par Frank Horvat en 1990). Et la dernière partie de l’exposition, intitulée précisément « Une certaine idée du bonheur », est l’expression de cette quête.
Robert Doisneau est en fin de compte un être assez paradoxal. Il est un photographe solitaire, qui ne répond qu’à ses instincts, ses envies très personnelles. Il aime ainsi partir seul dans les rues de la banlieue, et attendre que le poisson morde à l’hameçon. Parfois rien ne se passe, ou bien un incident vient déranger une situation qui lui semblait intéressante à photographier, et il doit renoncer à faire l’image. Mais au final, son œuvre est peuplée d’une foule d’êtres humains, de personnes auxquelles il s’intéresse de près, dont il s’efforce de comprendre le destin, à commencer par le monde ouvrier dont il s’est très tôt senti proche. Sa photographie se construit sur cette compréhension du monde qui l’entoure et qui fait la force de ses images, ayant su le regarder tout au long de sa vie. Comme un architecte doit dessiner sans relâche pour penser la structure d’un bâtiment, comme un musicien doit faire ses gammes pour dominer son instrument, un photographe doit regarder intensément ses sujets pour en donner une image juste. Autre paradoxe, s’il en est : son œuvre a trop souvent été considérée comme un ensemble d’images conçues sur le registre de l’humour. À l’observer de plus près, elle fait montre également d’empathie, de sensibilité à l’égard de milieux sociaux défavorisés, vivant en marge de la richesse, aux confins de la misère, comme c’est le cas dans la banlieue parisienne de l’après-guerre.
Pour Robert Doisneau, comme pour les photographes français de sa génération que l’on a souvent qualifié d’« humanistes », le regard est le moteur de la création, participe de l’élaboration de projets sans cesses renouvelés. Un regard associé dans son cas à la déambulation et à la curiosité – sans cette insatiable curiosité en direction des gens, pas de plaisir de photographier –. Il veut sans doute signifier par là que le monde qui l’entoure et qu’il observe est sans limite. Il ne s’est jamais lassé en effet de revenir dans les mêmes endroits : la banlieue et certains quartiers de Paris. D’autres photographes ont choisi de voyager, d’aller à l’autre bout du monde pour explorer de nouvelles réalités, lui est un sédentaire : il revient sans cesse sur le même motif, le même milieu social et le même territoire. Sans urgence ; le temps fera son œuvre. Et il n’a jamais été aussi heureux que lorsque son emploi du temps lui permettait le dimanche de quitter son atelier pour arpenter les rues en toute liberté et approcher les lieux et les décors qui l’enchantaient, entre autres les bistrots. Il y connaît l’ivresse : plus que celle des vapeurs de l’alcool, celle de communiquer et de trouver de la complicité dans ce magnifique théâtre où se mêlent paroles, gestes, musiques et jeux.
J’aime beaucoup la photographie du petit garçon qui regarde l’eau s’écouler dans le caniveau et qui figure sur la couverture du catalogue de l’exposition. Une photographie ancienne qui révèle une composition audacieuse, un cadrage légèrement basculé, avec des lignes qui rythment avec force l’image. Une écriture qui ressemble aux recherches formelles de cette période des années 1930 mais que Doisneau ne reprendra pas tellement par la suite. Il s’en tiendra à des compositions plus stables. Donc j’aime cette audace, mais j’aime aussi ce petit enfant qui découvre le monde, totalement fasciné par ce qu’il voit. Doisneau a beaucoup mené d’expériences avec les enfants à ses débuts. Un peu intimidé par les grandes personnes, il l’avoue lui-même. Peu à peu, il va prendre de l’assurance et la rue deviendra, avec toute la société qui l’habite, son territoire de prédilection.
Doisneau a en effet très tôt cherché des complices parmi les enfants. Il a en quelque sorte fait ses gammes avec eux, les faisant rejouer des scènes qui lui semblaient potentiellement intéressantes, de manière à obtenir le geste, l’attitude qui correspondent au sens et à l’esprit qu’il voulait donner à l’image. Il confie souvent qu’il n’osait trop s’approcher des gens dans la rue. Les enfants, du moins ceux qu’il abordait dans les territoires qu’il avait l’habitude de fréquenter (banlieue et quartiers populaires de Paris), n’étant pas farouches, et du fait qu’il est joueur de nature, ceux-ci ont constitué des sujets se prêtant parfaitement à ses expérimentations. Par la suite, ses mises en scène se sont régulièrement organisées avec des amis, de la famille (ses filles entre autres), voire des comédiens. Chez Robert Doisneau, peu importe ou non que la scène soit aménagée, que l’image soit arrangée ; il ne s’agit pas non plus de photographie de reportage pouvant avoir une incidence sur la compréhension d’une actualité – peu de photographies ont d’ailleurs chez lui ce statut, si ce n’est celles qu’il réalise au moment de la Libération de Paris –. Cette exposition mêle ainsi des photographies préméditées, des scènes montées de toutes pièces avec des complices, et des images prises sur le vif, dans lesquelles opère la magie de l’instant. Le parcours de l’œuvre ne fait apparaître aucune différence et c’est sans doute là l’art de Doisneau, celui d’avoir su tout mettre sur le même plan.
Désobéir signifie ne pas se soumettre aux exigences d’une mode, d’un courant artistique. Si Doisneau incarne avec d’autres la photographie humaniste, il l’a toujours pratiquée à sa façon. En suivant ses élans personnels. Sans doute, s’est-il intéressé à la même humanité qu’un Willy Ronis ou une Sabine Weiss, mais à y regarder de plus près, dans son approche, sa façon d’aborder les sujets, sa note personnelle qui mêle grande bienveillance et sens de l’humour, il s’est distingué de ses collègues. Doisneau a toujours manifesté un esprit rebelle, s’agissant, précisons-le, de son travail mené en marge de ses très nombreuses commandes pour la presse et la publicité. Et quand il en avait assez des contraintes, lorsqu’il était par exemple employé par Renault, il a cherché l’évasion. Dans le contexte de sa photographie personnelle, il se méfie des écoles esthétiques, des groupes qui vont dans la même direction. Il a manifesté une grande liberté d’esprit, celle qu’il a trouvée chez des poètes comme Jacques Prévert. Les légendes que Doisneau s’emploie à rédiger sur un grand nombre de ses photographies ont d’ailleurs quelque chose de très poétique. Ces petites formules subtilement choisies font écho aux images, complètent le message visuel, jouent avec celui-ci. Et en fin de compte disent un peu de leur auteur. En ce sens, le propos d’une exposition n’est-il pas d’essayer de lever un coin du voile, de se rapprocher de l’homme derrière l’œuvre, de saisir des fragments de sa biographie ? Et de rejoindre ainsi les mots du photographe lui-même lorsque celui-ci déclare, en prenant du recul : « Les photographies qui m’intéressent, que je trouve réussies, sont celles qui ne concluent pas, qui ne racontent pas une histoire jusqu’au bout, mais restent ouvertes pour permettre aux gens de faire eux-aussi, avec l’image, un bout de chemin, de la continuer comme il leur plaira : un marchepied du rêve en quelque sorte. » (Zoom, n° 34, janvier 1976). Une forme d’humilité, mais aussi une expression de la modernité : le spectateur de ses images, à l’instar du lecteur d’un roman, fait exister l’œuvre, fait vivre les personnages qui la composent. Et la vision que l’on peut avoir des photographies de Robert Doisneau évolue avec le temps : elle est certainement différente en 2023 de la façon dont celles-ci étaient regardées au siècle dernier.
Gabriel Bauret