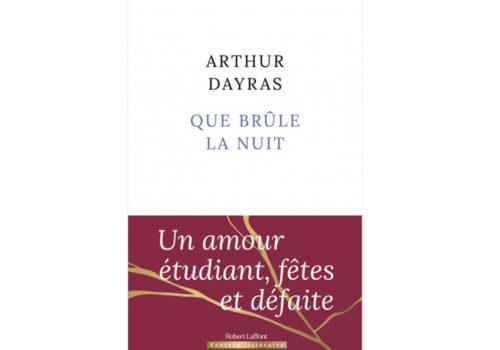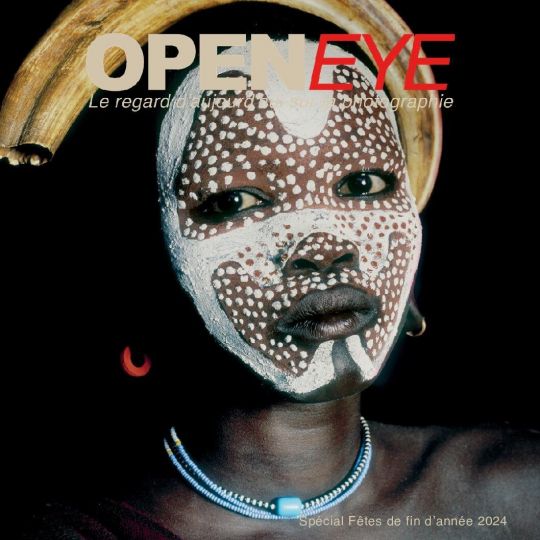Un membre de l’équipe de L’Oeil de la Photographie, Arthur Dayras vient de publier son premier livre. Un livre de photos : non ! Un premier roman dur, âpre et d’une richesse de mots fascinante. Son titre : Que brule la nuit. Son éditeur : Robert Laffont, une référence. C’est toujours formidable d’être surpris agréablement par ses proches !
— Jean-Jacques Naudet.
« Tissé pendant quatre années, Que brûle la nuit raconte un amour de jeunesse, son grand espoir et sa débâcle. Il dit l’histoire de Victor, un étudiant dans sa dernière année d’étude lilloise en architecture, et de Fleure, qui se destine à être maîtresse d’école. L’un est un nanti parisien, arrogant teinté de snobisme, misogyne et vertical dans sa relation aux femmes ; l’autre vient d’un milieu plus modeste, de nature apaisée et silencieuse. Leur amour dissymétrique déborde dans des nuits d’ivresse, dans un Lille que j’ai voulu restituer dans ses beautés et ses poisses. Et cet amour peu à peu se distend, se défait, se brise sur l’envers de la douceur, et la violence qui pas à pas s’immisce en eux.
J’ai voulu tout au long du roman, construction d’imaginaires, sauter d’une intériorité à une autre, de trouver comme une concorde entre deux voix dissonantes. En miroir, le roman ouvre, je l’espère, une réflexion sur la violence masculine, sur ses empêchements psychologiques, et dit aussi tout un monde de la nuit, dans ses excès et ses miroitements ».
— Arthur Dayras.
Arthur Dayras
Arthur Dayras – Que brûle la nuit
Editions Robert Laffont, 2024
256 pages, 135 x 215 mm
EAN : 9782221276990
Disponible en librairies et en ligne.
Signatures et lancements :
- Cahiers de Colette, Paris, le 11 septembre, 18h
- Librairie L’Etagère, Saint-Malo, 3 octobre
Extrait de Que brûle la nuit, page 42-44 :
« Il doit être là, se répète-elle encore pour y croire. Elle jure… Putain, on y voit rien… Elle marche trois pas. Les corps tout autour la cognent, elle sent leur moiteur. Tout pue, tout suinte, l’air empeste ‒ les haleines aigres, la techno, les gens qui s’oublient, qui fument, le tabac chaud. Les briquets parfois ensoleillent des visages et autour d’elle on la jauge d’un coup d’œil rapide, elle n’a pas l’air dans le coup, pas dans le rythme, un peu trop propre, les muscles encore secs, la nuque bien fraîche. Ce qu’elle voit n’est qu’une marée de traits tirés, de regards hallucinés, de vitamines, chacun replié sur soi dans des danses mécaniques, recroquevillé en des gestes saccadés et pensées enchevêtrées. Ceux qui ne dansent pas ont le nez sur leur carte bleue, la figure blanchie, enfin revigorée. La techno lui intime martiale de danser, alors elle s’y met. Lente. Avec mal. Les regards s’effacent. Elle y vient. Bientôt à eux.
C’est bon signe. Elle se laisse aller. Oh, c’est pas évident, se dit-elle, comme ça sans rien, sans avoir bu une goutte. Elle aurait dû se siffler une petite fiole. Son corps n’a pas remué depuis un an, peut-être deux… Elle doit le remettre dans le suc, tourner sur elle-même, renouer avec l’habitude, et là elle n’a pas beaucoup de courage. Elle bouge simplement. Ses genoux grincent, sa tête dodeline à contretemps, elle n’y est pas.
Pas encore. Tout contre elle il y a le souffle chaud d’un type qui la poisse, ses exhalations d’alcool blanc, son parfum pour pauvres muscles, elle l’écarte et s’enfuit vers l’avant en cognant tout un tas d’autres gars. Elle se retrouve grippée entre deux hommes. Le couple en bas de cuir. Fleure perçoit un petit pincement au cœur, attendrie. Les deux se répondent, l’entente intuitive, terriblement sensuelle. Et quand une clope s’allume, ils la reconnaissent et sourient à l’unisson. Fleure godaille timide. L’un d’eux lui dit à l’oreille :
« T’as pas l’air chez toi ici…
― Ça va venir. »
La voilà tirée entre eux deux, à prendre le pas sur leur corps. Ils ne sont pas non plus dans le mouvement, mais ça fonctionne, c’est curieux. Elle s’y met maintenant. Avec des gestes lents, sans trop les envahir. Eux, plutôt que de bouger leur torse, de cogner leur tête, glissent minimaux. Avec eux, Fleure s’oublie, à peine ce qu’il faut ; enfin la soirée devient légère. À tout dire, elle doit être ridicule, se juge-t-elle encore. Mais il fait noir, la musique l’abrutit, lui donne une sorte d’énergie furieuse, si bien qu’elle ne se retient plus. Plus rien ne lui vient à l’esprit sinon les gestes. La musique passe, charrie ses bruits d’acier, de vapeur, de béton. Ça n’a aucun charme, c’est si violemment fait que les corps cèdent au rythme, s’y adonnent et s’y complaisent ou s’en détournent. Pas une voix, pas un chant, pas de notes. De simples touches, des distorsions et des échos vite lancés, agressifs et acides. Fleure cède entière. Si Victor surgissait, il la verrait dans ses gestes n’importe comment, dans tous les sens. Il admirerait sa légèreté, sa facilité à s’affranchir de ses os, de sa carcasse, il la verrait sinon joyeuse. Elle sent bien autour d’elle les désirs, les regards qui traînent. Victor sûrement tiendrait du genre statique, envahi par les beat et les montées courtes. Et penser à Victor lui rend sa pesanteur, lui serre le cœur. Elle s’affaisse, sa joie s’effondre.
La salle est d’un seul coup illuminée, un néon, fébrile et carmin, qui pendouille du plafond. Sous le halo, les visages se réveillent. Cette lumière ouvre comme une trouée dans la tempête. Elle le cherche. Mais dans la grappe des nuques humides, Victor n’est toujours pas là. À ses côtés, des copains hurlent Aciiiiid, , comme pour chasser un démon. Fleure se sent à contre-courant, elle n’a pas sa place ici, pas sans lui. Ce qui vient lui strie les oreilles, déchire la foule éparse et saccade l’air d’éclairs. Elle n’a plus les jambes, elle n’a plus le cœur, déjà les mélodies aiguës jouent sur trois notes, les synthés sifflent et hurlent des plaintes. Toute la salle minuscule, soixante, cent personnes, hurle, s’époumone, plus fort, plus vite ! Il y a autour d’elle une joie puissante, une fierté à s’abrutir dans cette musique hypnotique. Fleure suit fébrile la cadence des deux amants, sourit à les voir s’embrasser. Elle voudrait que Victor l’embrasse ainsi, avec ce désir. Où est-il ? Plus la musique l’assaille, plus ses gestes lui paraissent lourds. Vides et démunis. La fatigue lui tombe dessus. Les corps qui la touchent, qui la palpent, qui la frottent, qui déposent sur elle leur sueur, qui lui gueulent dessus jusqu’à la faire frémir, qui la refluent sans cesse à droite, à gauche, tout cela la dégoûte, elle voudrait n’avoir sur elle qu’une moiteur unique, qu’une seule bouche sur la sienne.
Soudain, elle le voit. Le néon a rougi deux coups. Elle devine découpées comme une ombre ses boucles trempées. Elle fixe sa silhouette… C’est lui. C’est lui ! Elle doit se rapprocher. Il danse tout devant, la tête proche du caisson, frénétique à se la décrocher. Elle bouscule, elle franchit les corps, elle grommelle. Dix mètres encore, elle trouve un chemin entre les aisselles et les bustes collants. Elle voit sa nuque.
Le néon, trois fois. À sa démarche, elle le voit ivre, il danse les bras larges. Comme elle l’imaginait. Il a dû boire comme un trou. Il l’a oubliée sûrement, puisqu’il y a une autre meuf qui s’est entichée de ses yeux suaves. Fleure sent poindre une sorte de méchanceté en elle. De nouveau, l’obscurité. Elle voudrait passer un colosse devant elle. Trois mètres. Elle se heurte à un mur. Elle crie son nom, mais les basses assourdissent sa voix et son appel se perd. Elle se sait presque au bord du renoncement quand le colosse enfin remue et file au bar. La voilà derrière Victor, elle pourrait lui toucher l’épaule. Plus simple, se mettre entre l’autre conne et lui. Elle pourrait lui mordre le cou, lui crier à la gueule… Elle pourrait aussi bien lui murmurer à l’oreille : « Je t’ai attendu toute la nuit. » Elle hésite. La lumière brille une fois encore, sa nuque est toute proche, mais son visage dans l’ombre ».