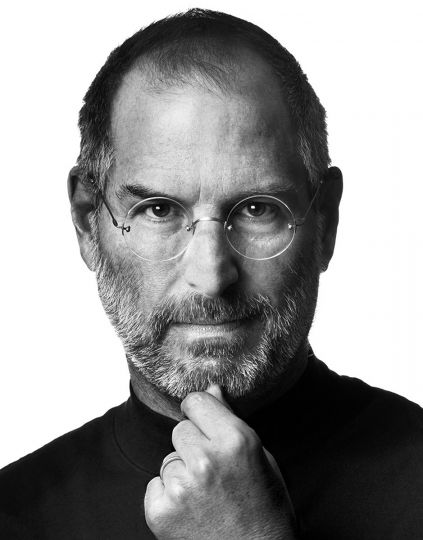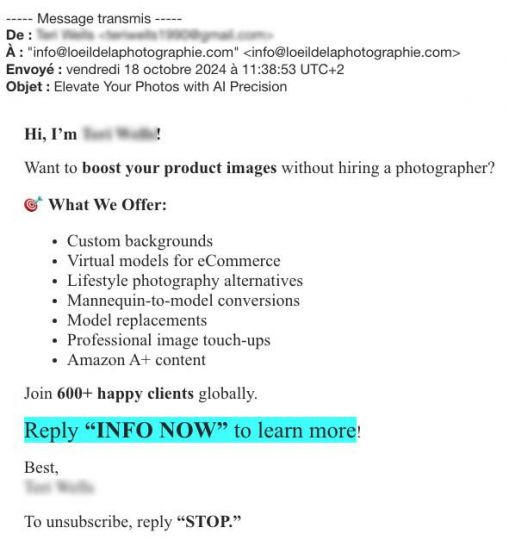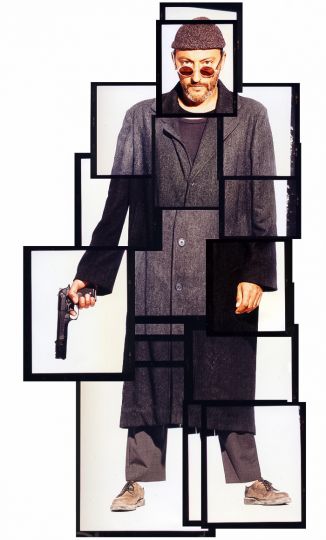Parade, s’intitule le festival cette année. L’erreur est déjà dans l’appellation : une parade c’est festif, flamboyant, convivial… La parade ici est une commémoration hétéroclite de quelques vétérans nostalgiques qui célébraient un soldat même pas inconnu : François Hébel.
Et puis assez de ces vétérans, assez de Martin Parr, assez de Raymond Depardon, assez de Christian Lacroix, assez d’Erik Kessels. Ce sont des gens formidables, mais dont l’omniprésence devient insupportable. A ce rythme, s’il n’y avait pas eu clash et rupture cette année, nous aurions eu l’année prochaine les recettes culinaires de Martin, les nains de jardin de Raymond ou encore les jouets d’enfants de Lacroix.
Ouvrir, renouveler, changer de décennie voire de siècle, là est la véritable nécessité de ce festival.
Mais il y avait pire encore, après « Salut les copains, on a eu droit à la « branchouille » technologique: cinq expositions à voir à la lampe électrique dans un immeuble stalinien où, par sadisme, vous devez prendre deux ascenseurs numérotés à l’envers: là, plus d’un millier de photos vous attendent : tout Sisyphe herculéen que vous vous imaginez être, à la quatrième salle vous êtes déconcerté, à la sixième agacé, à la dixième épileptique, et il y en avait encore 30 derrière ! Et je vous épargne la similitude langoureuse de la plupart des images, mais il y a pire, enfin : l’exposition de David Bailey — une bouillie infâme d’images, de thèmes et de formats différents qui donnent l’impression que David n’était qu’un misérable plagiaire de Penn, Avedon et Newton.
Passons sur les deux expositions people sans le moindre intérêt à la somptueuse abbaye de Montmajour, passons sur une exposition « couloir » de Lucien Clergue… Bref, la dernière révérence est ratée. C’est dommage et c’est triste. François Hébel mérite mieux que cela.
On doit toujours sortir en étant époustouflant ou en claquant la porte. François Mitterrand sur son lit de mort ou Valéry Giscard d’Estaing sur un écran vide. Jamais facile de faire revivre les « Good old days », d’ailleurs le public ne s’y est pas trompé : oui ce n’est pas terrible cette année, mais en fait il s’en fout, de la programmation ! Il est là parce qu’il sent qu’Arles est en transition, devient un festival marchand, que les galeries accourent, que les marchands et agents s’y pressent, que des contrats s’y signent, que des gamins et gamines de toutes provenances sont là et apportent au off, au off du off, ou simplement dans la rue une créativité et un foisonnement. Que chacun pressent que ce qui se passe aux ateliers SNCF est important, surtout quand on voit le premier bâtiment sublime rénové en moins de 20 semaines.
Sam Stourdzé, son nouveau directeur, et son équipe étaient d’une discretion exemplaire. Il faudrait un jour prendre le temps de revenir sur ces cinq dernières années, sur les chassés-croisés, les passions exacerbées, les égos surdimensionnés. Mais cela n’intéresse déjà plus personne, la mémoire d’aujourd’hui est courte et cruelle, les fêtes se sont multipliées aux quatre coins de la ville.
Adieu et bonne chance François Hébel ! Bienvenue Sam Stourdzé !
Bien sûr, il y a eu quelques pépites tout au long de cette semaine : une conférence de François Cheval, le conservateur du musée Nicéphore Niépce, l’exposition Léon Gimpel, celle de Chema Madoz, et la collection Walther, impressionnante dans ses ensembles d’Avedon, de Sander et d’Araki.
Dernière précision : ceci n’est pas un règlement de compte. Je n’ai pas le moindre différent avec François Hébel, avec qui j’entretiens des relations courtoises depuis 40 ans.