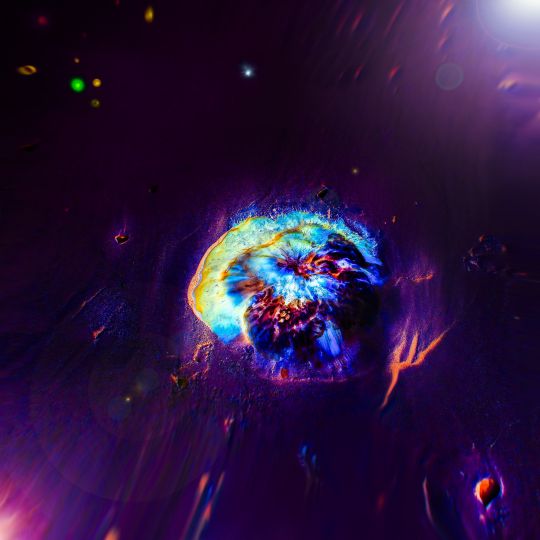« Je voulais dessiner la conscience d’exister et l’écoulement du temps » Henri Michaux – Dessiner l’écoulement du Temps
Le premier mouvement de la Symphonie n°41 de Mozart, dite la Symphonie de “Jupiter”, s’impose d’emblée par une structure binaire clairement définie et dont les tonalités sont diamétralement opposées, voire contradictoires.
Par un jeu subtil d’alternances entre formes, rythmes et couleurs, Mozart met en scène ce contrepoint. Il établit une correspondance entre quelque chose de flottant, de léger, et quelque chose de dense, de nerveux, qui gronde, qui tonne, et qui au comble de sa tension et de son paroxysme, met en branle toute la symétrique de son ensemble. C’est une envolée puissante qui vient par soulèvement scander la modulation paisible d’un andante cantabile, et puis s’interrompt dans un bref silence avant de s’élancer à nouveau.
Cette structure s’impose avec rigueur sur les trois mouvements suivants.
Mozart achève cette dernière symphonie, le 10 août 1788, peu de temps avant de mourir. Elle est le manifeste de son écriture musicale dont la facture échappe à toute définition pour nous transporter dès les premières mesures, à l’endroit du Sublime.
Si par un savant détour on observe cette symphonie de Jupiter depuis l’intérieur, elle décrit l’incommensurable effervescence créatrice de Mozart, ses lignes sismiques, ses exaltations et le vacarme de ses cataclysmes, qui pouvaient brutalement retomber dans l’apathie la plus totale. Derrière cette impétuosité, cette fureur qui le caractérisait, en double fond on perçoit un immense désarroi, quelque-chose de tragique, de ténébreux, d’obscur, que Mozart lui-même définira comme “un vide qui (me) fait très mal, une certaine aspiration qui n’est jamais satisfaite et ne cesse donc jamais.”
C’est cette même aspiration, sans doute elle non plus jamais assouvie, cette vivacité brûlante, cette totale désinvolture apparente, et cette étrange inquiétude qui ne laissera à Antonio Lopez aucun répit, et qui seront au coeur de son œuvre. C’est celle-là même qui probablement le poussera aussi à construire sans prélude ni genèse, ce corpus protéiforme qui s’emparait de tout et qui finira par avoir raison de lui. Car au fond, le matériau de son oeuvre, omniprésent dans sa trame, c’est le temps, ce temps rassemblé à mesure qu’il s’écoule, ce temps qui « s’élance en avant, s’esquive, s’épanouit, s’effrite, et se surexpose » (1), ce temps lâche, qui s’enfuira par une porte dérobée avant la fin de la représentation.
Antonio Lopez, né à Puerto Rico en 1943, reste l’une des figures les plus importantes et remarquables du monde de la mode des années 60 à 80. Très jeune, à l’âge de 7 ans, sa famille s’installe à New York, sa ville d’adoption qui deviendra plus tard le grand théâtre de sa création.
Il étudie à la Fashion Institute of Technology, où il rencontrera son partenaire, Juan Ramos qui exercera une influence majeure sur l’ensemble de son oeuvre, et l’accompagnera dans la création et l’ascension de ce monde vertical.
À partir des années 60 Antonio Lopez devient illustrateur de mode, et est publié dans de nombreux magazines tels que Vogue, Elle, The New York Times, ou Harper’s Bazaar. Il collabore, à New York, avec des artistes, des éditeurs, comme Andy Warhol ou Diana Vreeland puis s’installe à Paris en 1969. Il y travaille avec Yves Saint-Laurent et Karl Lagerfeld durant quelques années, le temps de devenir, lui et ses “Antonio’s Girls”, une figure emblématique du monde de la mode parisienne.
Antonio deviendra son éponyme. En s’affranchissant de son nom de famille, il recrée la sienne propre. Cette famille est aussi un peu sa cour. Elle se constitue de muses et modèles, dont il a d’ailleurs contribué à leur insu à lancer la carrière comme celles de Jerry Hall, Grace Jones, ou Jessica Lange. Et puis d’innombrables amis, amants, et artistes, qui gravitent autour de lui nuit et jour, comme des doubles de proximité chargés de tromper sa propre solitude, et de le délester de son ombre comme Peter Schlemihl dans le récit de Chamisso.
De retour à New York en 1975, il travaille sans relâche sur de nombreux projets de campagnes publicitaires et perpétue l’inertie de cette carrière fulgurante jusqu’à ce que sa mort soudaine n’y mette un terme définitif alors qu’il n’avait que 44 ans. Antonio Lopez décède du Sida le 17 mars 1987, à Los Angeles, laissant une oeuvre considérable, une déclaration esthétique et rhétorique qui se dissoudra dans l’épaisseur de l’Histoire de l’Art.
Si la mode était son sujet, elle n’en restait pas moins son prétexte. Prétexte à dire la beauté, la sensualité, la sexualité, la vie, le temps.
Son temps.
Car “la mode, comme la définira Coco Chanel, n’est pas quelque chose qui existe uniquement dans les vêtements. La mode est dans l’air, portée par le vent. On la devine. La mode est dans le ciel, dans la rue.” La mode, Antonio Lopez la portait, l’incarnait, l’habitait. C’était une question d’attitude, et probablement de vie ou de mort. Car si la mort a eu raison de lui bien trop tôt, son corps tout entier irradiait la vie. Une vie ardente, exaltante, passionnée, lumineuse, toujours portée jusqu’à son paroxysme par l’élan vital de sa création et son besoin impérieux de chercher sans jamais réellement se soucier de trouver.
Et puisque pour Antonio la mode était un prétexte à générer des formes, elle était aussi un prétexte à déconstruire les langages pour en libérer leur sens, et reconstruire le sien, « cet intraduisible corps des langues ».(2)
Dessins, Collages, Instamatics, Polaroids, Films. Tout semble prendre part au projet stendhalien de rassembler les évènements d’une expérience discontinue dans une narration totalisante. On retrouve dans l’oeuvre de Lopez, cette même caractéristique propre à Stendhal, celle de l’intertextualité, comme si un langage par sa simple proximité transformait les autres formes de langages qui le modifieraient en retour.
Il tresse ces langages ensembles, générant des passages, des géographies, des entre-deux où circule la pensée, comme dira Michel Foucault. Il construit un monde en expansion dont il sera le Maître absolu, un monde qui déborde sur l’empire des signes et du sens, créant ainsi une oeuvre plurale et complexe, jusque dans ses plus lointaines profondeurs, faisant de lui non plus un illustrateur de mode, mais un artiste, un visionnaire, « Le Peintre de la Vie Moderne » (3)
Quand il dessine, les yeux rivés sur son modèle, il se laisse happer par l’ivresse que seul l’instant présent peut procurer, il se laisse posséder par le tempo de sa propre respiration et projeter dans un état transitoire dont l’issue ne peut être qu’une absence.
« Un soupir, un silence, un mot, une phrase, un vacarme, une main, ton modèle tout entier, son visage, au repos, en mouvement, de profil, de face, une vue immense, un espace restreint…et puis, la force éjaculatrice de l’œil » (4)
Quand il dessine, même s’il instaure un rapport de distance jamais franchi, il se tient au plus près de son modèle, il l’empoigne, l’étreint, le dévore et laisse advenir la forme, dans ce corps à corps irréel dont le trait n’est plus que la trace de la jouissance. Et c’est toute la puissance de son corps retenu qui vibre dans la portée de ce geste, un geste sans détour, sans reprise ni repentir. Un geste précis et précipité, parfois, comme si de cette précipitation quelque chose allait advenir ou disparaître. Peut-être serait-ce à cet instant là que le dessin devient « une affirmation de soi, et un refus aussi (…), une sorte de frémissement de l’être. (5)
Car, c’est dans la nudité du dessin, dans son aspect sommaire et concis, qu’Antonio Lopez saisit une temporalité. Il archivera grand nombre de ces « dessins instantanés », à la manière de Rodin dans la dernière période de sa vie qui d’un jet et à grands traits, sans même regarder sa feuille de papier, répertoriait des morphotypes de corps, d’attitudes, et d’expressions qui documenteront comme des photographies, la pose de ses modèles avec ce souci de toujours capturer « la vérité toute entière ». (6)
Les dessins instantanés d’Antonio Lopez, répondent, eux, à un questionnement immédiatement lié au saisissement du temps, et non pas à une esthétique en soi. Paradoxalement il résoudra cette problématique de la capture de l’instant par le dessin et non pas par sa pratique du Polaroid ou de l’Instamatic qu’il emmènera vers d’autres digressions du langage.
S’il apparaît dans grand nombre de ses dessins et études l’idée d’instantanéité, certains d’entre eux consignent aussi le principe de simultanéité, un principe dont l’usage, au théâtre comme en peinture remonte au moyen âge. Des artistes comme Hans Memling, Nicolas Poussin, ou Antoine Watteau dont Antonio Lopez connaissait bien l’oeuvre, ont eu recours à ce procédé qui permettait de représenter dans un même espace pictural les épisodes successifs d’une histoire mettant en scène chronologiquement les acteurs dans différentes situations, comme s’il s’agissait d’une séquence cinématographique.
Un des tableaux de Watteau les plus représentatifs de ce principe est « L’embarquement pour Cythère » peint en 1717, et dont la lecture de ces saynètes se fera de droite à gauche, dans l’espace du tableau, tel que Rodin lui-même en fera la description :
« Ce qu’on aperçoit d’abord est un groupe composé d’une jeune femme et de son adorateur. L’homme est revêtu d’une pèlerine d’amour sur laquelle est brodé un cœur percé, gracieux insigne du voyage qu’il voudrait entreprendre. (…) elle lui oppose une indifférence peut être feinte (…) le bâton du pèlerin et le bréviaire d’amour gisent encore à terre. À gauche du groupe dont je viens de parler est un autre couple. L’amante accepte la main qu’on lui tend pour l’aider à se lever. (…) Plus loin, troisième scène. L’homme prend sa maîtresse par la taille pour l’entraîner. (…) Maintenant les amants descendent sur la grève, et, (…) ils se poussent en riant vers la barque; les hommes n’ont même plus besoin d’user de prières: ce sont les femmes qui s’accrochent à eux. Enfin les pèlerins font monter leurs amies dans la nacelle qui balance sur l’eau sa chimère dorée, ses festons de fleurs et ses rouges écharpes de soie. Les nautoniers appuyés sur leurs rames sont prêts à s’en servir. Et, déjà portés par la brise, de petits Amours voltigeant guident les voyageurs vers l’île d’azur qui émerge à l’horizon. »
Antonio Lopez utilisera souvent ce procédé dans de nombreux dessins comme “Newsweek Disco Story”, en 1976, représentant les tempos d’un couple de danseurs se déplaçant dans l’espace, comme s’il s’agissait d’un dessin cubiste qui découperait le temps en micro fractions et s’agancerait tout autour d’un axe central. Ou encore ce collage réalisé pour Interview, le magazine de Warhol, mettant en scène Jacques de Bascher, Leon Talley et Karl Lagerfeld dont la figure sera dédoublée et déclinée, selon un principe de variation propre à la musique, sur une séquence d’Instamatics collés dans le dessin lui- même, induisant alors un déplacement à la fois diachronique dans l’image, et une désynchronisation. Comme si cette séquence se dilatait et devenait une boursouflure du temps.
Dans ses séries filmiques, basée sur ce principe de variation, Eric Rohmer, dira:
«J’ai conçu mes Contes Moraux à la manière de six variations symphoniques. Comme [le musicien], je varie le motif initial, le ralentis ou l’accélère, l’allonge ou le rétrécis, l’étoffe ou l’épure.»
C’est ce même mécanisme qui habite certains dessins d’Antonio et très souvent ses séries de Polaroids et d’Instamatics réunis en séquences réelles ou recomposées de 9 images, le plus souvent. Il transpose alors des caractéristiques propres à l’écriture cinématographique dans un langage fondamentalement libre et ouvert. C’est le lieu de la mise en scène du regard et de sa pensée.
Et puisqu’un médium chasse l’autre et prend sa place, lorsqu’Antonio empoignait sa caméra super 8 sur un coup de tête, c’était pour interpréter des états d’âmes, insaisissables par le crayon, le pinceau ou la plume. Il se laissait emporter par l’improvisation de ses films, emmenait sa troupe avec lui le temps d’un coup de théâtre où il devenait le témoin caché des pièces de Molière et ses comparses, des personnages qui se moquent de tout et se jouent de la vie. Une scène, des mimes, des masques, et cette dissonance avec le réel qui est le secret du théâtre (7) dira Antonin Artaud. Cette dissonance, c’est aussi l’endroit, dans l’oeuvre d’Antonio, où tout se joue, l’endroit d’une grande solitude intérieure, là où il fait face à l’étrange, au merveilleux, à l’inexplicable, “au plus profond de lui, dans l’obscurité, dans l’ineffable, dans l’inconscient, dans cette région où son propre entendement n’accède pas. Là où l’éternité pénètre les jours “(8) et vibre encore sous nos yeux.
Anne Morin.
(1) Sylvia Plath « Une comparaison » dans « La Cloche de Détresse », 1963
(2) Jacques Derrida
(3) Charles Beaudelaire « Le Peintre de la Vie Moderne », 1863
(4) Robert Bresson « Notes sur le cinématographe », 1975
(5) Pierre Restany « La Révolution du Signe » à propos de Cy Twombly, Novembre 1961 (6) Roger Marx, écrivain et ami de Rodin, 1897
(7) Antonin Artaud « Le Théâtre et son Double » 1938
(8) Rainer Maria Rilke “Lettre à un jeune Poète”, 1929