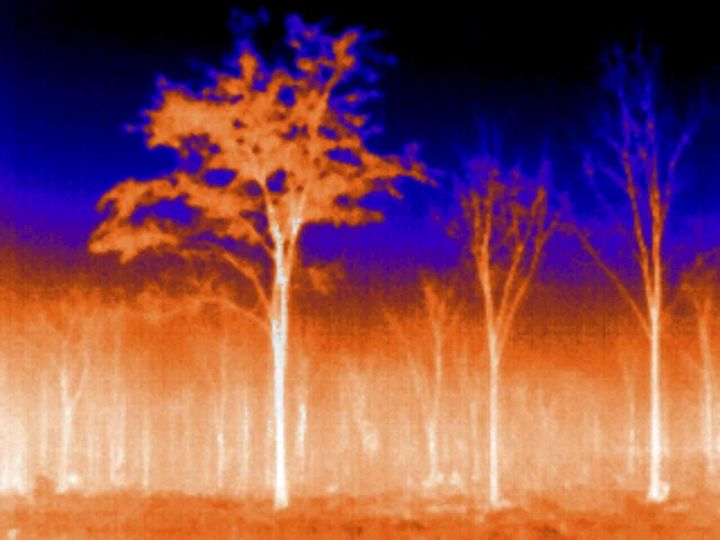C’est donc la quatrième édition du Image Festival de Amman, dont nous n’avions pas entendu parler… Initié et soutenu par l’Institut français, il est né à l’initiative de son actuel directeur, Charles-Henri Gros, qui voit, le cœur un peu lourd, son départ annoncé pour l’été prochain après quatre années sur le terrain. Il n’est pas fonctionnaire et, comme tant d’autres contractuels dans ces postes d’Instituts français, il doit faire son deuil car l’administration ne saurait envisager par les temps qui courent de devoir titulariser de nouveaux agents…
C’est lui qui a voulu ce festival, qui le justifie, qui le laisse entre les mains de Rachel Bizen, sa collaboratrice — et seule salariée œuvrant dans les activités culturelles à l’Institut —, mais aussi entre celles de Linda Al Khoury, jeune photographe formée à Beyrouth parce qu’il n’y avait rien en Jordanie et qui, au retour, a ouvert une maison des photographes afin de donner des cours et de créer une communauté autour de l’image fixe. Par accord signé dès la deuxième édition, c’est elle qui reprendra le flambeau au cas où le prochain directeur ne s’intéresserait pas à l’image fixe.
Dans une ville de près de trois millions d’habitants — pour un petit pays de six millions et demi dont près de deux millions de Palestiniens et maintenant sans doute sept cents mille réfugiés syriens — qui est toute en collines et lacis, il n’est pas aisé de focaliser l’attention sur un événement artistique. Constatons que la signalétique, ou plutôt sa quasi-absence n’y aident pas, même si beaucoup de lieux et galeries privés s’associent volontiers à la manifestation. Il n’empêche que l’enjeu est réel, comme le souligne Charles-Henri Gros. Dans un pays de très large majorité musulmane, dans un pays qui est également un pays récent et un des seuls de la région à avoir signé un accord de paix avec son voisin israélien, dans un pays où la tradition bédouine reste forte, la question du rapport à l’image se pose. Quand Internet balance son flot d’images chez les iconoclastes, quand l’iconographie politique et l’image des martyrs joue le rôle que l’on sait, la capacité à lire les images est un enjeu de société, un enjeu de paix, un enjeu majeur en tout cas. Et le festival apparaît donc comme parfaitement légitime.
Malgré un budget correct grâce au savoir-faire du directeur dans la recherche de partenariats, le résultat est assez déroutant. Il est parfaitement légitime — et c’est presque la seule touche qui pourrait être lue, sur place, comme « politique » même si l’auteur ne l’a pas souhaité — de faire découvrir aux Jordaniens, en projection, en grand format, les panoramiques remarquables du « Wall » de Josef Koudelka, fut-ce à l’avant-dernier étage d’un mall commercial peu accueillant. Il est plus dérangeant que, le jour où nous avons pu le voir, ni la netteté ni la couleur — virant à l’aubergine — de la projection n’aient permis une perception correcte du travail. Ce genre de « détail », on le retrouve hélas dans trop d’expositions, trop peu soignées, avec des tirages peu exigeants, derrière des verres granuleux qui empêchent de voir l’image — un summum étant atteint avec la désolante présentation des jumeaux de Hiba Abdallat, avec des légendes collées à même le cadre, avec des contrecollages qui n’ont pas de sens ni de raison.
Il y a pourtant des lieux, certains extraordinaires et qui font rêver de possibles, comme plusieurs galeries privées — Dar Al Anda, Nabad Gallery, entre autres — ou cet espace de la galerie municipale Ras Al Ein Gallery, qu’un désespérant photographe grec arpentant puis photoshopant des sites archéologiques et des colonnades antiques n’a pas réussi à remplir (!!!), alors que l’on n’a pas utilisé l’extraordinaire salle toute proche d’un ancien atelier électrique ni l’espace devant elle, qui semble idéal pour une présentation en extérieur. Il semblerait qu’il s’agisse de problèmes ponctuels, la nouvelle municipalité n’ayant pas encore eu le temps de prendre les choses en main après que la précédente ait eu maille à partir avec la justice.
Il y a plein de choses sympathiques, des personnages extraordinaires — la si généreuse directrice de Dar Al Anda, Majdoline Al-Ghazawi Al-Ghoul, dont on aimerait bien voir la collection, ou « Le Duc » Mamhoud Bisharat, dont on voudrait aussi voir la collection et visiter les fermes — et des lieux magiques comme ce Diwan bien intégré lui au circuit, mais pas si facile que cela à repérer comme espace du festival.
En termes de contenu, si l’on a le plaisir de découvrir deux ou trois photographes jordaniens de qualité et en devenir, on s’étonne tout de même de choses bien approximatives, faciles, clichés alors que, pour ne parler que d’eux, il y a dans la région d’immenses artistes palestiniens — de l’intérieur, basés au Quatar, en Arabie Saoudite, dans les Emirats — qui rencontreraient certainement un écho auprès de la forte communauté établie en Jordanie. Sentiment d’une direction artistique trop floue, pas assez déterminée alors que Amman pourrait être, à l’évidence, un lieu central pour l’image dans la région, voire, au-delà, dans le monde arabe et, pourquoi pas, dans l’espace méditerranéen .
Entre autres belles initiatives la résidence d’artistes donné au groupe (photographes, écrivain, graphiste) N.N.P.A.S. qui, dans une installation réalisée en un temps record, dans un beau dialogue entre jeunes créateurs, apporte sinon un modèle — méfions-nous comme de la peste —, du moins une ouverture pour les jeunes créateurs locaux qui peuvent se confronter à cette expérience et y avoir accès.
Naturellement, les événements, nombreux, qui se multiplient dans un festival difficile à saisir parce que les vernissages s’étalent sur tout le mois, tous les deux jours en gros, intéressent et touchent le public. A commencer par la Nuit de l’Année réalisée avec Les Rencontres d’Arles pour un parcours dans la populaire et branchée Rainbow Street.
Ce festival d’Amman que l’on sent tellement nécessaire, pour lequel on a tellement de sympathie, laisse un peu sur sa faim en termes de contenu, d’orientation, d’angle.
D’autant qu’il est difficilement compréhensible — il doit s’agir de questions complexes d’egos… — que n’y soit pas associée, ou que n’ait pas voulu participer, la Khalid Shoman Foundation, lieu sublime, à l’extraordinaire collection, qui fête ses vingt-cinq ans d’existence avec des œuvres allant de 1914 à une jeune artiste vietnamienne en résidence utilisant la photographie. Vous avez dit « Together » ?
Dans l’espace réservé aux expériences, cette fondation présente le travail du jeune Shuruq Harb, de Ramallah. Une petite installation d’icônes contemporaines banales et de masse, une vidéo extraordinaire sur la consommation actuelle des images par la voie d’un petit vendeur de ces rectangles de papier dont il analyse els circuits commerciaux : la plus convaincante des réflexions sur l’image vue depuis longtemps.
Comme le lieu n‘est pas dans le festival, nous lui consacrerons un traitement à part la semaine prochaine…