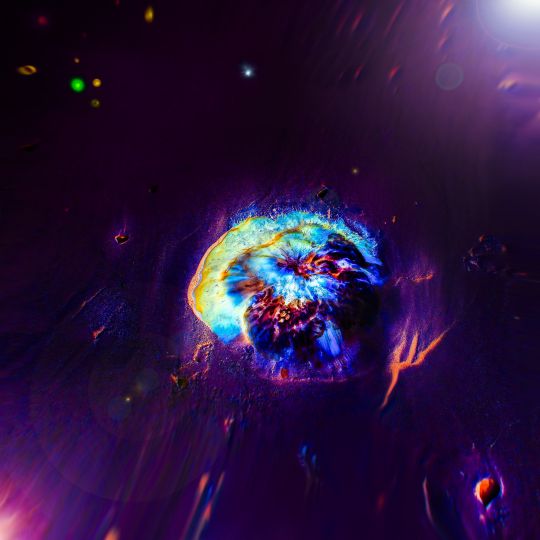Voler avec la Patrouille de France, c’est pour le photographe que je suis éprouver un sentiment unique d’excitation et d’angoisse.
Excitation de se sentir libre comme l’air, comme un oiseau. D’échapper à l’esprit de pesanteur. De tutoyer les anges dans le coton des nuages. D’approcher le secret de ces pionniers du ciel qui m’ont toujours fait rêver, tel Adolphe Pégoud qui, en 1913, effectuait la première boucle de l’histoire de l’aviation.
Angoisse quand je me glisse sur mon siège éjectable, prêt à jouer son rôle de fusée. Je sais qu’en cas d’éjection, l’accélération peut atteindre 18 G, soit une pression de plus d’une tonne sur mon corps. Pour y résister, penser à garder impérativement la tête parfaitement droite avant de tirer sur la poignée. Penser que les sangles fixées au niveau des genoux me ramèneront automatiquement dans la trajectoire avant que je sois propulsé à travers la verrière préalablement fragilisée par un cordon d’explosifs.
Engoncé dans ma combinaison anti-G, je suis ficelé comme un paquet, je ne peux plus bouger. Mais elle est indispensable. Grâce à elle, les boudins du pantalon se gonflent quand l’Alphajet accélère, empêchant le sang de descendre trop vite vers le bas du corps et permettant au cerveau de continuer à être convenablement irrigué. Sans cela, c’est le manque d’oxygène assuré, la vision se trouble, se couvre d’un « voile gris », première alerte avant le « voile noir », synonyme de perte de connaissance et hantise de tous les pilotes.
Le mécanicien ajuste les harnais et me sangle le corps. Le casque sur la tête, le masque à oxygène sur le visage, impossible de coller le viseur de mon Nikon contre mon œil et d’avoir 100% du cadrage. Entre mon masque et le cockpit, vingt centimètres d’espace… je me sens encapsulé, coupé du monde extérieur, je n’entends plus que ma propre respiration, amplifiée par le micro de mon masque. Une respiration profonde, avant de décoller, mais sitôt en vol je la bloque, pour mieux supporter les accélérations ; pourtant, au bout de trente secondes, l’alarme se déclenche systématiquement et mon pilote me pose toujours la question : « Alain, ça va ? » Ça va. Cette alarme a pour fonction de réveiller pilote ou passager victime d’évanouissement.
Le plus difficile pour moi, changer de film, et aussi être jeté contre la paroi du cockpit, malaxé, malmené par l’apesanteur, contraint de fournir des efforts physiques indescriptibles, de subir des pressions à la limite du supportable. Mais c’est le prix à payer pour avoir la chance de voler avec l’une des meilleures patrouilles du monde. Pour mieux comprendre : lors d’une accélération de 8 G, mon corps pèse environ 500 kilos et mon Nikon huit fois son poids normal. Je dois néanmoins le tenir à bout de bras afin de shooter, le plus souvent la tête en bas…
Et pourtant, dans ce jeu entre le photographe et les avions, aucune place n’est laissée à l’improvisation. Chaque séance se décide au sol, au cours du briefing avec le Leader. Je propose mon scénario et mes idées de photos. Chacune est le fruit d’un long travail de préparation, d’autant plus minutieux qu’il faut essayer de prévoir au maximum les inévitables difficultés techniques rencontrées en vol où le danger peut surgir au moindre dixième de seconde. Le Leader décide ensuite avec ses équipiers du meilleur moment pour réaliser les prises de vues. Puis il découpe le vol, le rôle et la position de chacun, avec une précision chirurgicale. Ces préparatifs terminés, les avions lancés, le travail d’équipe se poursuit : une attention de tous les instants entre les pilotes et moi, pour saisir au plus près les incroyables figures réalisées par ces chevaliers du ciel. En quinze ans, plus qu’une bonne coopération, il s’est noué entre nous une véritable complicité. Merci à cette famille très fermée d’avoir accepté l’intrus que j’étais, et de m’avoir donné le bonheur incomparable d’associer mes passions – la vitesse, la lumière, le ciel – en volant avec elle.
Alain Ernoult