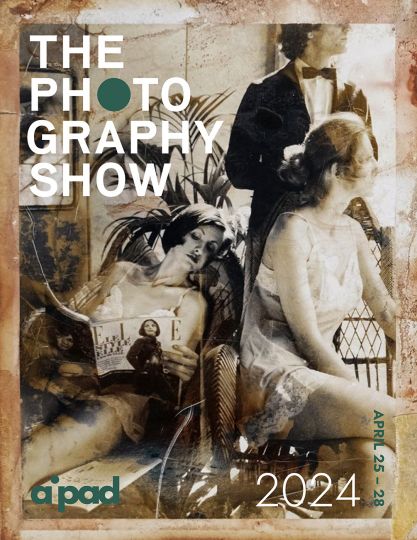La Diaspora Chinoise de Pok Chi Lau, une exposition d’un photographe sino-américain en Chine
Un essai de Jean Loh
En 2005, lorsque j’ai rencontré Pok Chi Lau pour la première fois, nous participions tous les deux au premier festival de photo de Lianzhou. L’année suivante, il est venu à Shanghai avec un groupe d’étudiants de l’Université du Kansas, où il enseignait. Nous avons eu un long échange avec ses étudiants sur la photographie documentaire, et Pok Chi Lau m’a offert son livre, « Dreams of the Golden Mountain ». J’ai été si impressionné par son histoire personnelle que j’ai fini par organiser une exposition à Shanghai de sa série « Red Walls », qui était l’une de ses œuvres les plus créatives. Les « Murs Rouges » sont des diptyques, une image en noir et blanc racontant l’expérience de son retour dans sa maison ancestrale du Guangdong, et une image en couleur sur les traces restantes de la Révolution Culturelle sur les murs. Ce fut aussi la première fois que j’appris par Pok Chi Lau les histoires choquantes des continentaux traversant la rivière des Perles à la nage dans les années 1970 pour atteindre Hong Kong comme réfugiés clandestins, en se servant de baudruches, de ballons de basket, voire de préservatifs….
Mais je me suis vite rendu compte que Pok Chi Lau s’était toujours focalisé sur le sujet de la diaspora chinoise, en particulier en Amérique du Nord et du Sud. Sa collection de portraits d’immigrants chinois en Amérique, de la première à la troisième génération, y compris des descendants métis d’origine asiatique avec des parents caucasiens ou asiatiques avec des parents afro-américains et des parents latinos, me semble une poursuite à long terme de sa propre quête d’identité.
A titre personnel, j’ai toujours ressenti une forte empathie et un lien de parenté avec la quête d’identité de Pok Chi Lau, qui après avoir quitté son lieu de naissance – Hong Kong avec son identité coloniale – pour l’Amérique, et épousé une femme américano-japonaise, est devenu le père d’un fils sino-japonais. Je suis moi-même né à Saigon en Indochine française, d’un papa de Shanghai et d’une maman de Fujian, je suis ensuite venu en France où j’ai épousé une franc-comtoise et élevé une fille sino-française. J’ai deux sœurs aux Etats-Unis qui ont épousé des maris américains et ont eu des enfants métisses, un frère en France avec une femme française et qui a trois enfants de race mixte, et un autre frère en Guyane française et a des jumeaux avec une française de Martinique. Mon père, qui a quitté Shanghai en 1939, se plaignait à moitié que ses petits-enfants n’avaient plus de sang pur chinois, puis il plaisantait en disant que sa progéniture pourrait désormais former une Organisation des Nations Unies. C’est ce que Pok Chi Lau appellerait « la Fédération Arc-en-ciel », sauf que «arc-en-ciel » ait désormais une connotation différente en rapport à la communauté LGBTQ.
Lorsque j’ai rencontré Pok Chi Lau, j’avais déjà une vague idée de la diaspora chinoise du XIXe siècle, en particulier des cantonais qui ont quitté leur domicile pour émigrer en Amérique à la recherche du « Rêve de la Montagne Dorée ». En 2002, j’ai découvert et photographié moi-même les Diaolou (forteresses) de Kaiping, avant qu’elles ne soient classées par l’UNESCO comme patrimoine mondial. Les Diaolou sont un groupe d’étranges constructions fortifiées avec un style architectural bâtard, construit à la fin du 19e et au début du 20e siècle par des Chinois de retour de la Ruée vers l’or Californienne. Ils sont uniques dans la région de Kaiping et Toishan, dans la province du Guangdong. À l’époque, un jeune documentariste de la mairie de Kaiping qui supervisait le comptage des plus de huit cent Diaolou pour leur inscription à l’UNESCO, m’a servi de guide pendant trois jours, il m’a montré quelques-uns des plus spectaculaires. Dans un village, j’ai utilisé mon cantonais rouillé pour demander à une habitante si je pouvais visiter l’intérieur d’un Diaolou ; elle a très gentiment accepté. Elle est rentrée chez elle pour revenir avec un gros trousseau de clés et a ouvert une porte en fer pour moi. Ce que j’ai vu dans l’obscurité à l’intérieur m’a vraiment marqué, les étages supérieurs ont été inoccupés pendant longtemps, je pouvais à peine distinguer parmi les ustensiles de cuisine rouillés des valises en cuir, qui, selon elle, ont été ramenées de la Montagne Dorée (San Francisco) par ses ancêtres. C’est ainsi que je suis finalement amené à faire des recherches sur l’histoire des Diaolou et de leurs bâtisseurs. J’ai photographié les Diaolou des villages de Chikan, de Zilicun et de bien d’autres, y compris un Diaolou penché comme la tour penchée de Pise en Italie. Il y avait un village totalement inhabité qui s’appelait Village Canada niché dans une véritable jungle, les propriétaires de ces belles villas et des diaolou les avaient abandonnés pour aller vivre au Canada. Le village était recouvert d’une épaisse végétation sauvage et d’une bananeraie qui le dissimulaient à la vue des étrangers. La plupart des habitants ont quitté la Chine « vendus comme des porcelets » (Mai Ju Zai en cantonais) par des trafiquants d’esclaves. Au lieu de Rêves de la Montagne Dorée, ils ont dû subir des traitements cauchemardesques avant de finir comme coolies (force amère) dans les champs de coton et les plantations américaines, ou comme travailleurs sur le Transcontinental Pacific Railroad qui fut construit entre 1863 et 1869. La plupart de ces premiers immigrants chinois venaient de la région de Kaiping et de Toishan. Lorsque le Great Railroad fut achevé, tous les grands patrons, les politiciens et les ingénieurs se réunirent à Promontory Point, dans l’Utah, et posèrent pour une photographie de célébration, sur laquelle aucun Chinois ne figurait. Alors que l’influence de ces travailleurs chinois peut encore se faire entendre aujourd’hui dans la culture américaine, par exemple, « chow » pour « friture » en cantonais, et qui devient « cantine ou cuisine collective» dans l’argot américain, ou « ketchup » qui vient du dialecte cantonais voulant dire « jus de tomate », car, quand les Chinois n’étaient pas employés comme cheminots, ils étaient employés comme cuisiniers et / ou comme blanchisseurs pour les cowboys et les ingénieurs des chemins de fer, et la cuisine chinoise si appréciée entra ainsi dans la culture américaine.
Le livre de Pok Chi Lau, « Dreams of the Golden Mountain », publié en 2002 portait sur la couverture le visage d’un nouveau-né endormi, rêvant apparemment de la Montagne Dorée. C’est Tyler, le fils de Pok Chi Lau né en 1988, que j’ai rencontré à plusieurs reprises. L’image me rappelle le portrait d’un bébé endormi de Diane Arbus (Anderson Cooper NYC 1968). D’une certaine manière, les premiers travaux en noir et blanc de Pok Chi sont marqués par l’influence de la photographie documentaire américaine, dans laquelle les décors et les personnages ont des correspondances subtiles, et dont les détails révèlent souvent leurs sens cachés. En effet Pok Chi Lau a minutieusement documenté les intérieurs des Chinois âgés installés depuis longtemps en Amérique, ainsi que des chinois « boat people » plus récemment arrivés du Vietnam, avec tout leur attirail culturel comme des calendriers et leur autel des ancêtres. Par exemple, dans ce portrait insolite d’une femme à tête plate qui est la patronne d’un restaurant, assise fièrement dans son fauteuil, dans la salle d’attente de son restaurant chinois à Pittsburg (Pennsylvanie), flanquée d’une grande statue en céramique de la Bodhisattva et d’une représentation en céramique de Guan Gong le dieu des arts martiaux, qui sert de lampadaire (Pittsburg Pennsylvanie 1977). Ou bien cette photo d’un couple métissé, une jeune femme sino-vietnamienne nommée May, sa tête posée tendrement sur l’épaule de son copain afro-américain, Quincy, qui porte un collier avec le symbole yin-yang du Tai Chi, qui illustre l’interaction entre le blanc et le noir (Asian-American Festival Wichita, Kansas 1991). Lorsqu’il ne photographie pas les gens, Pok Chi se concentre alors sur les détails, tels que cette vue de dos d’un Cow-Boy musicien attablé dans un restaurant et portant un chapeau Stetson, on peut lire sur la fenêtre des lettres peintes à l’envers en espagnol : « Café Flor de Lotus », il s’agit bien d’un restaurant chinois (Tijuana Mexico 1993). Ou dans une autre maison d’immigrants chinois, où l’on trouve trois sculptures en céramique exposées côte à côte au-dessus de fleurs en plastique : une statue de Jésus, une autre de la Bodhisattva, et la dernière était le général Guan Gong le dieu martial, signes que le propriétaire pourrait être un chrétien chinois aux influences bouddhistes, taoïstes et même confucianistes (San Francisco 1983).
Au fond, la fierté de Pok Chi Lau de pouvoir parler le cantonais et le dialecte toishan à ses sujets démontre son mal du pays, qui est associé à sa recherche d’identité qui l’a poussé à repérer des immigrants chinois vivant seuls en Amérique. Dans sa description poignante d’une Dame Lo, une veuve qui vivait seule dans la ville de Laurence au Kansas, elle lui rappela sa nostalgie du dialecte toishan, et aussi de Lam Bak, l’un des vieux célibataires chinois d’outre-mer qu’il a documentés, vivant seul au numéro 858 de la rue de Washington à San Francisco, qui n’a plus revu sa famille depuis 1948. La sobre représentation du vieux marin Leung Fat, résident solitaire du quartier chinois de New York, où la seule décoration de sa chambre qui se démarquait était une boîte vide de cacahuètes Planters qui servait d’encensoir pour des bâtonnets d’encens à la mémoire d’un ami décédé. Le vieux Mister Chen de l’hôtel Mandarin à San Francisco qui vivait seul et n’avait pas descendu l’escalier depuis treize ans, le vieil homme demanda à Pok Chi : « Pourquoi voulez-vous me photographier ?» La réponse de Pok Chi nous donne une bonne explication de ses motivations : « Je veux raconter l’histoire des Chinois de la diaspora dans les Amériques, comment ils ont travaillé dur toute leur vie pour préparer le terrain à leurs enfants et petits-enfants. J’espère que ces photos aideront à convaincre l’administration publique à construire davantage de logements sociaux pour les personnes âgées chinoises ». Quelques années plus tard, lorsque Pok Chi est retourné à l’hôtel Mandarin à la recherche de Mister Chen, un résident du rez-de-chaussée lui déclara qu’il n’avait jamais rencontré l’homme vivant à l’étage du dessus mais qu’il l’entendait souvent jouer du violon, mais qu’à présent il était décédé. Ces portraits rendent compte du profond sentiment de compassion de Pok Chi Lau. Son travail documentaire l’a même conduit à une découverte inattendue : Il a découvert que son propre arrière-grand-père maternel avait travaillé pour l’American Pacific Railroad. Cette découverte a ajouté encore plus de sens et d’émotion à sa quête infatigable. Cela est particulièrement évident quand il se lamente et se demande comment ces célibataires chinois âgés, vivant dans des conditions précaires, dans la décrépitude ou dans le désert comme son arrière-grand-père, pouvaient satisfaire leurs besoins sexuels. Il décrit l’histoire de Mexicali, une bourgade construite par des immigrants chinois dans un désert au Mexique, où il raconte la solitude et la douleur de ces hommes qui n’ont jamais eu de relation sexuelle avec une femme jusqu’à leurs derniers jours. Une humanité oubliée et livrée à la désolation.
L’endroit où Pok Chi Lau a ressenti la plus forte perte d’identité était à Shenzhen, quand en 1979 et 1984, il faisait des allers-retours de l’Amérique à Hong Kong et se rendait à Shenzhen pour documenter les migrants venus de toutes les régions de Chine, un peu comme si c’était leur ruée vers l’or. Lors d’une navette entre Shenzhen et Hong Kong pour récupérer à l’école son fils de cinq ans né aux États-Unis, le gardien de l’école se mit à lui parler en dialecte toishan, ému, il se demanda à voix haute : « Qui sommes-nous, père et fils ? Sommes-nous de cette planète Terre ? Descendu à peine de l’avion d’Amérique, je n’ai même pas eu le temps de m’installer à Hong Kong que je suis parti au Vietnam pour un mois. Rentré à Hong Kong, j’ai dû aller à Shenzhen pour observer ces chinois du Nord qui ont migré vers le Sud pour gagner leur vie. Maintenant, je croise un compatriote de mon pays d’origine Toishan, mais j’ai vite réalisé que mon dialecte toishan était celui que j’ai appris auprès de vieux immigrants chinois dans une petite ville du nord-est du Canada ! Nous avons tous migré, étape par étape, vers des pays étrangers. Une migration de masse à une telle échelle et avec une telle vitesse c’est sans précédent dans l’histoire du monde. »
De tous les portraits de Pok Chi Lau, celui qui m’a le plus marqué reste la femme sans domicile fixe avec laquelle il s’est lié d’amitié à Hong Kong, mais qu’il n’a jamais eu le courage de photographier, « afin de préserver sa dignité », a-t-il déclaré. C’est la cantonaise qu’il avait baptisée « la Madona de la rue ». En juillet 1997, lorsqu’il photographiait la rétrocession de Hong Kong à la Chine, il pensait que ce serait le dernier chapitre de son documentaire de 25 ans sur la diaspora chinoise. « Même sans avoir pris une photo d’elle, a écrit Pok Chi Lau, elle me manque toujours beaucoup. En fait, c’est la Hongkongaise qui me manque le plus. Cette « photo » jamais faite restera à jamais gravée dans mon cœur. » C’était sans compter avec la découverte des descendants des chinois immigrés a Cuba.
De Mexique à Cuba, il y avait quand-même beaucoup d’eau à traverser, mais c’est à Cuba que Pok Chi fit sa découverte la plus remarquable. En 2009, il découvrit l’histoire de la pire traite des travailleurs chinois (qu’on appelait des coolies, « force amère »), la plus inhumaine et la plus triste aux XVIIIe et XIXe siècles de la Chine aux Antilles. Entre 1820 et 1870 pour seulement Cuba, les colonialistes anglais et espagnols avaient importé 140 000 coolies chinois pour remplacer les esclaves africains dans les mines et les plantations. En six voyages successifs, la persistance de Pok Chi Lau lui a permis de découvrir non seulement des traces, des symboles ou même des ossements anonymes d’immigrants chinois du passé, mais aussi des descendants en chair et en os qui y vivent encore. Non seulement les chinois ont immigré, mais la culture chinoise s’est déplacée et installée sur place, malgré le départ massif des chinois après la Révolution Cubaine, et ces témoignages représentent la plus grande contribution de Pok Chi Lau.
Non seulement les paysans chinois sont venus à Cuba pour travailler dans les mines et les plantations ou pour cultiver la terre, ils ont même participé à la guerre d’indépendance de Cuba, comme le rapporte Pok Chi Lau. Entre deux mille et trois mille « Chino-Mambisa » ont combattu pendant la guerre et cinq mille d’entre eux ont servi dans la logistique à l’arrière-pays, pour se libérer eux-mêmes de la servitude. Le terme Mambi dérive du nom d’un officier noir déserteur de l’armée espagnole – Eutimio Mambi – qui s’est mis à combattre les Espagnols à Saint Domingue en 1848. Chino-Mambisa désigne les rebelles cubains d’origine chinoise. Lors de son voyage de 2009, Pok Chi a retrouvé plusieurs derniers descendants Sino-Cubains de race mixte. Au cimetière de Remedios, il a même fait un selfie devant un parterre de pierres tombales avec cette légende : « J’étais si en colère que mes cheveux se sont dressés sur ma tête, toutes les tombes chinoises ont été profanées et déterrées ».
Puis en 2017, Pok Chi Lau est retourne mener une enquête sur les mines et les plantations de canne à sucre à Cuba. Il a exploré une mine de cuivre à ciel ouvert, El Cobre, où des mineurs chinois travaillaient dans les années 1830 et où beaucoup ont perdu la vie. Plus tard, il a trouvé une mine d’or où les propriétaires américains ont importé quatre cents ouvriers chinois pour y travailler dans les années 1920. Dans la bourgade de Las Tunas, il a déniché un vieil homme de 95 ans peu ordinaire, toujours vivant et plein d’entrain, le dernier des Chinois cubains nés en Chine, Rubin Fang qui continue de pratiquer le kung-fu, est un natif de Toishan. À Chaparra, il a rencontré un Chinois cubain de 74 ans, métis, Julian Chiong Asen, qui élève des coqs de combat, et dont la mère était une métisse d’origine de Enping. De nombreux Chinois cubains étaient originaires de Toishan ou de Enping, deux cantons très pauvres du sud de la Chine à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Ces portraits remarquables, outre leur caractère déchirant, décrivent la survie des migrants et la résilience des traditions et de la culture chinoises dans des pays étrangers, y compris la société Hongmen, célèbre société secrète par le passé, à La Havane, où Pok Chi a rendu visite à un vieux membre qui vit seul, un certain Coco Chan de 90 ans, et a tenté de soulager ses douleurs en lui massant le ventre avec du Baume de Tigre.
Dans presque tous ses portraits de Chinois d’outre-mer, Pok Chi Lau commente les petits détails de l’image qui reflètent l’identité chinoise de ses sujets, qu’ils soient de race mixte de troisième génération ou s’ils n’ont pas de sang chinois mais ont été adoptés par un beau-père chinois, comme Caridad Amaran, ils ont tous à la maison une statue du général Guan Gong, des céramiques de Bouddha, des rouleaux de calligraphie chinoise… Nous savons maintenant que dans la diaspora chinoise tous n’était pas des mineurs, des ramasseurs de coton ou des cheminots, Pok Chi en a même trouvé qui exercent dans les spectacles de chant et de danse, comme ces deux grand-mères remarquables: Cynthia Yee Fong du Chinatown de San Francisco, une danseuse de music-hall, meneuse de revue des Grant Avenue Follies (grantavenuefollies.com), dont le père Fong Wing Taw était originaire de Kaiping; une autre est la cubaine Caridad Amaran de La Havane dont le père adoptif lui a appris à parler le cantonais et à interpréter de l’opéra cantonais, ce père amateur d’opéra s’appelait également Fang, et venait aussi de Kaiping! Deux portraits de femmes si éloignées l’une de l’autre géographiquement mais si proches et si intimement liées grâce à leur héritage chinois, leur dialecte toishan et cantonais ainsi que leur profond amour pour les arts de la scène. Merci à Pok Chi Lau qui a fait tout ce qu’il pouvait pour amener en Chine Caridad et son amie métisse sino-cubaine Georgina Wong (également étudiante de Fang Biao) à la recherche de leur mentor et bienfaiteur. Ils ont finalement trouvé la tombe de Fang Biao au pied du phare du clan des Fang à Kaiping (le même phare Diaolou que j’ai photographié en 2002 à Kaiping). Le moment le plus émouvant ce fut quand les deux cubaines ont enfilé leurs costumes d’opéra, ont chanté et joué devant la tombe de leur parrain, au pied du phare des Fang. C’est assez étonnant de voir la Caridad dans son portrait de profil par Pok Chi Lau, son visage peint d’opéra chinois et coiffée d’un attirail complet d’une « fille aux fleurs » (hua dan), son nez protubérant trahissant sa non-chinoisité. Et de voir la Georgina Wong, l’autre mamie cubaine, toute maquillée et vêtue de costume d’opéra d’un guerrier, toutes deux durant leur représentation au théâtre de Yau Ma Tei à Hong Kong, c’est là que j’ai réalisé le pouvoir mystérieux de la photographie à transcender les identités ethniques, pour créer ces « Persona » (en latin ou en grec prosopa signifiant un masque). Les longues recherches photographiques de Pok Chi Lau reviennent à nous dire qu’au bout du compte, nous finirons tous par devenir une race mixte sur cette planète Terre, et nous ferons tous partie de la diaspora, devenant tous des migrants d’une manière ou d’une autre.
Je ne peux pas m’empêcher de penser à August Sander et à son ambitieux projet de photographier tous les Allemands (Peuples du 20e siècle). Bien qu’il soit impossible de comparer le travail de Pok Chi Lau avec celui de Sander, il y a cependant cette similitude dans leur recherche d’une identité commune, que ce soit parmi les portraits allemands de Sander ou les représentations de Pok Chi Lau des Chinois de la diaspora, même si aucun d’eux n’a trouvé de vraie réponse à la question, qui semblait être la vraie question pour Pok Chi Lau, tout au long de sa poursuite incessante des Chinois américains aux États-Unis, des Chinois cubains, des Chinois d’Asie du Sud-Est en Malaisie, en Birmanie. Le développement de l’album photographique de Pok Chi devient un projet à vie, une poursuite sans fin d’un nouveau concept de documentaire « identitaire », regroupant la photographie, l’histoire, la géographie, l’anthropologie, la linguistique (la capacité de parler les différents dialectes des chinois de la diaspora afin d’interviewer les descendants des Chinois de Canton, des Hakka, Toishan, Hokkien et Teochew), sociologie : études sur les esclaves chinois de la construction de chemins de fer, dans les mines et les plantations, qui sont ensuite devenus révolutionnaires, des combattants pour l’indépendance, et aujourd’hui des politiciens, restaurateurs, blanchisseurs, businessmen et peut-être les plus singuliers : des chanteurs d’opéra cantonnais ! Les efforts louables de Pok Chi Lau dans la recherche et le repérage de ces hommes et femmes presque centenaires, juste avant leur mort, pour écouter et enregistrer leurs histoires et pour prendre leurs portraits. Et quand il ne pouvait pas localiser ces Chinois survivants de la diaspora, il réussissait tout de même à retrouver leurs os et leurs crânes dont il prenait une photo comme si, dans un acte de foi, il pouvait capturer leur âme.
Mon souhait le plus profond est qu’un jour peut-être, Pok Chi Lau puisse poursuivre son travail ici en Europe, frapper à la porte des descendants des travailleurs chinoise venus aider les anglais et les français pendant la Grande Guerre, pour travailler dans les usines ou ramasser les cadavres sur les champs de bataille. Et à défaut, qu’il puisse visiter leurs tombes et photographier leurs ossements.
Jean Loh
L’exposition de Pok Chi Lau est visible du 28 décembre 2019 au 30 Aout 2020 au Musée de l’image historique de YUEZHONG (MoHI) – Parc industriel de Yuezhong, Hanggang North, district de Luohu – ville de Shenzhen, province du Guangdong, Chine.
Pok Chi Lau est né à Hong Kong en 1950. Dès 1967, Pok Chi Lau s’est engagé dans la photographe documentaire. Son travail sur la migration se concentre sur la diaspora chinoise dans les Amériques, a Cuba, en Malaisie et au Myanmar. Pendant une décennie, il a également documenté la diaspora à l’intérieur de la Chine, où les paysans / migrants ruraux de toutes les provinces se sont déplacés pour chercher du travail dans les usines des régions côtières.
Pok Chi Lau est professeur émérite de PhotoMedia au Département de design de l’Université du Kansas, qui lui a offert de nombreuses opportunités de recherche à l’international et grâce à elle son travail a été exposé et publié à grande échelle. Outre son travail de photographe documentaire, le travail de Lau en tant que poète et essayiste l’a amené à collaborer avec des professionnels des études est-asiatiques, du journalisme, des études ethniques, de l’anthropologie et des sciences sociales.